Probe et talentueux militant de la mémoire, le romancier français Aurélien Cressely signe un ouvrage de très grande qualité littéraire, qui réhabilite adroitement la mémoire de René Blum, mythique créateur des Ballets Russes de Monte-Carlo, tragiquement assassiné à Auschwitz.
La lecture de l’opuscule récemment publié par Aurélien Cressely procure un bonheur incommensurable malgré la tragédie humaine qu’il donne habilement à voir. Ce bonheur incommensurable est celui de la mémoire, de la réhabilitation de René Blum, injustement oublié par l’histoire malgré son apport au renouveau culturel du XXe siècle en Europe. De ce personnage talentueux dont nous savions peu de choses jusqu’à la parution récente de Par-delà l’oubli, Aurélien Cressely dresse le portrait à la fois émouvant et incantatoire d’un homme mû par la volonté de partager la culture et le savoir en tout lieu, y compris au camp d’internement de Compiègne où ont lieu les prémices d’une tragédie européenne et mondiale. Entretien avec un mémorialiste de talent.
Pour débuter, je vous demande une biographie. Quel est votre parcours ?
Aurélien Cressely : La littérature est arrivée tardivement dans mon parcours. Elle est arrivée tardivement parce que plus jeune, je n’avais pas su saisir ce qu’elle pouvait m’apporter. Je ne l’ai saisi qu’à la vingtaine, et donc assez tard, grâce à La promesse de l’aube de Romain Gary que j’ai trouvé magnifique. La manière dont est écrit ce livre était pour moi quelque chose d’extrêmement difficile à faire. Mais surtout, j’ai vu ce qu’il pouvait m’apporter. C’est-à-dire que j’ai eu un effet « waouh » avec ce roman, dans lequel il décrit sa mère, il décrit des sentiments, il décrit des sujets sur lesquels je n’avais jamais mis de mots. Après ce roman, j’ai lu une bonne partie de l’œuvre de Romain Gary en pensant que c’était le seul à écrire de cette manière. Je me suis rendu compte de mon erreur lorsque j’ai commencé à lire d’autres auteurs. À partir de ce moment, j’ai eu une boulimie de lecture : je lisais entre 60 et 70 romans par an. Je les dévorais. Ils me permettaient de gérer mon moi.
Lire aussi : La littérature selon Samuel Loutaty : « un continent inépuisable à explorer »
Écrire était une idée lointaine. Je n’avais pas fait d’études littéraires, j’ai fait des études en sciences politiques qui m’ont amené à Paris. C’est à mon arrivée à Paris que j’ai commencé à lire. Il y avait cette abondance de cultures, de discours, de débats qui m’ont amené vers la littérature et m’ont fait prendre conscience de l’apport des mots, de l’apport des phrases, de l’apport des ouvrages dans ma construction intellectuelle. Aujourd’hui, je travaille dans l’assurance, un milieu assez éloigné de la littérature, mais la littérature est toujours présente. C’est-à-dire qu’on peut utiliser la littérature pour être un grand professionnel. C’est ce que j’essaie de faire au quotidien, en ayant un raisonnement vis-à-vis des équipes, vis-à-vis des projets, vis-à-vis de mon environnement de travail qui soit en lien avec la profondeur qu’on peut avoir dans la littérature.
J’ai un respect considérable pour toutes les littératures, peu importe ce qu’elles sont, parce qu’il y a un choix des mots, il y a un choix de la part de l’auteur et donc, une réflexion.
Aurélien Cressely
Pourquoi écrivez-vous ?
Aurélien Cressely : Avant décrire ce roman, j’avais fait plusieurs tentatives. J’avais essayé car ça faisait longtemps que germait en moi l’idée de pouvoir exprimer quelque chose, une vision. Non pas meilleure ou moins bonne mais différente. Ce qui est beau dans la littérature, c’est qu’il y a une multitude de visions. On peut avoir sur un même sujet tel que l’amour, 11 millions de livres qui en parlent différemment. Donc, depuis longtemps germait en moi l’idée d’exprimer une vision, mais je n’y arrivais pas vraiment avec la conception de l’écriture que j’ai. Je considère que l’écriture est trop grave pour écrire sur n’importe quoi. Je cherchais un sujet mais, je ne le trouvais pas. J’avais fait plusieurs tentatives quand je pensais avoir trouvé des sujets, mais je n’étais pas arrivé au bout parce que ça ne me convenait pas, ce n’était pas assez profond. Ce que j’aime aussi avec la littérature, c’est la subtilité des mots, la subtilité avec laquelle on traite une histoire. Pour moi, l’un des plus grands romans du XXe siècle est Aurélien d’Aragon. Ce texte m’a plu parce qu’il traite d’une histoire avec une subtilité des mots, une subtilité qui m’a permis d’entrevoir et de comprendre des sujets comme je n’avais jamais pu le faire avant. Nous vivons dans un monde extrêmement complexe, la littérature me donne à la fois des clés de compréhension de ce monde, mais également des moyens pour m’assagir, ne pas me révolter face à certaines situations, me dire que d’autres l’ont connu, l’ont vécu avant moi, et que finalement, ça ne sert à rien de s’offusquer car ça existe.
Quand j’ai découvert René Blum, je me suis dit : « Voilà une injustice, celle de l’oubli. C’est trop grave pour le laisser comme ça dans un coin de ma tête. Je vais essayer d’écrire sur lui avec mes moyens ». Je me suis confronté aux difficultés de l’écriture, notamment au choix des mots pour parler d’un sujet aussi sensible, aussi grave qu’est la Shoah, la mort de six millions de personnes… J’insiste sur les mots parce que c’est quelque chose de très important. Quand on lit un livre, c’est très simple de se dire que c’est bien écrit ou non. Mais quand on choisit les mots, on sait qu’on le fait pour une raison précise. C’est pour ça que j’ai un respect considérable pour toutes les littératures, peu importe ce qu’elles sont, parce qu’il y a un choix des mots, il y a un choix de la part de l’auteur et donc, une réflexion.
Pourquoi j’écris ? J’écris parce que j’avais envie de partager une vision qui me touchait et qui pourrait peut-être aider d’autres personnes à avoir des mots pour écrire. C’est ça, c’est le partage de quelque chose qui me touchait. L’écriture, c’est le partage. C’est le fait de rendre accessible un texte que certains liront et que d’autres critiqueront. Ces critiques peuvent être positives ou négatives, il faut savoir les accepter. Si on ne veut pas avoir de critiques négatives, il ne faut pas écrire ou en tout cas, il faut écrire pour soi.
J’ai des vrais moments de découragement où je me dis qu’après le texte que j’écris, je vais abandonner l’écriture, car je ne sais plus écrire, je ne peux plus écrire, mais je finis par y revenir.
Aurélien Cressely
Comment écrivez-vous ?
Aurélien Cressely : L’écriture est une souffrance et une bénédiction à la fois. Une souffrance parce que pour sortir des mots, pour sortir des phrases, pour sortir un chapitre, je peux mettre énormément de temps. Je travaille par chapitre. Je commence un chapitre et je ne lâche pas tant que je ne l’ai pas terminé. Après ce chapitre, je m’accorde des vacances. Mais pendant la rédaction du chapitre, je ne pense plus qu’à ça. À chaque fois que j’en écris un, il y a un mot qui est très important pour moi, c’est « mûrir ». Il est très important parce que quand je commence un chapitre, j’ai toujours un plan, mais ce plan, je le tiens rarement. Je le modifie au fur et à mesure. Là où c’est une souffrance, c’est que quand je commence un chapitre, je ne sais pas ce que je vais mettre dedans. Je sais à peu près ce que je veux dire, mais je ne sais pas ce que je vais mettre dedans. Les premiers mots arrivent difficilement. Pas plus tard qu’hier, je me suis mis pendant trois heures pour écrire, mis à part des guillemets, je n’ai rien écrit d’autre. J’ai effacé tout ce que j’avais fait la veille parce que j’ai considéré que c’était nul. Quand c’est nul, c’est nul. Je le vois et j’efface tout. Et quand c’est juste, je le sais aussi. Je sais que j’ai trouvé quelque chose. Mais avant de trouver les mots justes, c’est une souffrance. Je me mets dans les conditions pour écrire, mais les mots ne viennent pas. J’ai des vrais moments de découragement où je me dis qu’après le texte que j’écris, je vais abandonner l’écriture, car je ne sais plus écrire, je ne peux plus écrire, mais je finis par y revenir. Je persévère jusqu’à ce que les mots finissent par sortir. Quand j’écris, j’attends toujours ce moment-là. Parfois, je me dis que ça va arriver, parfois, je me dis que ça n’arrivera jamais, que je ne vais jamais y arriver.
J’écris toujours avec de la musique. Toujours du piano et plutôt contemporain. La musique me met en condition pour écrire, elle détermine énormément mon écriture. Je peux écouter le même morceau 100 ou 200 fois pour écrire un chapitre. À la fin de ce chapitre, lorsque j’essaye la même musique pour écrire un autre chapitre, je n’y arrive pas. Et tant que je n’ai pas trouvé une nouvelle musique, je ne peux plus rien écrire. C’est quelque chose de très étrange. Sans la musique, je ne peux pas écrire.
Vos propos sur l’écriture rejoignent un peu ceux de Leïla Slimani dans Le parfum des fleurs la nuit…

Aurélien Cressely : J’ai beaucoup lu et écouté Leïla Slimani. La façon dont elle parle de sa manière d’écrire, de son fonctionnement est très intéressante. Elle avait même écrit un deuxième roman qu’elle a arrêté parce qu’elle trouvait que c’était nul. Je me reconnais bien dans son propos. Je trouve très bien ce qu’elle publie. Je n’ai jamais eu l’occasion de la rencontrer, mais j’aimerais beaucoup parce que c’est une écrivaine que j’affectionne beaucoup. Elle est extrêmement brillante. Elle a toujours une voix très nuancée, très objective des choses, qui s’inscrit dans la ligne de pensée que j’ai. Je suis très admiratif de ses prises de parole qui sont justes, objectives, affirmées. C’est une femme forte et déterminée que j’aime beaucoup.
Philip Roth qui est un auteur marquant pour Leïla Slimani a écrit un livre qui s’appelle Pourquoi écrire ? C’est un peu son œuvre finale. Dans Pourquoi écrire ? Il explique pourquoi il a écrit les livres qu’il a publiés. Il interroge aussi certains auteurs qui l’ont marqué tels que Primo Levi, Edna O’Brien, Milan Kundera sur le fondement de leur écriture. Il y a un passage très beau dans lequel il décrit la manière dont ces auteurs l’ont aidé dans son cheminement intellectuel. Alain Finkielkraut, qui le connaît bien personnellement, a dit un jour à la radio dans son émission Répliques une phrase qui m’a beaucoup marqué. Il a dit ceci : « Il écrit à chaque fois une nouvelle manière d’être juif ». J’ai compris beaucoup de choses dans l’œuvre de Philip Roth grâce à cette phrase. C’est vraiment un immense auteur dont le propos m’aide beaucoup. Quand j’écris, je lis beaucoup. J’ai un gros travail de documentation que j’arrête à un moment, car j’écris un roman et non une biographie. La documentation ne doit pas prendre le devant, il faut que la littérature prime parce que c’est ce qui est le plus important. Donc, je lis beaucoup de choses qui me plaisent pendant que j’écris. Ça me permet à la fois d’avoir de nouvelles idées, de m’échapper parfois, d’avoir des raisonnements différents de ceux que j’avais. Les propos d’auteurs comme Leïla Slimani ou Philip Roth sont extrêmement importants.
Je voulais donner à voir René Blum tel qu’il m’avait été décrit et non comme un personnage que je réinvente. Car au-delà de René Blum, il y a la question de la mémoire, du traitement de la mémoire, de l’histoire.
Aurélien Cressely
De quel ordre est cette documentation que vous faites ? Est-ce uniquement littéraire ?
Aurélien Cressely : Elle est multiple. Tout dépend du texte. Pour ce premier roman, il y a eu énormément de témoignages. Parce que lorsqu’un auteur écrit sur des faits réels ou sur une personne qui a existé, je considère qu’il a une responsabilité : celle de la vérité historique. Au départ, j’ai tout absorbé comme un entonnoir. Je me suis intéressé à l’histoire générale et ensuite à mon sujet. J’avais besoin de comprendre le contexte, de comprendre ce qui s’est passé, de me localiser et de me positionner par rapport à ce que je sais de l’époque et le lier à un environnement. Il y a eu beaucoup de livres qui traitent en quelques lignes du sujet. Ensuite, j’ai consulté différents écrits sur la période puis des témoignages extrêmement importants. Le Mémorial de la Shoah a fait un travail exceptionnel en recueillant les témoignages de survivants de la Shoah. J’ai pu accéder à des témoignages complets sur la période et de personnes qui ont connu René Blum. C’était important parce que je voulais m’approcher au plus près de la réalité et surtout, je ne voulais pas donner à René Blum un caractère qu’il n’avait pas. Si, par exemple, on l’avait décrit de manière moins bienveillante, j’aurais pu changer un petit peu la teneur du personnage. Certes, il aurait été moins attachant, mais il aurait été plus réaliste. C’est ce qui m’intéressait. Il y a ensuite eu sa correspondance que j’ai lu pour savoir comment il écrivait, comment il se positionnait. Ça a été une documentation très importante parce que j’ai pu entrevoir un peu ce qu’il pensait de l’époque, la façon dont il s’exprimait, interagissait avec les autres, avec quelle teneur, avec quelles distances… Ces trois sortes de documentation m’ont donné le corpus suffisant pour pouvoir écrire le livre.
Ensuite, s’est posée la question du positionnement à avoir. Quand on écrit sur un personnage qui a existé, c’est toujours difficile d’avoir un positionnement. C’est difficile parce que vous vous mettez à la place de quelqu’un. C’est pour cela que dans le livre, il n’y a pas de « je ». Je ne voulais pas me mettre à la place de René. J’ai beaucoup réfléchi au positionnement du narrateur : devrait-il être omniscient ou non ? Extérieur ou non ? On n’a pas du tout le même livre en fonction de la typologie de narration qu’on a. Pour ce premier roman, je voulais un narrateur extérieur, plutôt froid, qui connaît des choses, mais pas tout, qui va loin dans la description des faits sans vraiment tout aborder parce que je voulais laisser de la place à René Blum. Le roman parle d’une personne qui a existé. J’avais envie d’accompagner cette personne sans lui donner la main. C’est-à-dire que je voulais donner à voir René Blum tel qu’il m’avait été décrit et non comme un personnage que je réinvente. Car au-delà de René Blum, il y a la question de la mémoire, du traitement de la mémoire, de l’histoire. Ce sont des choses très importantes pour le militant de la mémoire que je suis.
Lire aussi : Catel Muller, biographe de femmes exceptionnelles
Un militant de la mémoire ?
Aurélien Cressely : Oui, je me considère comme un militant de la mémoire. C’est à dire quelqu’un qui rappelle la mémoire, qui la fait vivre, qui tente de la traiter avec le plus de respect et de méthodologie possibles. Je suis ce type de militant.
Ce sont ces hommes de talent, étrangers pour la plupart, qui ont fait la France. Parce qu’à l’époque, la France leur avait donné la possibilité de le faire.
Aurélien Cressely
Votre ouvrage est parsemé de références à moult figures novatrices du monde des arts des XIX et XXes siècles. Avez-vous procédé à de la documentation artistique pour décrire adéquatement l’apport de ces personnalités au renouveau culturel de leurs époques ?
Aurélien Cressely : Je suis rentré effectivement à chaque fois dans une documentation à la fois précise et touffue pour chaque personnage évoqué dans le livre. D’une part, pour ne pas faire d’erreur et d’autre part par curiosité intellectuelle parce que la première moitié du 20e siècle est une période que j’affectionne. Ce que je voulais aussi, c’était de pouvoir donner aux lecteurs une vision de l’époque. Pour cela, j’avais besoin de m’immerger dans l’époque, de savoir ce que représentait, par exemple, Serge de Diaghilev. Aujourd’hui, très peu de gens le connaissent alors qu’il a été un immense imprésario. Peut-être est-ce aussi lié au fait qu’il n’était pas artiste ? C’est un peu la même difficulté avec René Blum. Ces deux personnes ne sont pas artistes. Ils n’ont pas une œuvre à eux-mêmes, ils ont porté des œuvres. Ils ont été à l’origine de plusieurs œuvres, mais ils ne les ont pas faites. C’étaient des dénicheurs de talents exceptionnels.
Je connaissais Serguei de Diaghilev de nom, mais son histoire, son apport au ballet, sa manière de travailler m’étaient inconnus. Je me suis renseigné jusqu’aux pas de danse qu’il pouvait faire et à sa façon de manager. C’était un personnage exécrable avec ses équipes, mais très exigeant avec lui-même et en même temps très brillant. Pour Isadora Duncan, je me suis intéressé à la manière dont elle dansait pieds nus, à sa rencontre avec Rodin et ce que cela lui a apporté. J’ai voulu vraiment aller jusqu’au bout de mon raisonnement et de ma documentation pour ne rien laisser au hasard. Certes, c’est un petit livre, mais c’est un petit livre extrêmement vérifié. C’est pour ça que je suis chaque personnage. Quand j’aborde Matisse, je m’interroge sur ce qu’il a fait dans ce milieu et pourquoi il est arrivé au textile ? C’était la première fois qu’il faisait du textile. J’ai eu les mêmes questionnements pour Eugène Poe : quelle était sa vision du théâtre ? Qu’est-ce qu’il avait en tête quand il a créé le Théâtre de l’œuvre ? Qu’est-ce qu’était le théâtre avant lui ? Qu’est-ce qu’il avait de singulier et pourquoi ? Tout ça m’amène aussi à retracer un peu l’histoire de l’art. Aujourd’hui, on admire ces grands artistes partout. Mais à l’époque, ils n’étaient même pas acceptés dans les salons officiels, ils étaient rejetés. Ils ont cru en leur art et s’y sont consacrés. Aujourd’hui, ils sont dans les plus grands musées du monde, leurs tableaux valent énormément. Mais qu’est-ce qui s’est passé entre-temps ? Pourquoi ces hommes qui se sont battus, qui ont été au bout de leurs idées, quitte à ne pas bien gagner leur vie, à sacrifier énormément de choses, à ne pas se laisser dicter une ligne de conduite en sont arrivés là ? Comment sont nées leurs convictions ? Pourquoi ont-ils choisi la France ?
C’est ça qui fait aussi notre beau pays. Notre pays, qui parfois est moins beau quand il se recroqueville sur lui-même, a été dans la première moitié du 20e siècle une terre d’accueil pour tous les artistes. Ce sont ces hommes de talent, étrangers pour la plupart, qui ont fait la France. Parce qu’à l’époque, la France leur avait donné la possibilité de le faire. Si aujourd’hui, on faisait cela, la France serait encore meilleure. Mais on se recroqueville de jour en jour. La France était un pays de liberté, un pays où les artistes, quelles que soient leurs nationalités pouvaient entreprendre. Je pense notamment à des peintres comme Picasso qui ont pu se consacrer librement à leur art. Est-ce que ces artistes pourraient-ils avoir la même liberté, le même accueil s’ils étaient nos contemporains ? Je pense que non et c’est dommage parce que ce pourrait être salvateur pour la France. Il faut que notre pays s’ouvre à toutes ces cultures, à tous ces gens qui peuvent nous apporter énormément, nous permettre de voir autre chose, de voir les choses différemment… La culture est très importante pour moi. C’est pour ça qu’il y a beaucoup de culture dans le roman. C’est aussi à l’image de René Blum, à l’image de cette période où tout le monde venait dans notre pays pour accéder à cette culture. Je sais qu’il y avait beaucoup de belles choses ailleurs, dans d’autres pays. Mais la France pouvait se réclamer d’avoir une scène culturelle très ouverte, très tolérante et très revendicative. C’est important de connaître cette histoire qui a été importante pour le prestige de notre pays.

Par-delà l’oubli, votre premier roman est effectivement consacré à René Blum, le créateur des Ballets Russes de Monte-Carlo, dont vous retracez excellemment le parcours. Quelle est la genèse de ce texte ?
Aurélien Cressely : C’est une rue. La rue René Blum située dans le 17e arrondissement de Paris, à 10 mètres du lieu où j’habitais. C’est là où se trouvait le Monoprix. Je passais devant cette rue à chaque fois que je me rendais au Monoprix. Quand j’ai vu une plaque en hommage à René Blum, je me suis interrogé sur son identité. Bien sûr, j’ai fait un lien avec Léon Blum, un homme politique extrêmement intéressant, qui a accompli beaucoup de choses, notamment pour l’émancipation sociale des travailleurs. Après avoir vu cette plaque de rue, j’ai tenté de me renseigner sur René Blum, mais à l’époque, il n’y avait pas grand-chose. Il n’y avait que quatre résultats qui paraissaient d’ailleurs sur Google pour un homme qui a accompli beaucoup de choses. Ensuite, il y a eu La rafle des notables, le livre d’Anne Sinclair qui a été déterminant, c’est un texte qui m’a énormément touché. Lorsqu’elle évoque le passage de son grand-père au camp de Compiègne, elle évoque à un moment René Blum comme un personnage central du camp, quelqu’un d’extrêmement important. Elle l’évoque parmi d’autres grands hommes internés.
À l’issue de cette lecture, j’ai décidé de mener une enquête. J’ai commandé et lu Rene Blum and the ballets russes : in search of a lost life, une biographie très intéressante publiée aux États-Unis par l’historienne américaine Judith Chazin-Bennahum, que j’ai rencontré plus tard. Dans ce livre, je découvre la place fondamentale qu’a eu René Blum dans la culture française. Il était décrit comme quelqu’un de bienveillant, de courageux, de digne, qui a réalisé beaucoup de choses pour son pays, la France. Ce qui m’a gêné, c’était son oubli. J’ai trouvé injuste que cet homme qui avait eu énormément d’honneurs dans sa carrière, et qui avait fait le choix de revenir en France alors qu’il était menacé, soit tombé dans l’oubli. J’ai voulu lui rendre justice à travers l’écriture, qui est pour moi la chose la plus importante : celle qui reste, qui peut changer la vie d’une personne, d’une société… Je ne savais pas si j’étais capable ou non d’écrire un livre, mais je savais que le sujet était juste. Il y avait là une occasion de rendre hommage à un homme juste, un personnage important. D’une certaine manière, je voulais redonner une deuxième vie, en tout cas, une nouvelle mémoire à cet homme injustement oublié.
Lire aussi : « Les Dissemblables », livre monument pour une femme d’exception
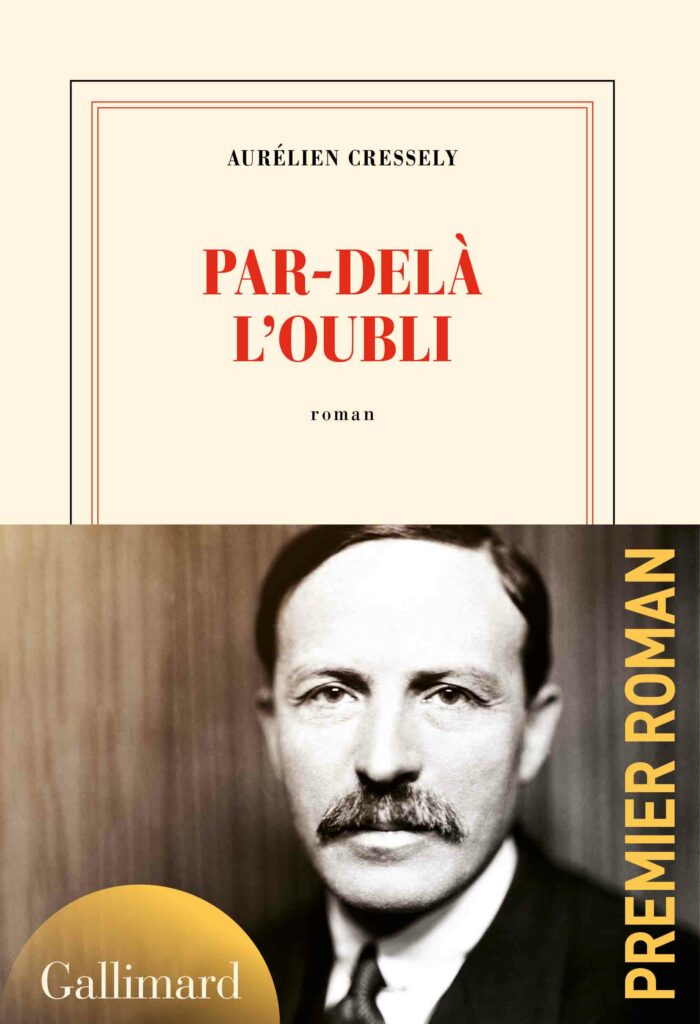
Ce portrait de René Blum est aussi celui de plusieurs personnalités éminentes juives dont vous relatez des fragments de vie. Quelle en est la raison ?
Aurélien Cressely : Quand je me suis renseigné sur René Blum, je me suis aussi renseigné sur les personnes qu’il a côtoyées. C’est ainsi que j’ai découvert Jean-Jacques Bernard. Je me suis alors renseigné sur ce qu’il a fait, sur son théâtre et sur la manière dont il a fait évoluer le théâtre français. C’était extrêmement intéressant. Je me suis dit que ce serait bien de parler de lui ainsi que de ces autres personnages qui ont été dans le camp de Compiègne avec René. Dire ce qu’ils ont réalisé, c’est aussi leur rendre hommage. Même si le livre rend hommage à René Blum, quelque part, il rend aussi hommage à toutes ces personnes qu’il a croisées. Pas uniquement célèbres d’ailleurs, parce qu’il y avait aussi des gens moins connus, qui n’ont pas eu le temps de l’être comme ce jeune homme courtier en assurances, où ce couple qui se rencontre à Drancy dans l’horreur la plus totale en sachant qu’ils vont se quitter le lendemain. Alors ils essaient d’être forts tous les deux. Mais comment peut-on être fort face à ça ?
J’ai voulu rappeler des fragments de vie, des fragments d’être, des fragments d’humains. Parce que derrière cette horreur, il y avait des humains et il faut le rappeler. C’est pour ça qu’ils sont là. C’était vraiment une tentative de donner corps à ces mémoires. Peut-être qu’en lisant mon livre, d’autres vont les trouver extrêmement intéressants et c’est tant mieux.
La France, c’était le pays où des voix s’étaient élevées pour défendre le capitaine Dreyfus en s’opposant à l’antisémitisme de l’armée, d’une certaine noblesse, d’une certaine aristocratie, qui voyaient dans les Juifs les enfants du déicide.
Aurélien Cressely
Ces notables, qu’ils soient français ou d’autres nationalités, avaient un attachement viscéral à la France malgré les remugles de l’antisémitisme. C’est le cas notamment de René Blum, qui fit le choix d’y rester malgré les risques de déportation.
Aurélien Cressely : C’est d’abord une question d’honneur. L’honneur de son nom. René Blum comme sa famille et comme beaucoup de gens était un homme d’honneur. S’il avait su ce qui allait lui arriver, s’il avait su qu’il allait mourir, peut-être qu’il ne serait pas revenu. Il est revenu parce qu’il était courageux. Il ne voulait pas être traité de fuyard, ni que son nom, Blum, soit traîné dans la boue. Il faut aussi se remettre dans le contexte de l’époque. Je ne pense pas que quelqu’un aurait pu penser qu’une chose aussi ignoble, aussi horrible, aussi indicible que la Shoah aurait pu exister. Ces hommes se disaient tous que la France était leur pays. La France était tout simplement leur pays. Ils ne se voyaient pas ailleurs qu’ici. Ils étaient français et dans leur pays. Pourquoi auraient-ils fui ? C’est un peu naïf, mais ça me ramène à ce que je disais tout à l’heure : ils ne savaient pas la suite, ils ne s’en doutaient pas. Ils ne pensaient pas qu’ils allaient mourir. Ils auraient pu servir autrement et un peu mieux la France, en étant ailleurs.
Cet attachement viscéral vient aussi du fait que pour beaucoup de Juifs, la France représentait quelque chose. La France, c’étaient les idées. La France, c’était le pays où des voix s’étaient élevées pour défendre le capitaine Dreyfus en s’opposant à l’antisémitisme de l’armée, d’une certaine noblesse, d’une certaine aristocratie, qui voyaient dans les Juifs les enfants du déicide. La France était peut-être le dernier rempart de l’antisémitisme en Europe. Les gens venaient en France parce qu’ils croyaient vraiment en ce pays, en la défense des idéaux de droit, de liberté, d’égalité et de fraternité des peuples. Ils étaient attachés à cette France qui était la leur, qu’ils avaient construite. Ils avaient un espoir : celui d’être protégé par le pays des droits de l’homme. Cet espoir a été déçu par la France, qui a trahi. Parmi les personnages qui ont arrêté René Blum, il y avait des allemands accompagnés par un fonctionnaire français. Les gens qui gardaient les camps étaient le plus souvent des français payés par l’État français. On doit se souvenir que c’est la responsabilité de la France, qui n’a pas été à la hauteur et a trahi des citoyens français et des résidents venus chercher refuge dans notre pays pour les livrer à l’Allemagne au nom d’une idéologie ignoble. Il faut s’en souvenir parce que c’est ce qui nous permettra de reconstruire notre pays sur des bonnes bases.
Encore aujourd’hui en 2023, il y a des gens qui traversent la Méditerranée au péril de leur vie parce qu’ils croient en la France. Quand ils viennent en France, ils sont un peu déçus, mais ils croient malgré tout en elle… L’attachement viscéral de ces notables vient également du fait que la France était à tous, elle est toujours à tous. Je tiens vraiment à le dire : la France n’appartient pas qu’aux Français, elle appartient à tous ceux qui veulent devenir français. C’est pour ça qu’on a ce pays qui est le nôtre. Moi, j’accorde énormément d’importance à la France. J’aimerais qu’il soit plus tolérant, plus progressif, plus intelligent parfois. Mais pour autant et j’en suis persuadé parce que je suis éternel optimiste, je pense qu’à un moment ou un autre, on reprendra nos esprits.

Outre l’opuscule d’Anne Sinclair, votre texte est l’un des rares ouvrages non-scientifiques à aborder la rafle des notables. Mais à l’opposé de cette dernière, vous avez choisi de raconter cette histoire sous une forme romanesque. Pourquoi ?
Aurélien Cressely : Je ne suis pas un historien, je suis un romancier. L’histoire est faite par les historiens qui ont un parcours académique, une méthodologie scientifique de vérification des sources, une reconnaissance de leurs travaux par leurs pairs. Je ne voulais pas faire une biographie non plus. D’une part, je ne m’en sentais pas capable et d’autre part, je n’avais pas envie de le faire. Je me suis inspiré d’un cadre de vie pour donner aux lecteurs la possibilité de découvrir René Blum. Je ne sais pas si René Blum a été au théâtre voir L’ennemi du peuple comme je l’écris dans le deuxième chapitre. Je sais que L’ennemi du peuple a été présentée au Théâtre des Bouffes du Nord lors de cette soirée. Probablement, qu’il y a été, mais je n’ai pas de preuve. Ce que je sais, c’est que je voulais raconter de lui ce qui ressortait dans les témoignages, à savoir un homme féru de cultures, qui allait au théâtre autant de fois qu’il le pouvait. Je voulais donner aux lecteurs cette vision de René que je n’aurais pu proposer avec une biographie sourcée. Certes, il y a un cadre historique qui est vrai, mais certains éléments de la vie privée sont inventés.
Avec force précision, votre ouvrage met également en lumière l’effervescence intellectuelle qu’il y avait au camp de Compiègne.
Aurélien Cressely : C’est quelque chose qui est très caractéristique de la rafle des notables. Ces notables étaient des personnalités avec une vie culturelle très importante au quotidien, un savoir-faire pour certains d’entre eux qui sortait de l’ordinaire. Ces conférences, qui ont eu lieu, permettaient aux internés de s’évader par la culture et le savoir. J’avais à cœur de le raconter parce que c’est un épisode extrêmement important. Il est évoqué dans un certain nombre de témoignages des internés. C’est aussi quelque chose d’assez beau. C’est beau de savoir que ces hommes qui n’avaient plus rien, qui étaient enfermés, qui vivaient dans une injustice criante parvenaient à s’évader par la culture, le savoir. Ils se faisaient confiance mutuellement pour organiser des conférences, qui les faisaient sortir un moment de l’injustice et de l’ignominie dans lesquelles ils étaient enfermés. René Blum a eu un rôle assez fondamental dans le camp puisqu’il a organisé notamment deux conférences sur la poésie. C’est impressionnant. C’est-à-dire qu’il connaissait assez de poèmes pour animer deux soirées. Ces conférences sur des sujets divers étaient aussi l’occasion de rappeler que malgré l’ignominie et l’horreur des camps, il y avait quelque chose de profondément humain. L’humain est plus fort que tout. Ces conférences étaient une lumière dans un océan d’obscurité.
Le romancier choisit les mots, c’est au lecteur d’interpréter comme il le souhaite ce qu’il voit.
Aurélien Cressely
Parmi les auteurs figurant dans votre panthéon littéraire, il y a Patrick Modiano dont l’œuvre est consacrée à cette période et notamment à la réhabilitation de figures injustement oubliées. Qu’est-ce qui vous plaît chez cet auteur ?
Aurélien Cressely : Je suis un grand admirateur de l’œuvre de Modiano. Ce qui me plaît chez lui, c’est déjà le fait que ses livres sont des textes courts. Les livres courts se concentrent sur l’essentiel, notamment sur le choix des mots. Le choix des mots est toujours justifié, toujours judicieux, toujours pertinent chez Patrick Modiano. Ça me subjugue à chaque fois. On peut penser qu’il est avare des mots, mais il ne l’est pas. Il arrive à décrire dans ses romans des pans de vie entière. Je trouve cela magnifique. À chaque fois qu’il publie un roman, je me dis : « Comment a-t-il pu écrire si justement une telle situation ?» Il a été extrêmement important dans ma construction intellectuelle et dans le fait de choisir les bons mots pour m’exprimer. C’est souvent difficile de choisir les mots pour parler de choses aussi sensibles que la Shoah, mais Patrick Modiano arrive très bien à le faire. Ce que j’aime aussi chez Patrick Modiano, c’est sa façon de décrire l’intérieur de ses personnages au travers de marches. Il y a beaucoup de descriptions de marches dans les rues dans ses livres. Il marche lui-même beaucoup à Paris. Ce que j’ai voulu faire de manière habile avec ce roman, c’était de choisir les bons mots, de faire des phrases plutôt courtes, de laisser au lecteur la possibilité de réfléchir sur le sujet et non de lui donner toutes les réponses. Cette subtilité dans le choix des mots laisse de la place au lecteur pour qu’il fasse sa propre interprétation. Le lecteur est intelligent, il n’a pas besoin qu’on lui explique tout. Le romancier choisit les mots, c’est au lecteur d’interpréter comme il le souhaite ce qu’il voit. C’est ce que j’aime bien chez Modiano et c’est que c’est ce que j’ai modestement essayé de refaire dans Par-delà l’oubli.
À l’exemple de celui-ci dans Dora Bruder, la description que vous offrez de la ville de Paris est toujours propice à l’évocation de moments historiques, qu’ils soient corrélés ou non à la déportation.
Aurélien Cressely : Je suis amoureux de la ville de Paris. Quand je suis venu habiter à Paris dans le cadre de mes études, j’ai compris que je devais y rester. J’ai beaucoup appris dans la ville de Paris en marchant. Quand on marche, on voit toujours des bâtiments, des lieux, des œuvres sur lesquels on se renseigne. Paris est un tableau. J’adore les livres de Patrick Modiano parce qu’il parle toujours de Paris. C’est un amoureux de Paris. Je crois même qu’il a fait un livre illustré avec quelqu’un sur Paris. Je n’ai jamais vu quelqu’un qui décrivait mieux Paris que lui en littérature ! Quelque part, je voulais aussi rendre hommage à la ville de Paris. C’est pour ça que je décris de manière historique tous ces emplacements, toutes ces rues où passe René Blum quand il part travailler ou quand il est emmené à Compiègne. Car malgré l’horreur de la déportation, il y a la ville qui reste et demeure témoin des événements.
J’ai longtemps pensé que pour écrire un livre, il fallait faire des phrases alambiquées et très recherchées, mais n’est pas Proust qui veut !
Aurélien Cressely
Outre Patrick Modiano, votre panthéon littéraire est également constitué de Marie Hélène Lafon, la grande romancière française. Qu’est-ce que vous aimez dans ses textes ?
Aurélien Cressely : J’aime les romans courts, cisellés, un peu nerveux, qui montrent qu’on n’a pas besoin d’écrire de longues phrases pour que le lecteur puisse se faire lui-même une idée du récit. C’est ce que j’aime dans les livres de Marie-Hélène Lafon. Les sources est un très bon livre dans lequel elle décrit finement l’enfermement d’une femme, la peur, le stress. J’ai été happé par ce récit. Malgré une certaine froideur dans l’écriture, ce qu’elle décrit est quelque chose de profondément humain.
Patrick Modiano et Marie-Hélène Lafon ont comme beaucoup d’auteurs une relation spécifique à la langue française. Quel rapport entretenez-vous avec les langues que vous parlez, notamment le français ?
Aurélien Cressely : Je trouve qu’on a une langue magnifique. On a énormément de mots pour décrire les choses et c’est beau d’avoir plusieurs types d’écritures. J’ai longtemps pensé que pour écrire un livre, il fallait faire des phrases alambiquées et très recherchées, mais n’est pas Proust qui veut ! Quand j’ai commencé à écrire, je faisais des phrases très compliquées qui étaient mauvaises parce que ce n’était pas moi. En discutant un jour avec un ami lors d’une soirée, celui-ci m’a dit de faire des phrases courtes. J’y ai beaucoup réfléchi et j’ai décidé que j’allais faire des phrases simples, des phrases qui me correspondent. Je ne sais pas si elles sont mieux mais en tout cas, elles sont à mon image. Peut-être que mon écriture évoluera au fur et à mesure de mes publications ou peut-être pas. J’espère qu’elle évoluera avec moi.
La langue a une double fonction dans votre livre : outre le fait de réhabiliter la mémoire de ces hommes injustement oubliés, elle montre aussi l’exclusion dont ils furent l’objet. Pourquoi ?
Aurélien Cressely : Oui, tout à fait. Elle a une double fonction. Elle montre notamment tout ce que ces hommes ont perdu du jour au lendemain, parce que juifs. Il y a d’ailleurs une phrase dans le roman qui est assez parlante : « Il entra français et juif et en ressortit juif et français ». C’est-à-dire qu’ils perdent leur nationalité et gagnent une religion qui, pour la plupart, n’était qu’une confession, une affaire privée. La langue permet d’aborder subtilement cette situation.
Je ne considère pas la littérature considère comme un art, je la considère comme une école de la vie.
Aurélien Cressely
Comment qualifierez-vous votre travail littéraire ?
Aurélien Cressely : C’est un travail littéraire en construction. En construction parce que la littérature est forcément évolutive. Il y a certaines erreurs dans ce roman que je ne referai pas dans les prochains. Par exemple, j’ai beaucoup documenté certains liens alors qu’il faut savoir laisser la documentation de côté pour que le travail littéraire l’emporte. J’aimerais laisser davantage de place à l’histoire, non pas avec une majuscule mais à l’histoire du roman… C’est un travail en construction, en évolution. Il sera nécessairement différent la prochaine fois. J’essaierais de prendre plus de risques. Je n’ai pas voulu prendre beaucoup de risques avec celui-ci parce que je ne me suis pas senti la capacité de le faire. Je n’étais pas assez sûr de moi pour pouvoir le faire. Je suis resté dans quelque chose de très propre, de très simple. J’aimerais prendre plus de risques et d’essayer de faire évoluer ma manière d’écrire, de pouvoir aller plus dans l’émotion, d’aller vers quelque chose qui peut être davantage touchant. C’est une réelle ambition.
C’est un travail littéraire en construction. Peut-être qu’il ne s’arrêtera jamais d’être en construction. On est constamment en train d’évoluer. On se construit toujours, on progresse toujours. J’aimerais que le mien évolue, qu’il soit différent. Il n’est pas abouti, il ne pourra jamais être abouti. Il est en construction.
Qu’est-ce que la littérature ? Que peut-elle ?
Aurélien Cressely : C’est une ouverture vers ce qu’à titre individuel, la vie ne peut pas nous apporter totalement. La littérature nous permet de voir la vie différemment, de ne pas la penser avec ses propres yeux, de se dire qu’il y a une multitude d’autres vies, une multitude d’expériences qui peuvent arriver. Elle offre surtout la possibilité de se construire intellectuellement et d’être un peu plus intelligent. Je ne considère pas la littérature comme un art, je la considère comme une école de la vie. La peinture est un art. La sculpture est un art. Le théâtre est un art. La littérature n’est pas un art pour moi. Je ne me considère pas comme un artiste. Je me considère comme quelqu’un qui décrit le monde car la littérature fait partie du monde. Elle doit être la vie, elle est la vie. Finalement c’est ça : la littérature, c’est la vie.
