Pionnier des études consacrées à l’homosexualité en Afrique francophone, le sociologue camerounais Charles Gueboguo est également l’auteur d’un formidable roman, qui dresse un bilan des sociétés africaines, cinq décennies après les indépendances. Écrit dans une envoûtante langue créolisée, le livre donne entre autres à voir une galerie de personnages énigmatiques, dont « Le rêve », et les richesses linguistiques des populations africaines, qui se sont appropriées le français en le mélangeant à leurs dialectes pour faire sourdre une langue d’un dynamisme, d’un humour et d’une sensualité absolument jubilatoires…
En concédant également une place centrale à la figure du griot, l’auteur rappelle à juste titre le pouvoir du récit oral dans la transmission de l’histoire et des savoirs, et son importance en tant que l’une des formes de la littérature. Entretien avec Charles Gueboguo.
Comment écrivez-vous ?
Charles Gueboguo : De manière méthodique, puisque mon cerveau a été formaté à suivre la voie pour mieux la pervertir. Aussi, même quand je donne l’impression d’une improvisation dans l’acte écrit, ce n’est possible que parce que la méthode (meta odon : le chemin vers) est activée par défaut. Je peux donc aisément m’y perdre pour me retrouver différant (avec a), c’est-à-dire un particulier habité par et ouvert aux universaux. Un rhizome nécessairement problématique, entendez en état de perpétuel questionnement et remise en question ad vomitam.
Sur quel support écrivez-vous ? Avez-vous un rituel ? Procédez-vous à de la documentation avant d’entamer l’écriture d’un texte ?
Charles Gueboguo : J’écris sur mon ordinateur portable. Je rature dans les calepins aussi, mais je goûte peu.
Un rituel ? J’écris quand j’étouffe, j’étouffe souvent puisque, en mode constant de fabrique de l’abstrait. Pour ce faire, des lectures intenses et régulières s’imposent et travaillent mon quotidien. Tous supports confondus.
Je n’imagine pas qu’on puisse s’engager dans l’acte d’écriture sans une documentation appropriée, au préalable, même s’il s’agit d’autofiction. D’avoir vécu une réalité vous donne une possible autorité, elle ne vous confère jamais la plausibilité attendue du comment-dire. La plausibilité est la clé ici, parce que c’est elle qui transforme le réel subjectif en réel fictionnalisé, ou plus large en réel doté de littérarité.
Écrire, c’est se dire. Se dire, c’est refuser le devenir-humain sans un engagement critique avec l’espace qui nous accueille.
Charles Gueboguo
Sociologue de formation, vous avez décidé de vous lancer en littérature avec la publication d’un roman (Cacophonies des voix d’Ici) en 2018. Pourquoi ?
Charles Gueboguo : L’acte d’écriture, c’est ma pneuma, mon souffle sans lequel je ne peux mener ma quotidienne activité réflexive. Écrire, c’est se dire. Se dire, c’est refuser le devenir-humain sans un engagement critique avec l’espace qui nous accueille. L’engagement critique, c’est faire le choix d’une cohabitation gagnant-gagnant avec cet espace dans lequel on souffle…
De surcroît, beaucoup connaissent Charles Gueboguo le sociologue, notamment à travers la série des travaux pionniers faite autour de la problématique des homosexualités, et son corollaire l’homophobie d’État, en Afrique francophone. L’entrée dans l’univers de la littérature de fiction est une manière autre de disserter sur les problématiques susmentionnées et autres. Cela permet une bidirectionnalité entre la littérature académique et la littérature non-académique, deux mondes dans lesquels je navigue, qui m’ouvrent le champ des possibles de dire la somme des réels intraduisibles autrement, qui me hantent.
Mais aussi, sur un plan plus technique, essayer de relever les défis des différentes praxis relevant de ces deux champs : on n’écrit pas un traité de sociologie comme on écrit un roman. J’écris mes romans avec la rigueur méthodologique d’une pensée philosophique, le lyrisme en sus épousant les courbes vertigineuses, tantôt tranchantes, tantôt planes, tantôt nauséeuses, de l’intrigue qui se prête au récit. Plus facile à dire, je m’impose à m’y essayer avec peu ou prou de succès personnel.
Les actions de votre livre se situent dans un pays imaginaire d’Afrique nommé « Ici » et non au Cameroun ou vous êtes né. Quelle en est la raison ?
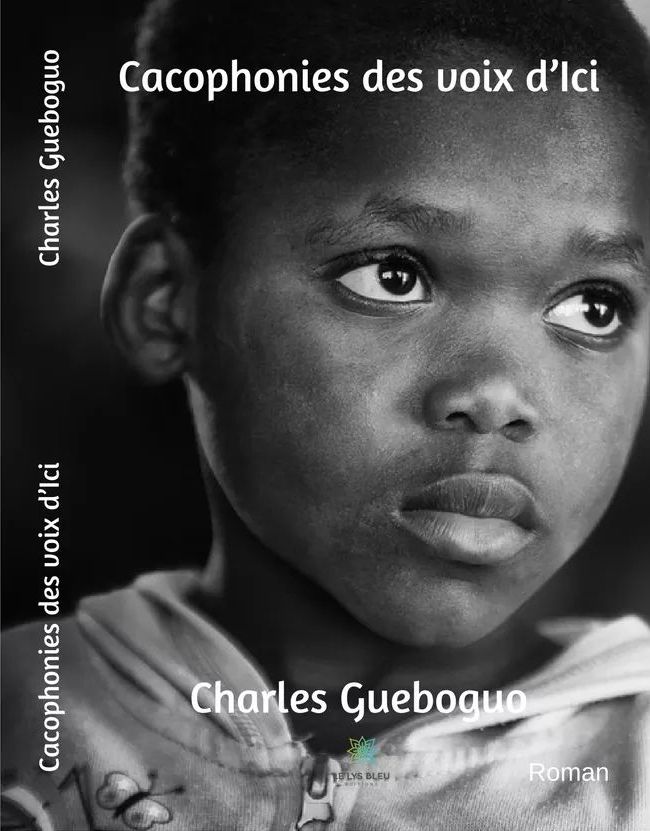
Charles Gueboguo : Qui dit que « Ici » ne serait pas une manière de fictionnaliser l’espace Cameroun, qui en ferait un espace discursif, c’est-à-dire un terrain qui ouvre les possibles aux discours politiques, juridiques, économiques, culturels et… de fiction ? « Ici », c’est la province d’habitation du sujet à chaque fois qu’il s’engage dans la lecture de ce roman, avec les multiples pauses qu’impose le récit. Il est volontairement chaotique, avec pour ambition de mimer la vérité du réel qu’il dépeint, sans jamais tomber dans la facilité de la confondre avec le réel des vécus. Parce que tout réel, une fois transposé à l’écrit ou à l’oralité, est par essence travestissement des vérités vécues/entendues. Le biais reste inévitable, d’où la condamnation au mimétisme de la vérité du réel. Qui plus est, je suis né Là-bas, je vis Ici, j’ai visité des Ailleurs. Je sais d’où je viens, comme l’oiseau mythique Sankofa, je m’envole partout à partir de mes racines qui sont hybrides ; le cœur reste le Cameroun.
Cacophonies des voix d’Ici est un manifeste politique. Après plus de cinq décennies d’indépendances que reste-t-il à nos Afriques, une fois qu’on a déjà admis qu’il s’est agi d’indépendances de drapeau ? Qu’est-ce qu’on fait une fois le constat établit sur les mauvaises gouvernances, les corruptions, la gabegie, le néocolonialisme, les masculinités toxiques, le contrôle du corps des femmes et des enfants ? C’est du déjà entendu, du déjà dénoncé depuis Mongo Beti, Chinua Achebe ou encore Kourouma. Quelles sont donc les solutions proposées à laisser aux générations après nous ? Voilà in fine les préoccupations qui ont motivé l’écriture de ce manifeste politique romancé.
Outre les thématiques susnommées, l’une des caractéristiques de votre ouvrage se situe dans le travail effectué sur la langue. Comment avez-vous fait pour composer cette langue « créolisée » ?
Charles Gueboguo : Je disais tantôt : « Je sais d’où je viens ». D’où je viens, le mot, c’est la chose. L’oralité y reste centrale et dynamique. J’ai puisé dans les univers des régionalismes linguistiques d’Afrique que je connais, dans les univers des discours proverbiaux, mais également les univers de la musique classique, notamment les opéras (quand j’écris, je chante). Par la suite, je n’ai fait que retranscrire textuellement ce rendu en faisant interagir ces univers.
Mon rapport personnel aux langues est dialectique. Les langues que je parle ont des trajectoires qui se choquent, elles produisent des étincelles. Les étincelles qui ressortent de ces chocs sont les différents espaces qui donnent la voie aux voix multiples de mes récits.
Vous mêlez les codes du conte à ceux du théâtre et du roman en concédant une place importante à la figure du griot…
Charles Gueboguo : Le griot est la figure allégorique des cosmogonies africaines. Il permet de rendre compte des rapports harmonieux ou conflictuels entre les espaces visibles et invisibles, socle du vivre-ensemble : le visible est parce qu’il est travaillé par les forces invisibles, vice versa. Le griot opère par diverses mises en scène théâtrales, où l’art du conte n’a pas qu’une fonction narrative. Elle est aussi didactique, en ceci que les silences, les chants, les appels et les réparties sont des constructions qui soudent la communauté. Les sessions de questions-réponses s’apparentent à des formes de révision des artefacts qui forgent l’ethos du groupe. Une forme d’apprentissage donc à la vie du groupe, la vie en groupe, et la culture qui marque l’identité dudit groupe.
Pour moi, l’écriture est une manière de documentation permettant une forme de traçabilité matérielle : peu ou prou fiable que la mémoire à elle tout seule.
Charles Gueboguo
Les griots ont longtemps relaté en Afrique de l’Ouest, des récits non-écrits. Est-ce de la littérature ?
Charles Gueboguo : L’oralité une fois ses codes portés à l’écrit devient une forme de littérature. C’est ce qui fait, entre autres, la force du récit chez Kourouma. Mais cela ne veut pas dire que l’écriture reste la téléologie du récit oral. Pour moi, l’écriture est une manière de documentation permettant une forme de traçabilité matérielle : peu ou prou fiable que la mémoire à elle tout seule. Ce serait son prolongement. Donc à cela, on pourrait aussi ajouter les autres formes d’enregistrement (vidéo par exemple), comme forme de documentation du récit pour qu’il reste pérenne. Ce qui permet, somme toute, de poser encore la question de savoir ce que c’est que la littérature, quelles sont les fibres qui sont insérées dans le texte tricoté ? On n’a pas encore fini d’introduire de la complexité dans cette définition, pour qu’on puisse dire littérature orale, littérature déclamée (je pense au slam par exemple) sans qu’on n’y voie quelque chose d’antithétique.
Outre votre statut d’auteur, vous êtes également professeur de littérature comparée. L’enseignement d’objets littéraires a-t-il un impact sur vos lectures personnelles ?
Charles Gueboguo : L’impact de l’enseignement des objets littéraires reste significatif dans la réception et les interprétations que je fais de mes lectures. Je suis nécessairement plus exigeant, parce qu’un bon livre lu fera nécessairement l’objet de mes prochains enseignements. Les bons textes se font cependant très rares : qu’est-ce qu’écrire veut dire de nos jours ?
Il y a une heureuse confusion entre un bon alignement des mots, ou disons-le tout de go, la maîtrise de la langue et la maîtrise du récit. Si la commande de la langue est un atout majeur pour faire passer le message, elle ne se suffit pas à elle toute seule. Encore faudrait-il que l’intrigue se tienne jusqu’au bout, fasse appel à des enjeux qui iront crescendo jusqu’à l’atteinte de l’acmé, que les personnages principaux résolvent leurs tensions (les personnages secondaires aussi), que le texte dans ses différents styles sert l’intrigue. Bref, encore faudrait-il que nous n’ayons pas affaire à des textes de Ted Talk, c’est-à-dire sans surprises. Or ce qui s’observe de plus en plus, c’est qu’il y a une tendance à pavoiser sur des thèmes à la mode, il y a comme une manie à l’écriture masturbatoire. Tout se passe comme s’ils se regardent écrire plutôt que de faire acte de littérature. Fin des courses, on s’ennuie dès les cinq premières pages. Il ne suffit pas d’avoir la commande de la langue, encore faut-il que celle-ci soit au service de la narration, et que les effets de surprise aillent de pair avec les enjeux de la même narration.
Écrire est un acte concret. La question est : qu’est-ce qu’on veut concrétiser, et pour quelle cible ? Quel besoin d’essayer de concrétiser ce qu’un travail de journaliste ferait à merveille, si l’on se contente d’une simple sociographie, c’est-à-dire la description pure et simple du réel ? Pourquoi je vais passer du temps à la lecture sans surprise de ce que je peux observer dans une peinture réaliste, ou regarder dans un documentaire. S’il suffit juste de se repaître de l’heureuse formule, alors je préférerais regarder mon nombril à moi que de jouer les voyeurs.
Comment écrire de la littérature ?
Charles Gueboguo : Il faut une intrigue qui tienne jusqu’au bout ; des enjeux auxquels les personnages vont faire face avec des hauts et des bas qui iront crescendo jusqu’au point culminant. Les résolutions de tous les enjeux. Les choix moraux auxquels les personnages doivent faire face. Par enjeux moraux, il ne s’agit pas de questions d’éthique, mais des choix qui vont déterminer le cours du récit, et qui ne sont pas toujours des choix cornéliens. Poser ou ne pas poser une action pour un personnage. S’il la pose, qu’est-ce qu’il perd ? S’il ne la pose pas, qu’est-ce qu’il gagne ? Il doit toujours être amené à faire le « mauvais » choix pour faire avancer le récit, et sans qu’il ne se retrouve dans une impasse, qui serait aussi la fin prématurée du récit. Il y a d’autres artefacts, comme l’arme de Tchekhov, qui pourraient servir à faire accélérer le récit, tout en faisant attention au détail. Ainsi, si une arme est présentée au deuxième chapitre par exemple, il faut qu’elle soit déclenchée au troisième ou au plus tard au quatrième chapitre. Sinon, ce n’est pas la peine de la présenter. Si vous faites une longue description lyrique d’un arbre ou d’un espace, cela doit servir l’intrigue, en ceci qu’il faut que par la suite quelque chose d’important s’y produise pour faire rebondir le récit. Autrement, c’est du remplissage ou de l’information dumping comme on dit en anglais, même s’il s’agit de très belles tournures de phrases. Tout le décorum textuel doit nécessairement servir le récit, autrement c’est du Parnasse, l’art pour l’art. C’est une forme de littérature aussi, mais elle ne m’apporte rien.
Les Aquatiques de Osvalde Lewat est le roman-école par excellence où l’on voit ressortir tout cet art. Murambi de Boris Boubacar Diop aussi. Le talent, c’est dans la manière savante d’agencer tout cela pour maintenir l’attention du lectorat jusqu’au bout. Ces deux auteurs le font à merveille. Imbolo Mbue également dans, Voici venir les rêveurs.
Le style est enseigné parce que des récurrences s’observent. Parce qu’on se rend compte que ce sont des éléments qui font que le récit ne piétine pas toujours, que le texte a un rythme régulier ou accéléré en fonction des scènes.
Charles Gueboguo
Que ce soit en France ou aux États-Unis, de plus en plus d’établissements dirigés par des enseignants-chercheurs en littératures, ou des auteurs enseignent divers styles d’écriture aux aspirants écrivains. Quel regard portez-vous sur ces méthodes ? Le style doit-il être enseigné ?
Charles Gueboguo : Le style est enseigné parce que des récurrences s’observent. Parce qu’on se rend compte que ce sont des éléments qui font que le récit ne piétine pas toujours, que le texte a un rythme régulier ou accéléré en fonction des scènes. Parce qu’on constate que les longues phrases sont généralement descriptives, et qu’elles permettent de ralentir le récit. Et que les phrases courtes l’accélèrent. Et que c’est un savant dosage entre les deux rythmes, à la manière d’un secret de cuisine de grand-mère, qui fait que le récit est addictif.
Ces formations sont souvent décriées pour le formatage des élèves…
Charles Gueboguo : Ce sont les mêmes qui produisent les machines à best-sellers et que nous nous empressons de traduire en français et autres langues. Ne faudrait-il donc pas s’interroger sur ce qui fait la recette de tels succès, et les réadapter à nos contextes respectifs ? La liberté ce n’est pas seulement de résister, c’est aussi parfois de s’imprégner d’une réalité pour la faire éclater de l’intérieur. Qu’est-ce qui nous empêche de nous saisir de ce formatage pour en faire un objet de rébellion, de l’intérieur donc, ouvrant le champ à plus de dynamisme dans les activités d’écriture. Comment expliquer que la majorité des prix littéraires courus dans le monde obéit à ce « formatage » ? Il doit bien y avoir quelque chose là-dedans qui marche, bien au-delà de la simple dictée hégémonique culturelle américaine. Il n’y a pas de honte à reconnaître ce qui marche, à s’en saisir, à se le réapproprier, à le transformer, à le recréer pour stimuler la créativité littéraire.
S’agissant de créativité littéraire, pourriez-vous nous dire la place qu’occupe la forme dans votre travail ?
Charles Gueboguo : Si le mot, c’est la chose. La forme, c’est l’ossature de la chose dite ou récitée. Il ne suffit pas de pouvoir dire, encore faudrait-il pouvoir mettre les mots sur des formes permettant à la fois la lisibilité du réel narré et sa plausibilité. La forme questionne l’hégémonie du sujet dans la phrase, et créé l’espace aux compléments d’objet, aux champs lexicaux et verbaux pour défier le champ de la signification, et, partant, des interprétations.
Quid de l’ironie ?
Charles Gueboguo : Dans la forme, l’ironie permet de travestir le réel, donne la possibilité également au grotesque d’éclore. C’est ce qui reste dans le souvenir du lecteur et de la lectrice comme trace indélébile du récit. L’intention est de commander l’action, peu importe qu’au final la lectrice y réagisse ou pas. L’intention d’impacter de l’auteur ici c’est la finalité.
Le roman n’étant pas le réel, mais sa partie peu ou prou sublimée, le rêve devient dans mon art ce qui fait la fictionnalité du récit qui est porté, ce d’autant plus qu’il s’inspire d’un réel connu, et que dans l’art romanesque, il doit se départir de l’approche journalistique et anecdotique.
Charles Gueboguo
Et le rêve ?
Charles Gueboguo : La part du rêve est très importante parce qu’elle m’a permis de mettre en scène ce qui aurait été invraisemblable autrement. Qui plus est le rêve, c’est le ressort des possibles et des impossibles. Le roman n’étant pas le réel, mais sa partie peu ou prou sublimée, le rêve devient dans mon art ce qui fait la fictionnalité du récit qui est porté, ce d’autant plus qu’il s’inspire d’un réel connu, et que dans l’art romanesque, il doit se départir de l’approche journalistique et anecdotique.
Comment qualifieriez-vous votre travail littéraire ?
Charles Gueboguo : Je ne le qualifie pas, j’écris avec des intentions bien précises de dénoncer, de questionner mes espaces. Le soin est laissé aux analystes de faire leur travail pour évaluer comment l’écrivain y arrive.
Des projets littéraires en cours ?
Charles Gueboguo : Je travaille sur mon second roman qui porte sur la quête de Dieu et les identités des êtres, la mort. Il s’agit d’une autre forme d’exploration de vivre sans les dieux imposés, et de l’inutilité de la mort.
Le métier d’écrivain ne va pas sans risques, puisqu’il bouscule les acquis, travestit toutes les pentes glissantes des marges, appelle à l’action fût-elle passive.
Charles Gueboguo
Que représente la littérature pour vous ?
Charles Gueboguo : Un vaste champ d’expérimentation. Elle peut faire tout ce que la politique de ses moyens lui donne de faire, au moment que les sujets jugent opportun de le faire : prescription, proscription, injonction, interjection, dénonciation, proclamation. Elle chante à son tempo, impose son rythme, dispose son crédo, découvre son agenda dans le sens de programme politique. Son dire est tout sauf apolitique, puisque intéressé.
Faire de la littérature « politique » s’avère pourtant compliquée de nos jours…
Charles Gueboguo : Le métier d’écrivain ne va pas sans risques, puisqu’il bouscule les acquis, travestit toutes les pentes glissantes des marges, appelle à l’action, fût-elle passive. Il y a parfois un prix à payer, c’est notre liberté, notre santé, notre confort, nos connexions. Ça libère d’en être conscient.
Quels sont les auteurs qui vous ont permis de vous construire ?
Charles Gueboguo : Mongo Beti et Ahmadou Kourouma.
Lisez-vous de la bande dessinée ? Quels sont vos autrices et auteurs préférés ?
Charles Gueboguo : Je lis et j’enseigne la bande dessinée parmi de nombreux autres genres littéraires, comme la poésie, le genre épistolaire ou l’autofiction. J’aime beaucoup les livres de Marguerite Abouet et l’œuvre de René Goscinny.
Quel regard portez-vous sur les débats définitionnels qui remettent en cause la littéralité de la bande dessinée ?
Charles Gueboguo : La bande dessinée appartient à ce qu’on désigne en littérature au genre graphique, qui a ses codes qui lui sont propre. On parle du vocabulaire de la bande dessinée. Une planche désignera par exemple une page de B.D., qui elle-même sera composée d’une ou plusieurs bandes, elles-mêmes subdivisées en vignettes ou cases, lesquelles pourraient comprendre des bulles ou phylactères contenant les paroles ou pensées des personnages souvent retranscrites dans le style direct. Pour savoir qui parle, un appendice sera relié à chaque personnage, tandis qu’une cartouche au-dessus des bulles contiendra des éléments narratifs ou descriptifs portant la voix du narrateur. S’il y a une narration, c’est dire qu’il y a un récit qui se servira d’éléments visuels, descriptifs ou narratifs. Je parle d’un tableau en mouvement (ou figé, ce sera selon) duquel on peut ressortir un ensemble varié de procédés linguistiques et sémiotiques qui font sens. Ils se prêteront à la signification, et donc à une analyse ekphrastique. Pour moi, la question de la littérarité de la bande dessinée, à partir de ce qui précède, est une lapalissade.
Quels conseils donneriez-vous à ceux qui ont envie de se lancer en littérature ?
Charles Gueboguo : Lisez tout ce que vous pouvez, remettez tout en question (même ce que je viens de dire), mais surtout formez-vous au métier de l’écriture. C’est un travail. Le mot travail vient du latin tripalium qui signifie instrument de torture. Le travail d’écriture est un instrument de torture qui demande de l’abnégation, qui commande l’humilité, qui impose une certaine rigueur. L’exercice est la clé, elle fait apparaitre la plausibilité du récit. Cela passe par un palimpseste d’écriture : superposition, rature, écriture, réécriture, gribouillage. Le talent ne suffit pas. Il ne vous servira pas sans la lecture et le travail harassant. Une fois que vous aurez pris l’habitude de lire et de travailler, vous vous rendrez compte que le talent n’est d’aucune utilité pour un travail littéraire de qualité.
