À travers l’histoire d’amitié de deux jeunes femmes, la primo-romancière Zineb Mekouar publie un texte probant sur le classisme au Maroc. Une démarche qui lui permet de s’inscrire dans la lignée de Tahar Ben Jelloun et Abdellah Taïa, deux ainés qui interrogent formidablement comme elle, les tabous et contradictions du royaume. Entretien.
Comment écrivez-vous ?
Zineb Mekouar : Je n’ai pas besoin d’un endroit particulier pour écrire. Il me suffit d’être dans ma bulle avec de la musique que j’aime, notamment celles de Léonard Cohen, Tracy Chapman, ou du rock. La musique me procure un sentiment de bien-être. Grâce à elle, je me sens protégée pour aller à la quête des mots. Pour écrire ce roman, j’ai travaillé deux ou trois heures par jour sur mon ordinateur qui est mon principal outil de travail. Les prises de notes sont, elles, souvent faites sur un carnet.
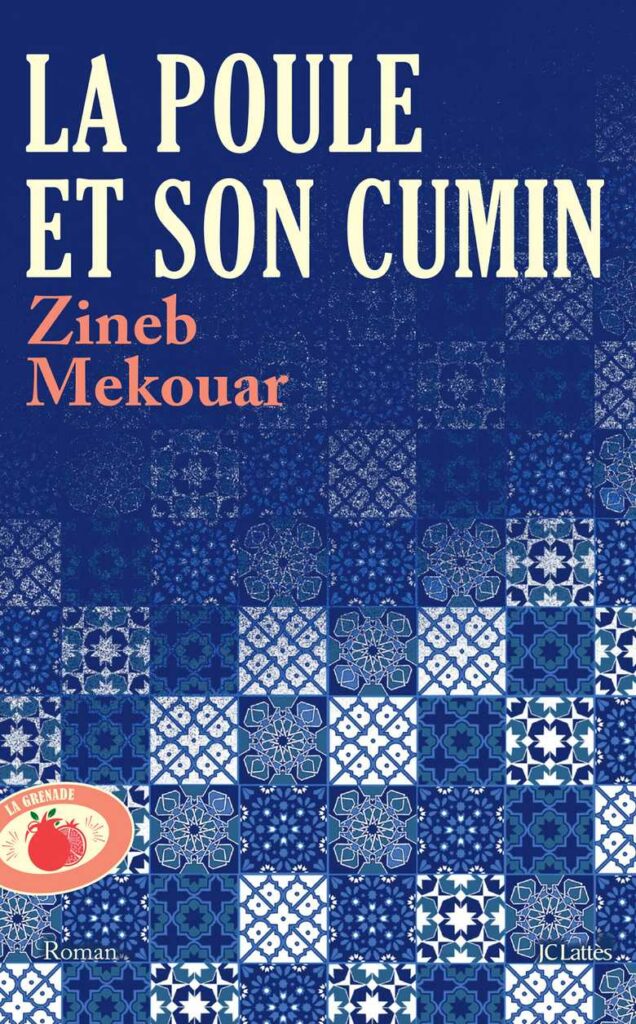
À travers l’amitié de deux jeunes femmes, votre premier roman (La Poule et son cumin) met l’accent sur les disparités sociales au Maroc. D’où vous est venue l’idée d’écrire ce texte ?
Zineb Mekouar : Ce sont des thèmes que j’avais depuis longtemps, mais je ne parvenais pas à trouver une histoire pour les mettre en exergue. Il m’a fallu dix ans pour trouver une histoire qui me convenait. La lutte des classes est une réalité au Maroc. Je voulais aborder ce sujet à travers l’amitié de deux jeunes femmes issues de milieux sociaux différents pour montrer à quel point elle impactait le quotidien, et à quel point il était difficile de la combattre.
Justement, le livre montre la violence avec laquelle ce classisme s’exerce même dans l’intimité…
Zineb Mekouar : Encore aujourd’hui au Maroc, souvent, les gens ne se marient qu’entre eux, au sein de la même classe sociale. Dans le roman, Karim ne peut pas concevoir une union avec Fatiha même s’ils ont régulièrement des relations sexuelles. Il la voit toujours comme la fille de la femme de ménage, alors qu’elle est désormais une infirmière. Elle subit l’histoire de ses parents. C’est une situation encore très prégnante au Maroc, et généralisée. Que ce soit dans l’intimité amoureuse ou amicale. Malgré leur forte amitié, Fatiha et Kenza ne se mélangent jamais lorsqu’il y a les amies de cette dernière. Leurs amitiés redeviennent belles et pures uniquement quand elles se retrouvent seules, toutes les deux. Dès qu’il y a du monde, Fatiha se remet à faire le service sans pour autant remettre en question cette situation comme Kenza. Le seul qui lui fait comprendre l’incongruité de ce traitement est le médecin lorsqu’il lui dit que ce qui compte, ce n’est pas le lieu d’où l’on vient, mais notre futur. Celui-ci se soustrait aux règles uniquement parce qu’il est d’origine étrangère. Les Marocains, même ceux de l’étranger perpétuent encore trop souvent ce système.
Je voulais vraiment mettre en lumière la façon dont les personnes qui promeuvent des idéaux d’égalité et de justice finissent trop souvent par rentrer dans ce système inégalitaire, voire à le faire perdurer.
Zineb Mekouar
À travers l’évocation du révolutionnaire Medhi Ben Barka et les velléités d’activisme de Mamoun ou du grand-père dans sa jeunesse, le livre met effectivement en exergue la difficile éradication de ce système inégalitaire…
Zineb Mekouar : Ce que je voulais montrer à travers ces personnages, c’est vraiment la rigidité du système. Ces personnages se battent courageusement pendant plusieurs années avant de baisser les bras. Soit, parce qu’on leur crache dessus, métaphoriquement et pour de vrai, soit parce qu’ils sont rattrapés par leurs classes sociales. Je voulais vraiment mettre en lumière la façon dont les personnes qui promeuvent des idéaux d’égalité et de justice finissent trop souvent par rentrer dans ce système inégalitaire, voire à le faire perdurer. Il y a certainement des explications sociologiques au phénomène. Je garde néanmoins espoir et fais confiance à la jeunesse actuelle marocaine, qui s’instruit, se documente, milite malgré les difficultés, pour faire bouger les choses. Le Maroc vit un moment charnière et je suis une éternelle optimiste. Plus nous serons nombreux dans la société civile à prendre position, plus les choses bougeront.
Ce roman est une fiction. Bien sûr, certains ressentis sont tirés de mon expérience. Par ailleurs, le personnage qui pourrait le plus s’approcher de moi serait Kenza.
Zineb Mekouar
Toujours à travers ces deux personnages, le livre dresse un portrait de la condition féminine au Maroc et les effets du déracinement. Pourquoi avez-vous choisi d’aborder ces différents sujets dans un même livre ?
Zineb Mekouar : Pour un projet d’études à Sciences Po, je suis allée au Maroc rencontrer plusieurs femmes dans les grandes villes et campagnes. Ce qui m’a choqué, c’est le fait qu’elles-mêmes n’étaient pas toujours conscientes de leurs droits et des changements en cours. Certaines pensaient même que les projets de loi qui étaient étudiés à cette période au sein de l’assemblée allaient les amoindrir, réduire leurs chances de trouver un mari. Je pense notamment à la grande réforme de 2004 qui a permis aux femmes de divorcer. Ce droit était perçu par beaucoup comme une catastrophe. Il y a aussi énormément d’avortements clandestins au Maroc. Les femmes sont souvent entre la vie et la mort, des bébés sont retrouvés dans la poubelle. Malgré cette réalité, le sujet reste tabou. Ce sont des réflexions que j’ai toujours voulu partager. J’ai pu le faire aujourd’hui à l’aide du roman.
Lorsqu’il y a eu en 2011, l’adoption de la circulaire Guéant (abrogée par le gouvernement en 2012) qui a permis d’expulser de nombreux étudiants étrangers, je n’ai pas été personnellement touchée mais plusieurs grands frères et sœurs de mes amis se sont subitement retrouvés virés de France et contraints de tout quitter. Ça m’avait marqué de voir ces gens renoncer à leur boulot, leurs copains du jour au lendemain. C’est l’un des grands thèmes du livre. J’ai trouvé intéressant de l’aborder pour montrer les conséquences du déracinement subi sur une vie.
Quelle est la part autobiographique de ce texte ?
Zineb Mekouar : Ce roman est une fiction. Bien sûr, certains ressentis sont tirés de mon expérience. Par ailleurs, le personnage qui pourrait le plus s’approcher de moi serait Kenza. Nous avons en commun le même parcours scolaire et la perte de notre grand-mère qui était une grande fan de la littérature française. J’ai donné au personnage de la grand-mère, le surnom que je donnais à la mienne parce que quand j’étais petite, celle-ci me disait sa hâte à lire mes livres. Nous avons néanmoins des différences. Elle est orpheline et fille unique alors que mes parents sont vivants, et j’ai 4 frères et sœurs. Elle entretient cette forte amitié avec Fatiha que je n’ai pas du tout vécue. Elle s’est faite expulser de France contrairement à moi puisque je suis française.
Camus a un style très poignant, cru et en même temps lumineux. Il donne à voir une histoire sans jamais donner son avis.
Zineb Mekouar
Parmi vos auteurs préférés figurent Mario Vargas Llosa, Albert Camus et Romain Gary. Qu’est-ce qui vous plaît dans leurs littératures ?
Zineb Mekouar : En lisant certains auteurs, on a parfois l’impression d’être à la maison. Mario Vargas Llosa, Camus et Gary font partie de ces auteurs dont j’aime à la fois les livres, le style et les thèmes. Camus a un style très poignant, cru et en même temps lumineux. Il donne à voir une histoire sans jamais donner son avis. C’est une écriture coup de poing sans fioritures, sans longues phrases, sans excès de détails qui me bouleverse. À chaque fois que je lis Mario Vargas Llosa, j’ai l’impression de découvrir une nouvelle partie du monde. Il me fait découvrir des réalités sociales, historiques, politiques, et même économiques sans lourdeur, et sans que cela ne prenne le pas sur la fiction. C’est une caractéristique que j’ai modestement essayé de transposer dans mon texte où au-delà de l’amitié entre Kenza et Fatiha, le livre montre les effets de la lutte des classes, la question de la femme, les luttes pour davantage d’égalité. Romain Gary s’inscrit dans la même lignée que ces auteurs dans Les racines du ciel notamment.
Qu’en est-il de Marguerite Duras ?
Zineb Mekouar : C’est une autrice que j’ai découverte tardivement. Lorsque je l’ai lue, je suis devenue immédiatement boulimique de ses livres, notamment Moderato cantabile qui est d’une pure beauté et Écrire dans lequel elle parle de son rapport à l’écriture. Je lis en ce moment Des journées entières dans les arbres qui est également très beau. Il y a une sensibilité dans son écriture qui me bouleverse. Elle pourrait me raconter n’importe quel sujet, je la lirai, même s’il ne se passe rien. C’est une autrice que j’ai envie de lire à voix haute. Son œuvre est très théâtrale, très intime, très belle.
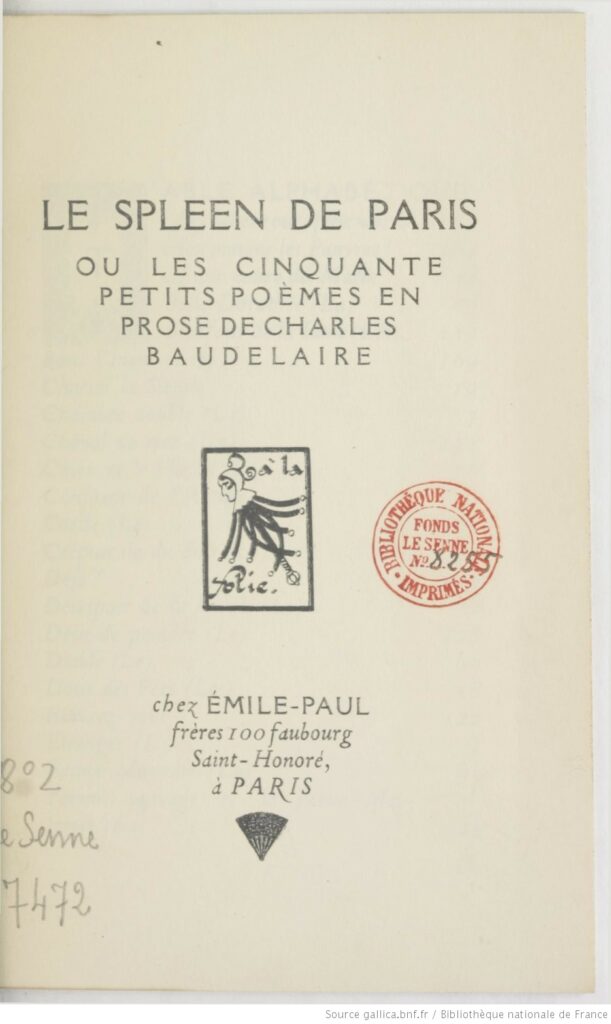
Et Baudelaire souvent cité dans le roman à travers l’attachement du personnage au Spleen de Paris, le livre préféré de sa grand-mère ?
Zineb Mekouar : Le Spleen de Paris était le livre préféré de ma grand-mère. Lorsque je n’arrivais plus à écrire, à donner une suite à certains chapitres, je le prenais dans ma bibliothèque pour lire l’écriture de ma grand-mère qui mettait de petites annotations. Le simple fait de voir son écriture me revigorait, me permettait de continuer. C’est un livre que je lisais beaucoup adolescente en rêvant de venir faire mes études à Paris. Il y a une mélancolie chez Baudelaire qui me touche. J’aime bien ce va-et-vient entre la noirceur et la tristesse qu’il essaie de rendre lumineuses par l’art. Il y a une forme de spiritualité dans sa poésie. Les poètes sont les prophètes du beau. Que ce soit Baudelaire, Rimbaud ou Verlaine, ce sont des auteurs qui me touchent. Je suis arrivée à la littérature par la poésie. Même la musique, c’est pour moi de la poésie.
La protagoniste du livre semble également vouer un culte au portrait d’une ballerine qui ressemble aux danseuses de Degas…
Zineb Mekouar : Il y a eu un clin d’œil aux danseuses de Degas ainsi qu’au tableau d’une ballerine que j’avais trimballé durant plusieurs déménagements. En écrivant, je me suis dit que ce serait intéressant de rendre hommage à Degas, un peintre que j’aime beaucoup et à la peinture. J’ai une mémoire très visuelle. Ce qui me permet de décrire avec précision les lieux, les odeurs et les saveurs. En revanche, il n’y a pas beaucoup de descriptions physiques. C’est un parti-pris. Je voulais que chacun mette la tête qu’il souhaite aux personnages pour rendre l’histoire universelle.

Qu’est-ce qui vous plaît dans l’écriture ?
Zineb Mekouar : J’écris parce que je ne peux pas faire autrement. Quand il y a des événements incompréhensibles, des moments durs, c’est par les mots que je parviens, non pas à justifier la réalité, mais à l’apaiser, à l’accepter, et à la transformer pour mieux la comprendre. Ça a toujours été mon mode de fonctionnement. Je pense qu’on écrit parce qu’il y a cette pulsion-là. Dans mon cas, je suis un peu obligée. Soit, j’écris, soit je deviens dingue.
Vous avez une conception cathartique de l’écriture ?
Zineb Mekouar : L’écriture me permet d’atténuer et non de guérir les douleurs. C’est comme un baume apaisant. J’aborde des sujets très durs, très violents et injustifiables dans le roman. En mettant des mots dessus, je perçois une forme d’apaisement.
Les dialogues apparaissent sans tirets afin qu’il y ait une continuité dans le rythme, que le lecteur soit pris dans un tourbillon, continue dans un rythme effréné pour mieux saisir la fougue et les envies de liberté de cette jeunesse marocaine bridée par des carcans…
Zineb Mekouar
Quel est votre rapport aux langues et à la forme ?
Zineb Mekouar : La langue est un personnage. Le fait qu’il y ait ce vagabondage entre les langues était une manière de montrer la richesse du Maroc qui est un carrefour de civilisations. Kenza ne parle que le français, Fatiha, elle, lui répond en arabe, Rayan a un Français mélangé à de l’argot, le médecin est espagnol. J’avais envie de faire voyager les lecteurs dans cette géographie de langues… Le livre a une forme très rythmée, les dialogues apparaissent sans tirets afin qu’il y ait une continuité dans le rythme, que le lecteur soit pris dans un tourbillon, continue dans un rythme effréné pour mieux saisir la fougue et les envies de liberté de cette jeunesse marocaine bridée par des carcans, des lois désuètes, le poids des traditions, le regard social…
Comment qualifierez-vous votre travail littéraire ?
Zineb Mekouar : Il est peut-être très tôt pour parler de travail littéraire me concernant, je parlerais plutôt d’espérances littéraires. Les thèmes qui m’intéressent sont liés au monde d’aujourd’hui. J’aimerais poursuivre mes réflexions sur des thèmes intemporels comme l’injustice, la misère, le déracinement, le rapport aux frontières.
Un dernier mot sur la littérature ?
Zineb Mekouar : Sans la littérature, ma vie n’aurait pas de sens. Lire et écrire me permettent de donner un sens à ma vie.
