De par sa composition, ses œillades sans cesse renouvelées au cinéma et à la photographie, le caractère incantatoire du récit qui se lit comme un conte, le livre d’Étienne Kern nous subjugue telle une œuvre d’art totale dont il est à la fois le compositeur et le contemplateur.
Parler d’œuvre d’art totale serait tout sauf une exagération tant le livre d’Étienne Kern allie admirablement différents arts pour décrire la vie parisienne de Franz Reichelt, tailleur pour dames fasciné par le progrès scientifique en cours dans la capitale française au point de se considérer inventeur. Dans ce tableau brossé sans jugement envers cet « Icare des temps modernes », le narrateur documente également la vie des travailleurs modestes, le regard peu amène porté sur les femmes qui s’émancipent après le décès d’un époux, l’attrait des inventeurs pour les aéroplanes et divers événements ayant bouleversé le parcours de l’auteur. Ces évocations offrent tour à tour un portrait fragmentaire de la société française de la Belle Époque, une succincte autobiographie de ceux qui n’ont pu écrire , une méditation sur le deuil ou encore un hommage à la photographie et au cinéma qui ont permis de figer l’image de Franz Reichelt pour la postérité. Entretien avec Étienne Kern.
Pourquoi écrivez-vous ?
Étienne Kern : Je crois que si je le savais, je n’écrirais pas. « Parce que… », comme disait Cendrars…

À l’occasion de la rentrée littéraire 2021, vous avez publié un ouvrage sur Franz Reichelt, l’inventeur du costume-parachute décédé après une expérimentation ratée en 1912. Quelle est la genèse de ce texte ?
Étienne Kern : Il est né d’un hasard, ou plutôt d’une rencontre. Il y a quelques années, sur internet, je suis tombé sur un court-métrage de 1912 que je n’avais jamais vu : on y voit cet homme, Franz Reichelt, sauter du premier étage de la tour Eiffel. Les images de sa mort en direct m’ont tellement fasciné et ému que le sujet du roman s’est imposé à moi : c’était cet homme, pas le fait divers en lui-même, mais l’être de chair et d’os, notre semblable, qui a été assez fou pour faire le grand saut. J’ai commencé par réunir des images et documents d’archives (grâce aux journaux d’époque, numérisés sur Gallica, le site de la BNF), puis j’ai commencé à décrire le court-métrage et petit à petit le texte s’est étoffé.
À travers cette histoire, vous abordez brièvement différents événements personnels : la mort accidentelle d’un aïeul, la défenestration d’une amie… Pourquoi ?
Étienne Kern : J’ai voulu me tenir au plus près de l’émotion que m’inspire ce film de 1912. Et dans cette émotion, entre pour beaucoup le souvenir de deux personnes : mon grand-père, mort en tombant d’un balcon quelques années avant ma naissance, et une camarade d’études qui, très malade, a fait le choix de sauter par la fenêtre de son appartement. Quand je vois cet homme en noir et blanc, je les vois eux aussi. Dans ma mémoire comme dans mon texte, ces trois chutes, la chute spectaculaire et mystérieuse de Franz Reichelt, la chute accidentelle de mon grand-père et la chute voulue de mon amie se répondent.
Écrire vous a-t-il permis de « guérir » de ces tourments ?
Étienne Kern : Je ne sais pas. Ma seule certitude est que je n’éprouve plus ce besoin de regarder en boucle le saut de Franz Reichelt : mettre des mots sur son histoire et surtout sur le deuil a dû apaiser quelque chose.

Tout au long du texte, vous convoquez différentes photographies et extraits d’un film muet pour décrire votre rencontre avec les personnages, transmettre un surcroît d’informations sur eux et leurs créations… Pourquoi ?
Étienne Kern : L’image, photographique ou cinématographique, est effectivement au cœur de mon récit. J’aime ce mot de « rencontre » que vous employez : les différentes descriptions sont justement là pour attester l’existence de Franz Reichelt et des autres personnages (ou plutôt personnes) photographiés. Ce que les photos nous disent, c’est qu’ils ont été vivants et ne le sont plus. C’est d’ailleurs les derniers mots du roman, « ils ont été », sorte de fusion entre une formule de Barthes (le « ça a été » que dit selon lui toute photographie) et, pour le rythme, le « ils ont aimé » du Lac de Lamartine. J’ajoute que les descriptions d’images fonctionnent aussi comme des pauses dans le récit, pour le fragmenter et surtout le mettre en perspective, un peu comme les passages choraux dans une tragédie grecque.
Outre le refus de la linéarité, la présence d’ellipses, la concision de certains chapitres qui se lisent comme des gags, ou encore l’évocation de figures mythiques (Charlie Chaplin, Buster Keaton) et la mort spectaculaire de Franz Reichelt ; le livre semble multiplier les œillades au cinéma. Doit-on penser qu’il est construit comme un film muet dont vous êtes à la fois le réalisateur et le spectateur ?
Étienne Kern : J’aime ce rapprochement ! Évidemment, il demande à être quelque peu nuancé, ne serait-ce que parce qu’il y a des dialogues dans le texte et plus généralement parce que j’ai eu à cœur de prêter une voix à cet homme que nous n’entendons pas crier dans sa chute, mais il est vrai que mon récit fonctionne un peu comme un vieux film muet en noir et blanc. Il en a le côté saccadé, réduit à l’essentiel, expressionniste parfois. Surtout, il essaie de ne pas trop en dire – de suggérer.
Le critique Johan Faerber a qualifié mon texte d’« autobiographie oblique », ce qui me convient tout à fait. C’est aussi, d’une certaine manière, un conte, ou peut-être un « récit poétique »…
Étienne Kern
Dans quel genre se situe-t-il ?
Étienne Kern : C’est un roman, étant entendu que le roman – que Baudelaire qualifiait de « bâtard » et Aragon de « bordel » – est la forme hybride par excellence et qu’il échappe à toute définition. Le critique Johan Faerber a qualifié mon texte d’« autobiographie oblique », ce qui me convient tout à fait. C’est aussi, d’une certaine manière, un conte, ou peut-être un « récit poétique » (pour reprendre cette catégorie générique définie par Jean-Yves Tadié). Il y a aussi une formule de Virginia Woolf qui me parle beaucoup et qui correspond bien à ce qui m’intéresse dans l’écriture et la lecture : « élégie psychologique ».
Quelle place occupe la forme dans votre travail littéraire ?
Étienne Kern : J’enfonce une porte ouverte en disant cela, mais la question formelle me paraît si profondément liée au choix d’un sujet que je ne saurais lui assigner une place en particulier. Elle n’a pas seulement une place dans le travail littéraire, elle est le travail littéraire. Et dans le cas de ce roman, j’ai voulu que la forme soit aussi dépouillée que possible. Je tiens à une certaine discrétion dans le choix des mots, à une certaine retenue. Il me semble que c’est la condition de l’émotion. Et puis c’est une tentative pour ne pas trahir la candeur de Franz Reichelt.
La délicatesse, la suggestion sont plus puissantes que l’affirmation péremptoire. J’aime que les livres, par la fragmentation, le dépouillement ou les marges blanches, laissent de la place à leurs lecteurs.
Étienne Kern
Quels sont les textes et auteurs qui vous ont permis de vous construire ?
Étienne Kern : De nombreux livres m’ont accompagné pendant l’écriture des Envolés, des Années d’Annie Ernaux (pour le rapport à la photographie et à la vidéo) aux poèmes de Philippe Jaccottet, en passant par des romans de l’épure, comme Soie d’Alessandro Baricco, Tous les matins du monde de Pascal Quignard, L’Or de Cendrars ou tout Kawabata. J’admire infiniment ces romans qui disant tant de choses avec si peu de mots : la délicatesse, la suggestion sont plus puissantes que l’affirmation péremptoire. J’aime que les livres, par la fragmentation, le dépouillement ou les marges blanches, laissent de la place à leurs lecteurs.
Quid de Roland Barthes que vous citez souvent dans vos essais pour illustrer certains propos, introduire certaines réflexions ?
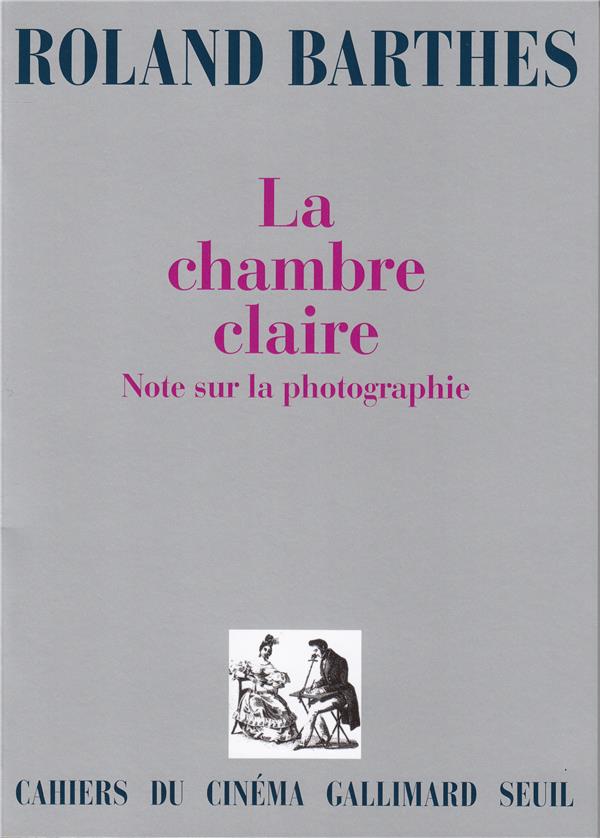
Étienne Kern : Il est très présent dans Les Envolés, entre les lignes. Il y a cette phrase de lui qui dit que le milieu du chemin de la vie (formule de Dante), c’est le moment où l’on cesse de se savoir mortel pour se sentir mortel. Surtout, ma manière d’envisager les photographies prises de Reichelt en 1912 a été déterminée par ma lecture de La Chambre claire, et notamment par les passages où Barthes distingue le studium, qui est l’attirance qu’on peut éprouver devant une photo belle et/ou intéressante historiquement, et le punctum, qui est un ébranlement affectif très personnel. L’histoire de l’aviation, la tour Eiffel, la beauté des photos, c’est le studium ; mais la présence de mon grand-père et de mon amie qui s’est suicidée, c’est le punctum. Et je songeais en particulier à ce que dit Barthes de la photo de Lewis Payne, le condamné à mort saisi par l’objectif juste avant son exécution : « Il est mort et il va mourir ». L’homme est mort depuis des lustres puisqu’il apparaît sur une vieille photo en noir et blanc, il appartient au passé, et en même temps la mort, pour lui, est encore un futur. « C’est la découverte de cette équivalence », explique Barthes, qui crée le punctum. Ce qui est vrai du condamné l’est aussi de Franz Reichelt…
Pourquoi ne pas avoir publié ce texte sous forme d’essai ?
Étienne Kern : J’ai envisagé à un moment d’écrire un essai, un petit livre un peu savant sur Reichelt. Mais j’y ai renoncé très vite, parce qu’il en existe déjà un (Un tailleur pour dames au temps des aéroplanes, de David Darriulat), mais surtout parce que la forme romanesque permettait de ne pas réduire Reichelt à un objet d’enquête ou de savoir, mais de faire de lui un objet de tendresse et d’empathie. La fiction confère plus d’humanité aux objets dont elle s’empare. Elle rend le monde, les choses, les êtres présents – c’est-à-dire plus mystérieux.
Outre votre statut d’auteur, vous êtes également professeur de lettres en classes préparatoires. Le fait d’enseigner et d’analyser la littérature à partir de textes théoriques change-t-il quelque chose à votre regard, votre plaisir de lecteur ?
Étienne Kern : Il est vrai que ma profession m’encourage ou me condamne à jeter un regard analytique sur les textes que je lis. Est-ce que cela change quelque chose au plaisir que j’éprouve à lire ? Je crois que c’est effectivement le cas : ce plaisir est redoublé. Au plaisir de découvrir une histoire peut s’ajouter celui d’admirer la maîtrise technique.
Les livres qui ont précédé Les Envolés et que j’ai, pour l’essentiel, co-écrits avec mon épouse Anne Boquel, sont faciles à qualifier : il s’agit de transmettre un émerveillement devant la littérature.
Étienne Kern
Quel est votre rapport aux langues ?
Étienne Kern : Hélas un rapport lointain car, même si j’ai une certaine familiarité avec l’allemand (mes parents parlent alsacien entre eux), je suis bien incapable de soutenir une conversation dans une autre langue que le français. C’est par ailleurs l’une des choses qui m’ont le plus touché chez Franz Reichelt : le testament qu’il a écrit la veille du saut montre qu’il ne pouvait s’exprimer que dans un français très approximatif, où la syntaxe et l’orthographe sont très marquées par sa langue maternelle, l’allemand. Cet homme, manifestement, avait du mal à se faire comprendre – de même qu’il n’a pas réussi à faire comprendre ce qu’il voulait faire avec ce parachute qui ne pouvait pas fonctionner. La langue était comme le signe de son isolement. Et sans doute instillait-elle de la douleur dans son rapport aux autres.
Comment qualifierez-vous votre travail littéraire ?
Étienne Kern : Les livres qui ont précédé Les Envolés et que j’ai, pour l’essentiel, co-écrits avec mon épouse Anne Boquel, sont faciles à qualifier : il s’agit de transmettre un émerveillement devant la littérature, c’est-à-dire, au fond, de prolonger l’activité pédagogique. Pour Les Envolés, je ne sais pas trop quoi vous répondre, je manque de recul. Je vais me cacher derrière la réponse d’une autrice que j’admire, Olga Tokarczuk : l’écriture, dit-elle, est d’abord une affaire de « tendresse ».
D’autres projets littéraires en cours ?
Étienne Kern : Un deuxième roman, qui n’en est qu’à ses balbutiements…
Que représente pour vous la littérature ?
Étienne Kern : Une parole adressée.
