Auteure et oratrice de talent, Fatou Diome confirme avec la publication de ce nouvel ouvrage, s’articulant autour de maints sujets brûlants (identité, immigration, islam), la continuation d’une œuvre marquée à la fois par l’esprit des Lumières et la philosophie de Senghor. Des influences qu’elle convoque savamment sous sa plume teintée de révolte et d’humour pour aborder l’actualité politique, le quotidien des exilés, la condition des femmes, et toujours la rencontre avec l’autre. Véritable « ode à la joie », Marianne face aux faussaires se lit agréablement comme un appel à la fraternité malgré les sujets graves développés par l’auteure. Entretien.
Pourquoi écrivez-vous ?
Fatou Diome : J’écris parce que c’est ma manière d’être au monde, d’essayer de comprendre le monde, de poser des questions, de partager mes rêves et révoltes.
Depuis la parution de votre premier roman (Le ventre de l’Atlantique) en 2003, vous retracez dans la majorité de vos textes la vie et le parcours d’hommes et femmes en exil. Pourquoi ?
Fatou Diome : Parce que j’en fais partie. C’est aussi mon histoire même si je ne me sens pas en exil puisque je suis parti de chez moi pour une histoire d’amour. Je ne fuyais aucune tragédie, ni guerre ni famine. C’est quand mon histoire d’amour s’est terminée et que ma situation s’est dégradée que j’ai découvert la triste vie des immigrés, et des exilés.
À travers ces récits, vous abordez également d’autres sujets : le traitement différencié des étrangers en Occident selon leurs origines et nationalités, les obstacles liés à l’exil, les attentes des familles en Afrique…
Fatou Diome : Oui, parce qu’il faut dire la vérité des deux côtés de l’atlantique. Je n’ai jamais pensé à embellir ou à cacher les choses, car je tiens à être honnête sur ma vie. Quand je vais en Afrique et que les gens me parlent de la vie en Occident, je leur dis exactement ce que je sais, ce que j’ai vécu, ce que j’ai vu. Je pense que c’est à nous de dire la vérité à ceux restés aux pays qui fantasment l’Europe. Il y a des personnes qui sont nées ici, mais sont dans la galère quand ils n’ont pas de diplômes. Imaginez la situation d’un immigré. Surtout, s’il ne parle pas la langue, et n’a pas de diplôme ni de formation professionnelle.
Pour moi leur dire la vérité, c’est en quelque sorte les protéger de la déception, de la désillusion, de la douleur d’être en exil avec des choses plus tristes que ce qu’ils avaient imaginé. C’était aussi pour enlever le mensonge des migrants. Certains immigrés qui vivent ici sont dans la galère, mais quand ils rentrent au pays, ils font les pachas. Les voisins et cousins qui assistent à ce spectacle auront envie d’emprunter le même chemin qu’eux. Surtout si la personne en question ne leur dit pas dans quelle galère il vit en Europe. C’est pour cela que j’aborde ces sujets, car pour moi tromper les siens, c’est criminel. C’est les induire en erreur et les conduire vers la tragédie et la déception. Lorsque je suis arrivée ici, je me suis rendu compte que lorsque vous êtes noire, même surdiplômée, on vous refuse plein de boulots sans la moindre explication. Il m’a fallu des années pour saisir cette réalité, puisque malgré un bac +5, il m’était difficile de trouver du boulot. Pendant sept ans, j’ai gagné ma vie en tant que femme de ménage. C’est comme ça que j’ai terminé mes études. Même lorsque j’étais chargée de cours à la fac, je faisais encore le ménage puisque ce que je gagnais ne suffisait pas. C’est pour ça que j’en parle parce que je l’ai vécu. Je sais que c’est dur, mais je dis aussi aux gens ce qui m’a sauvé. Il ne faut jamais se décourager. Il faut continuer à se battre. Si vous vous découragez, vous donnez raison à ceux qui discriminent.
Vos ouvrages évoquent aussi l’existence de ceux et « celles qui attendent ». Notamment les femmes (épouses et mères) qui cotisent souvent pour envoyer les hommes à l’étranger et se battent pour pourvoir à la subsistance du foyer en leur absence…
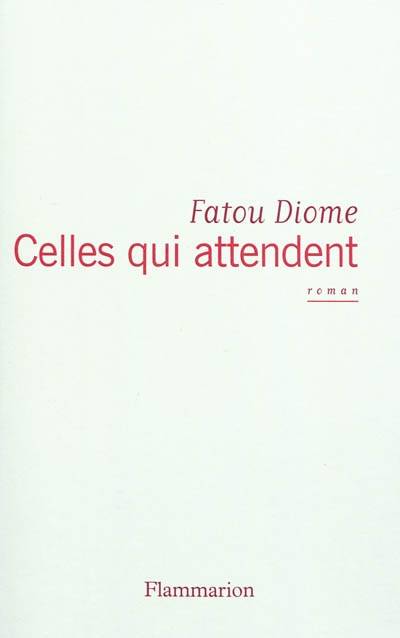
Fatou Diome : Féminisme ou pas, nourrir reste une astreinte faîte aux femmes. C’est toujours la maman que les enfants sollicitent lorsqu’ils ont faim. Ils ne se demandent même pas s’il y a à manger. Ces femmes, qui attendent, sont devant ce devoir de sauver la vie qu’elles ont donnée quand les hommes partent. Ce sont elles qui luttent au quotidien, qui voient la détresse des enfants, qui s’occupent des personnes âgées et doivent trouver des solutions lorsqu’il y a des problèmes. Les hommes qui sont partis ne sont pas là pour partager cette inquiétude permanente, cette lutte quotidienne dont j’ai fait le constat dans tous les pays africains que j’ai visités. Et parfois, ces femmes ne savent même pas la ville où sont leurs époux quand ces derniers n’ont pas de sous pour téléphoner. Comment vit-on quand on est amoureuse d’un homme et qu’on ne sait pas le lieu où il se trouve ? Comment vit-on alors qu’on ne sait même pas la prochaine fois qu’on le reverra ? Non seulement, elles n’ont pas toujours d’informations sur leurs époux, mais en plus, on leur demande d’être fidèles, d’être rangées, d’être des dignes épouses. C’est comme si elles juraient fidélité à leur chambre vide. En plus de cela, elles sont souvent au service de la belle-famille. Je trouve qu’il y a vraiment beaucoup de poids sur les épaules de nos sœurs en Afrique et c’est quelque chose qui m’émeut, me touche, parce qu’elles ont une force incroyable. Si on leur donnait la chance d’étudier, elles feraient des merveilles parce que ce sont des battantes. On devrait les encourager et les féliciter. C’est pourquoi j’ai écrit ce livre pour parler d’elles, leur rendre hommage. On parle toujours des hommes qui partent et qui souffrent la galère, le froid en Europe. Mais pas assez de nos sœurs qui se tiennent debout pour toute la famille.

Vous citez souvent Montaigne, Montesquieu et Voltaire comme étant des auteurs figurant dans votre panthéon littéraire. Qu’est-ce qui vous plait dans leurs littératures ?
Fatou Diome : Vous pourriez aussi mentionner Sembène Ousmane, John Steinbeck, Cheikh Anta Diop, Hemingway, Senghor, Bernard Dadié, Cheikh Hamidou Kane, Stig Dagerman, René Char, mon grand-père et bien d’autres. Ce qui m’intéresse chez chacune de ces figures, c’est leur philosophie, leur regard sur le monde et sur la condition humaine. Donc, l’origine d’un penseur, d’un écrivain m’importe peu, pour moi, le savoir humain est un grenier universel, donc, à la disposition de tous.
Qu’en est-il de Schiller ?
Fatou Diome : Poète et Philosophe, Schiller définit le rôle du poète dans la société, notamment, dans son poème Les Artistes. Et, bien que ses Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme datent du XVIIIème siècle, elles me semblent nécessaires à notre époque, puisqu’elles prônent l’éducation, la culture, le sens de l’esthétique et l’ouverture d’esprit. Schiller appelle l’humanité à la fraternité, il est donc, pour moi, un indémodable guide, tout comme son compatriote, Goethe, qui a théorisé la Weltliteratur, une littérature-monde qui se soucie de l’ensemble du genre humain.
Et Marguerite Yourcenar ?
Fatou Diome : J’admire sa grande érudition et la qualité de son style. La lire ou relire, c’est toujours apprendre.
Parmi les livres que vous aimez figure Une si longue lettre de Mariama Bâ, opuscule construit sur des récits de femmes vivant sous les affres de la polygamie en Afrique. Qu’est-ce qui vous plaît dans ce texte ?
Fatou Diome : Ce livre fait partie des premiers textes que j’ai découverts sur la situation des femmes. C’est pourquoi il est important dans mon parcours. Mariama Bâ est une observatrice du social. C’est une écrivaine sociologue qui regarde la réalité africaine telle qu’elle est, elle la décrit sans fioritures. Elle a une écriture proche de celle de Sembène Ousmane que j’ai eu la chance de rencontrer. C’est une pionnière, elle fait partie des aînées qui ont ouvert le chemin sur la condition des femmes.
Lire aussi : Une si longue lettre, le manifeste politique de Mariama Bâ
Quid du Vieil homme et la mer d’Ernest Hemingway, texte auquel vous rendez hommage dans Le vieil homme sur la barque ?

Fatou Diome : J’ai toujours ce livre avec moi comme un talisman. Dès que j’ai un blues, j’ouvre quelques pages et ça me fait du bien. Parce qu’il me rappelle mon grand-père pêcheur. C’est ma manière de garder la mer à côté de moi. Cette lutte des pêcheurs pour la survie. Cette façon d’affronter l’océan pour gagner sa croûte. Les pécheurs sont des gens déterminés, courageux, qui luttent avec leurs propres possibilités face à la nature pour conserver la dignité de leurs familles. Mon grand-père m’amenait à la pêche depuis très jeune sans aucune attention à mon genre. Il disait : « Matelot, viens, on y va » comme je l’explique dans le texte que vous évoquez. Je voulais aussi rendre hommage à Hemingway qui parlait d’un Vieil homme et la mer, donc face à la mer, qui lutte sur la mer. Moi, je parle d’un vieil homme que j’ai vu sur sa barque. Parce que j’y ai été. C’est de ce fait un hommage combiné à Hemingway et à mon grand-père. Quand j’étais jeune et que je suis parti en ville pour étudier, à chaque fois que je lisais ce livre, je pensais à mon grand-père. Je voyais son visage à la pêche. Je l’identifiais à cet homme. C’est aussi un hommage aux écrivains pour dire qu’ils partagent avec nous la condition humaine. Quelle que soit leur couleur, leur pays, leur origine. Hemingway ne sait rien de moi ni de mon grand-père. Pourtant, il a parlé de notre réalité. Il a créé des liens, des traits d’union entre les cultures pour former une grande famille de la condition humaine. C’est ce qui me plaît dans ce livre.
Ce livre, aurait-il pu être publié en 2022 avec les scandales d’appropriation culturelle qui agitent la scène littéraire internationale ?
Fatou Diome : Notre époque n’est pas fragile. Ce sont les gens qui ont une vision du monde étriquée qui sont fragiles face à leur époque. Ce sont des gens qui ne sont pas au courant de leur siècle. C’est très triste. Il faut avoir les yeux ouverts sur son époque. Prendre les réalités de son époque en compte. À l’heure où je vous parle, le monde entier se croise, se mélange, se rencontre et partage. On n’a jamais autant voyagé. On n’a jamais autant eu de proximité entre les peuples. En allant dans n’importe quel pays du monde, vous allez voir des gens venus de différents pays. Il y a un siècle, ce n’était pas aussi facile. Quelqu’un qui vit dans notre époque et qui rêve de diviser, de séparer les cultures, de sectionner les liens est une personne en retard. Il faut prier pour lui (rires !) et l’aider à vivre dans notre époque mondialisée. Les sectaires sont des malheureux. Les gens qui aiment découvrir les autres sont ravis parce que l’on peut rencontrer différentes cultures dans la même ville, dans le même pays. C’est une réelle force. Chaque peuple a des valeurs, des richesses que nous pouvons découvrir pour nous enrichir nous-mêmes. Comme disait Senghor :« il y a un rendez-vous du donner et du recevoir ». Nous Africains, nous ne sommes pas venus les mains vides. Nous avons aussi apporté des choses à la culture européenne. Et si la culture européenne nous a apporté de la violence d’abord avec l’esclavage et la colonisation, aujourd’hui elle nous apporte d’autres choses qui sont heureusement positives.
La culture de tout être humain, de tout pays est une somme d’acquis. Pour en acquérir un surcroît, il faut emprunter, prendre ailleurs.
Fatou Diome
Ces sujets font justement l’objet de votre récent essai, Marianne face aux faussaires. Comment ce texte est-il né ?

Fatou Diome : D’un coup de sang. J’en ai simplement eu assez de tout ce qu’on racontait sur l’identité française comme s’il s’agissait d’une pierre précieuse trouvée au fond d’une mine. Or, l’identité n’est pas monolithique. C’est un ensemble de choses qui s’ajoutent. La culture, d’après la définition de l’Unesco, elle est constituée d’acquis. La culture de tout être humain, de tout pays est une somme d’acquis. Pour en acquérir un surcroît, il faut emprunter, prendre ailleurs. C’est comme lorsque l’on compose sa bibliothèque. Si on n’ajoutait rien pour l’enrichir, elle serait vide. Pour moi, l’identité, c’est ça. C’est une somme de cultures qu’on fabrique au fur et à mesure de sa vie. Penser aujourd’hui que l’identité française est uniquement blanche, monolithique, homogène, et que tout le monde doit avoir la même ou courir le risque d’être considéré comme un Français de papier est ridicule. Le peuple de France n’a jamais été homogène. Ce pays est constitué de différents peuples : les francs, les Wisigoths, les Celtes, etc. Ce sont ces mélanges qui ont fait la grandeur de ce pays. On ne dira jamais aux celtes de rentrer en Écosse, car qu’est-ce qui les réunit à ceux qui prônent ce discours ? La couleur de peau. Les gens qui nous parlent d’identité tout le temps entretiennent une forme de racisme qui ne dit pas son nom. Quand ils parlent de Français de papier, c’est aux Français non-blancs qu’ils s’adressent. Ils ne parlent pas des Français qui sont venus d’Australie ou d’Amérique. Ils ne parlent que de ceux qui ne sont pas blancs. Il faut les renvoyer à l’histoire de ce pays pour leur dire qu’ils ont une idéologie mensongère, puisque la constitution dès son article premier dit que la République ne distingue pas les citoyens ni par leur origine ni par leur couleur ni par leur religion, elle respecte toutes les croyances. Si on respecte la République, on s’en tient à sa constitution. C’est la raison pour laquelle je les appelle les faussaires, car, ils font raconter à la République française ce que sa constitution ne dit pas, et même ce qu’elle refuse. Ce sont des falsificateurs de l’histoire. Des idéologues malintentionnés.
Comment lutter contre ces idéologues ?
Fatou Diome : Il suffit de s’inspirer de ceux qui nous ont précédés. Dans « I have a dream », son discours prononcé le 28 août 1963, Martin Luther-King explique qu’avant les cultures française, italienne, américaine ou allemande, il y a d’abord la culture humaine. C’est pourquoi je dis qu’il n’y a qu’une seule identification pour moi : l’humanité. C’est l’identité la plus complète. Si vous vous dites sénégalais, suédois, etc., sachez que vous partagez la condition humaine avec moi. Il faut d’abord apprendre à être un être humain. Parce que quand les gens sont convaincus de leur humanité, ils voient leurs points communs avec les autres humains d’où qu’ils viennent. La condition humaine nous fait souffrir pareillement. La détresse ne connaît ni de couleur, ni de frontières, elle ne prend pas de visa non plus. Le deuil ne connaît ni de couleur, ni de frontières et ne prend pas de visa. Les histoires d’amour qui nous font pleurer, chanter ou danser n’ont rien avoir avec la couleur. Quand elles arrivent, elles nous rendent heureux ou malheureux. Il faut que les gens s’interrogent. Les choses qui nous font vibrer en profondeur n’ont rien à voir avec la biologie. Parfois, vous êtes plus proche d’étrangers qui lisent vos livres que de gens de même gêne que vous mais qui méconnaissent votre œuvre. Ce partage-là est intime, culturel, intellectuel, dialectique. C’est comme si vous étiez du même pays ou du même village et que vous avez une famille élargie. C’est comme ça que je vis. J’ai des amis de pays différents et nous nous entendons bien. Pourquoi ? Peut-être parce que nous sommes tous éduqués, que nous avons eu la chance de voyager, de nous ouvrir au monde et de continuer d’apprendre. C’est pourquoi l’éducation est importante, même si je sais qu’il y a aussi des gens très bien éduqués qui sont racistes et soutiennent des extrémistes. L’éducation, ce n’est pas seulement l’école ou l’université, c’est aussi dans la famille qu’elle s’acquiert.

Pourquoi avoir choisi d’aborder ces sujets dans un essai et non dans un roman ?
Fatou Diome : Dans un essai, on peut dérouler sa réflexion, sans la médiation de personnages. C’est une prise de parole publique. Elle est plus directe. C’est comme s’il y avait un débat et que je prenais le micro pour donner mon point de vue. Je ne prétends pas avoir raison, j’estime exercer simplement mon droit à la liberté d’expression. C’est un texte court, pas besoin de faire une intrigue avec des personnages qui rentrent dans une interaction.
Quel est votre rapport aux langues ?
Fatou Diome : Avant d’écrire de la prose, j’écrivais de la poésie, notamment au lycée lors des concours en français. Ma langue sérère est très réitérative, très musicale aussi. C’est une caractéristique que j’aime transposer en français, alors, quand j’écris, je récite. J’aime que ça sonne bien à l’oreille. Le sens, seulement, ne me suffit pas. Un mot juste qui sonne très bizarre à l’oreille, c’est moche dans un texte. Dans ce cas-là, je vais le changer pour trouver quelque chose à la fois juste au niveau sémantique, mais qui puisse être esthétiquement agréable à l’oreille. J’ai un travail sur la poésie même pour les romans.
Mes grands-parents parlaient avec beaucoup de métaphores. J’en utilise beaucoup aussi, et je suis souvent révoltée quand les gens pensent que les métaphores qu’il y a dans mes livres viennent d’eux ou de la tradition orale africaine. Lorsqu’un Français utilise des métaphores dans ses livres, on ne lui demande pas s’il est en train de réactualiser Fénelon ou Victor Hugo. On lui accorde respect pour son talent alors que quand vous êtes un auteur venu d’Afrique et que vous trouvez une belle métaphore, tous s’accordent pour dire qu’il s’agit d’un proverbe africain même lorsqu’il n’y a aucun rapport. À chaque fois que j’utilise un proverbe africain, j’explique sa provenance. Et s’il n’y a pas cette précision, c’est qu’il s’agit bien de ma propre expression. C’est donc ma manière d’écrire, j’aime mettre des images, ce sont de petits clins d’œil.
Quand je parle des villageois accrochés à l’île de Niodior comme des restes de nourriture dans la gencive de l’océan, je traite la mer comme si c’était un être humain. Les humains qui se croient au-dessus et pensent être les seuls à avoir des gencives s’en rappellent. L’image reste. On appelle ça une anthropomorphisation. Alors quand des critiques littéraires écrivent qu’il y a une tradition orale africaine, c’est une manière de montrer qu’ils ne s’intéressent pas à nos livres. Ils ne les lisent pas pour voir nos références littéraires, culturelles et notre bagage intellectuel. C’est une manière de minimiser le talent des auteurs africains, car il y a aussi une tradition orale en France, mais personne ne demande à un auteur breton ou alsacien, s’il s’inspire de la tradition orale de sa région. On leur trouve des savoirs universitaires de haut niveau alors que moi, au lieu de voir mes points communs avec Yourcenar où de s’intéresser à ma spécialité en littérature, on me parle de tradition orale africaine. Dans mes références philosophiques, on sent l’influence de Schiller, Montesquieu, Montaigne, Goethe, Steinbeck, Hemingway. Tous ces gens-là, ils ne font pas de lien avec eux parce que je ne suis pas censée avoir cette culture qui est trop blanche. Nous, on doit sans cesse rappeler nos formations universitaires pour qu’elles soient mentionnées, mais aussi lutter pour atteindre l’excellence dans nos domaines pour être admis. Résumer un auteur à ses origines, c’est quelque chose d’assez triste. Les pensées de Pascal, ce sont bien des maximes, pourtant, il n’est pas né à Ouagadougou.
Quand on va dans la création, on peut défendre un travail poétique, esthétique tout en défendant des idées sociales. C’est ce que j’essaye modestement de faire.
Fatou Diome
Comment qualifiez-vous votre travail littéraire ?
Fatou Diome : Je ne le qualifierai pas. C’est juste un exercice personnel. Une façon de tenir, le temps qui m’est imparti dans ce monde. C’est-à-dire que je sais que nous sommes éphémères, alors, en attendant mon moment, j’essaye de contribuer à ce qui me semble bien pour nous, en essayant de faire le moins de mal possible. L’avantage qu’il y a avec la littérature, c’est qu’on peut régler tous les comptes. Il est possible de tuer, d’enterrer sans verser de sang. (rires !) Je ne sais pas si mes livres me survivront et ça m’est égal. Le plus important est d’écrire, c’est ma façon d’affronter l’existence, d’essayer de comprendre le monde et de partager mes rêves et révoltes. De m’amuser aussi, parce que lorsque j’écris, je m’amuse énormément, même lorsqu’il s’agit de choses terribles, il y a du plaisir dans la création. Quand on va dans la création, on peut défendre un travail poétique, esthétique tout en défendant des idées sociales. C’est ce que j’essaye modestement de faire. Il se peut que je me plante royalement, mais j’ai gardé l’innocence des enfants qui croient en leurs rêves, donc je continue. La littérature reste un espace de liberté. Nul n’est jamais forcé pour acheter un livre, donc, quand on lit un livre, on partage volontaire la pensée de l’auteur et l’on est tout aussi libre de la critiquer. On a décidé d’aller vers lui, de l’accueillir chez soi, de lui tendre la main. Quand on écrit, on se dévoile, on s’assume comme on est, du moins, c’est ainsi que je vois cette activité. C’est pour cette raison que, dans Les Veilleurs de Sangomar, le personnage de Coumba dit qu’« écrire c’est se présenter au Seigneur tel qu’il vous a fait, à lui d’assumer sa pauvre créature. »
