Après plusieurs années d’engagement dans les cénacles promouvant l’émancipation féminine en Afrique, la sénégalaise Mariama Bâ s’empara du roman en 1979 pour dire les maux des femmes subsahariennes. Dans Une si longue lettre, opuscule construit sur des récits de femmes vivant en Afrique, elle analyse les rouages de la polygamie et ses conséquences dans la vie de celles qui y sont confrontées. Un texte lucide qui permit « de politiser le champ littéraire africain en posant les questions féministes en son sein, avec des illustrations simples, un propos juste et en pointant du doigt des réalités qui font encore écho aujourd’hui » d’après Odome Angone.
Enseignante-chercheuse à l’université Cheick Anta Diop de Dakar, Odome Angone a publié en 2020 Femmes noires francophones. Dans le premier volet de cette monographie consacrée aux auteures classiques africaines, elle explique avec minutie le manifeste politique de Mariama Bâ qu’elle perçoit comme « un récit transgénérationnel sans rides restituant fidèlement des réalités dures, cruelles, crues avec des propos justes ». Entretien.
Quel regard portez-vous sur Une si longue lettre, le manifeste politique de Mariama Bâ publié en 1979 ?

Odome Angone : Relire Une si longue lettre en 2022 s’entend comme un baromètre d’appréciation permettant, à titre personnel, de faire le point sur l’état d’avancement des Droits des Femmes en Afrique plus de quarante ans après sa publication, sur les problématiques que Mariama Bâ soulevait déjà à l’époque. Le roman est publié en 1979. Soit un an avant ma naissance. Plusieurs décennies plus tard, le roman ressemble à un manifeste transgénérationnel sans rides qui me parle à moi au même titre qu’il pourrait s’adresser à ma mère, à ma grand-mère et à d’autres générations de femmes africaines. Parce qu’elle croise des questions existentielles subjectives à partir des banalités de la vie quotidienne qui nous concernent toutes, d’une façon ou d’une autre. C’est précisément pour cette raison que considérer Une si longue lettre comme la bible du féminisme africain francophone n’est pas une extrapolation. Même si le terme féminisme est très contesté aujourd’hui, à juste titre, par une bonne partie des militantes africaines parce qu’elles rappellent qu’on n’a pas dû attendre les théoriciennes européennes pour nous dicter la marche à suivre afin de défendre nos droits. Moi, j’utilise le concept par défaut. J’entends le féminisme non pas comme théorie néocolonialiste mais une pratique de résistance en situation d’invisibilité structurelle aux prises avec un système patriarcal. Le mot en tant que tel renvoie, dans mes propos, à un concept-valise qui permet de nos jours de fédérer des luttes adjacentes transcontinentales, chacune à partir de son lieu d’énonciation. J’aime souligner que la théorie est une conceptualisation parfois fade du monde thésaurisée dans des livres or la pratique est préexistante aux éruditions et incursions intellectuelles. On peut vivre en résistance sans avoir nécessairement lu de « grandes » théoriciennes de la question. Je considère la théorie comme un caprice d’une personne auto-désignée « intellectuelle » qui décide un jour de coucher sur papier des écrits pour ouvrir une école/ligne de pensée. Pour revenir au mot « féminisme » en tant que pratique, cette conscience existe en Afrique depuis bien longtemps. En voyant comment nos grand-mères ont grandi et les prises de position qu’elles ont eues sans avoir lu les « grandes » théoriciennes du féminisme, je peux affirmer que nulle n’a de leçon d’humanité à recevoir de quiconque. Il faut donc établir non pas des différences encore moins des divergences mais des nuances entre théories et pratiques. C’est justement ce que Mariama Bâ a réussi à faire. Son travail est un outil d’empouvoirement vu dans le sens de la capacité d’agir (agency/agentivité) de problématiser, de politiser le champ littéraire africain en posant les questions féministes en son sein, avec des illustrations simples, un propos juste et en pointant du doigt des réalités qui font encore écho aujourd’hui.
Mariama Bâ parle du vécu des femmes africaines d’abord à partir de sa propre expérience puis en solidarité politique avec d’autres femmes qu’elle (re)présente à mesure de sa narration.
Odome Angone
Qu’est-ce qui fait l’originalité du livre de Mariama Bâ par rapport aux textes d’Ahmadou Kourouma (Le soleil des indépendances) et de Seydou Badian Kouyaté (Sous l’orage) publiés une décennie plus tôt et abordant également les injonctions et violences auxquelles sont sujettes les femmes en Afrique subsaharienne francophone ?
Odome Angone : Pour rester sur la comparaison entre les textes que vous énoncez, je crois que la légitimité (une femme qui parle sans intermédiaire de questions qui la concerne en dialogue avec d’autres femmes), le lieu de l’énonciation (le discours féminin africain qu’elle incarne implicitement), la diversité des points de vue par les personnages mis en lumière (Ramatoulaye et toute la parentèle) et puis surtout le style choisi (sororité épistolaire par tutoiement) ont pu être déterminant. Une si longue lettre est un discours éloquent sur la puissance de la sororité aiguillonnée par des flashbacks. Ces éléments nous donnent le plan de situation du discours en contexte. Cela veut dire qu’à partir de la structure patriarcale de la société sénégalaise, sous l’orbite de traditions résiduelles adoubées par une lecture très biaisée des préceptes de l’islam sur la polygamie, Mariama Bâ parle du vécu des femmes africaines d’abord à partir de sa propre expérience puis en solidarité politique avec d’autres femmes qu’elle (re)présente à mesure de sa narration. D’autre part, Une si longue lettre n’est pas qu’un argument de fiction sporadique, en vases communicants, son roman est le prolongement même d’un engagement politique. Or, au-delà d’un héritage littéraire qui continuera sans doute à nourrir des travaux de thèses, je n’ai pas souvenance d’avoir eu vent ne fut-ce que de façon ponctuelle d’un engagement politique pris de la part de Seydou Badian Kouyaté et d’Ahmadou Kourouma sur l’amélioration des Droits des femmes africaines, contrairement par exemple à Thomas Sankara (pas romancier, j’en conviens) lequel en tant qu’homme d’État a accompagné ses promesses par des actes.

Sankara était un homme féministe parce qu’il a compris que les luttes connexes étaient des combats d’humanité engageant toute la planète et toutes les couches sociales en faveur d’un vivre ensemble inclusif. C’est ce qui fait d’ailleurs à mon sens toute sa grandeur et relève la sincérité de ses idéaux.
Pour revenir au roman de Mariama Bâ, je citerai pêle-mêle sans exhaustivité les thèmes soulevés : la spoliation de la veuve et de l’orphelin(e), la monoparentalité à la suite d’un veuvage, le lévirat, les divorces causés par la survivance des castes et la loi du sang, et sur ce point par ricochet, elle pointe du doigt le chantage affectif et le rôle des femmes dans la perpétuation de la polygamie, la relation belle-fille/belle-mère (la mère du défunt Mawdo, Tante Nabou), la polygamie soldée par l’abandon/la désertion du foyer conjugal (le traumatisme de l’abandon, la charge des enfants et les violences économiques), la double journée des femmes africaines et partant de la charge mentale, l’inertie du mariage provoquée par les pesanteurs socioculturelles, les violences psychologiques liées à la culture du silence, la dépression conjugale (Jacqueline l’ivoirienne), le conditionnement des femmes par des rôles préfigurés depuis l’enfance (la petite Nabou), les mariages arrangés, forcés, précoces (Nabou et Modou). Le roman pointait déjà à l’époque le phénomène du « sugar daddysme » (relation Modou et Binetou, la coépouse de Ramatoulaye).
Une si longue lettre problématise aussi la question de la parité, l’égal accès des femmes aux fonctions électives, nominatives.
Odome Angone
Avec le divorce d’Aïssatou, l’amie de Ramatoulaye, on peut aussi entrevoir, la résilience, la détermination, la dignité et le droit au libre choix au détriment de la pression sociale. Le mariage ici n’est pas une fatalité mais un choix, le mariage n’est pas une résignation encore moins une condition sine qua non à l’autoréalisation, nous démontre le cas d’Aïssatou même si elle ne s’en échappe qu’en partant vivre à l’étranger donc hors du champ visuel/culturel sénégalais. La situation aurait été la même si elle était restée vivre au Sénégal ? Une si longue lettre problématise aussi la question de la parité, l’égal accès des femmes aux fonctions électives, nominatives. Les conversations de Ramatoulaye et Daouda Dieng l’évoquent. Il est assez intéressant de constater que ces questions dont on parle aujourd’hui encore ne sont pas si récentes. C’est pourquoi relire un classique comme celui-ci permet d’avoir un feedback.
Du point de vue de la langue se dégage un procédé anaphorique que l’on associe beaucoup aux langues dites orales. Une façon emphatique de répéter le même mot pour renforcer l’intention poétique, souligner la charge sémantique par le biais d’une langue française commune qui nous échappe par moment. De même le style épistolaire induit une co-participation du lectorat. Lire une lettre tierce c’est partager les secrets d’une intimité. Nous nous sentons toutes amies de Ramatoulaye. Nous imaginons toutes une réponse. Ce suspens narratif est une signature magistrale unique. Le reproduire même un quart de siècle plus tard donnerait un effet de « déjà vu ».
Couronné de succès dès sa sortie, le livre se heurta à l’absence de politique pénale probante en faveur des femmes. Comment comprendre ce manque de porosité de la part des indépendantistes africains ?

Odome Angone : Au sein d’une Afrique fragilisée par la colonisation, les combats féministes ont pu être perçus soit comme l’ennemi intérieur soit une tentative inavouée de catégorisation concurrentielle des débats « à l’ordre du jour ». Le privilège de l’attente échoit en général à celui qui peut imposer un/son agenda. À cet effet, une imposture idéologique sème la confusion entre masculinisation du discours (résidu actif du patriarcat à l’œuvre) et traditions africaines (usufruit ethnolinguistique issu d’un patrimoine collectif de droit). Les clivages socio-politiquement construits couplés à la censure ont fini par installer les inégalités de sexe comme l’ordre naturel des choses, un droit divin. Une parole inaudible par les espaces de validation ne veut pas dire une parole inexistante. Une parole non reconnue n’en fait pas un vide volontairement abstenu. Cela commence d’ailleurs par le ridicule qui consiste à célébrer les « Pères des Indépendances ». Une question simple peut alors se poser : Où sont passées « Les Mères des Indépendances Africaines » ? A quelles fins le récit officiel s’est-il manifestement chargé de supprimer les femmes dans les pages capitales de la Grande Histoire ? Et donc dans les questions associées aux luttes indépendantistes, beaucoup n’ont pas vu l’urgence de mettre sur la table toutes les questions de façon intersectionnelle, qui touchaient toutes les couches sociales, considérant que cela pouvait « attendre ». Reines d’Afrique et héroïnes de la diaspora noire (2004) de Sylvia Serbin apporte des pistes de visibilisation des femmes sur ces questions. L’essai sur La marche des femmes sur Grand Bassam (1975) d’Henriette Diabaté met en avant le patriotisme de l’indépendantiste ivoirienne Marie Koré et ses acolytes. Dans la fiction, Les Bouts de bois de Dieu (1960) de Sembène Ousmane rend hommage à des femmes par une marche qu’elles initient de Dakar à Thiès à partir d’un épisode colonial. Ainsi de suite.
Je voudrais quand même souligner la clairvoyance de Thomas Sankara, publiquement engagé sur ces questions. Il parle en l’occurrence de la nécessaire déconstruction comme premier exercice pour comprendre que les questions féministes ne sont pas une guerre déclarée CONTRE les hommes mais POUR une société plus juste. Il disait d’ailleurs, avec un humour pédagogique, être lui-même un sujet en perpétuelle déconstruction, de désapprentissage du masculinisme pour embrasser plus sainement la libération des femmes dans les luttes de libération collective. Je préfère retenir des exemples comme un Sankara qui a compris qu’en traitant des questions anticoloniales, tout était interconnecté. On peut pousser la réflexion plus loin en (re)lisant L’émancipation des femmes et la lutte de la libération de l’Afrique où il rappelle, je cite : « Il n’y a de révolution sociale véritable que lorsque la femme est libérée ».
Sa parole ne fut pourtant pas entendue par ses confrères subsahariens…

Odome Angone : Le discours féministe de Sankara fut audible (la preuve en 2022 nous en parlons encore et il reste des traces audiovisuelles sur des plateformes digitales de nos jours, sans oublier des ouvrages) mais ignoré parce que la plupart ont choisi l’amnésie sélective ou encore la démagogie. Cela veut dire que, par effet de mode, l’on prend des engagements publics à des fins électoralistes pour avoir de façon assurée le vote des femmes, avec la complicité d’un groupuscule de femmes embourgeoisées qui prêchent en réalité de façon partisane et égocentrique pour des chapelles idéologiques, façon politique politicienne. Je fais référence notamment à la fumisterie folâtre toujours en vigueur qui consiste à mobiliser des « sœurs » autour de questions qui les concernent forcément pour les coopter plus durablement, stratagème suspicieusement encadré par un féminisme d’État subventionné, à la turgescence molle, batifolant langoureusement avec le marionnettisme misogyne de l’idéologie patriarcale, et en récompense, hypermédiatisé, promu, mobilisé et surreprésenté par les canaux officiels. Il ne suffit pas d’être femme pour être féministe, il faut être éthiquement engagée.
Aussi longtemps que l’on considèrera les questions féministes comme des problèmes de femmes pour les évincer des enjeux collectifs politiques, le pic des inégalités sociales ira crescendo.
Odome Angone
Parmi les sujets abordés dans le livre de Mariama Bâ, se situe en première position la polygamie. Un régime dont elle n’a cessé de dénoncer les effets dans la vie sociale des femmes en Afrique. Pourquoi sa parole n’a jamais eu d’écho dans les instances de reconnaissance institutionnelle ?
Odome Angone : Ce n’est pas parce qu’une parole n’est pas entendue c’est-à-dire légitimée ou audible, par un cadre de reconnaissance institutionnelle qu’elle n’existe pas. Les instances de reconnaissances institutionnelles ne sont pas qu’une vue de l’esprit, ce sont des espaces de pouvoir gérés, régentés et même monopolisés par des individus régis par des formatages sociétaux. Mon expérience d’universitaire à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar me permet de voir combien s’exprime avec aisance le sexisme au pinacle sans gêne ni retenue, dans des espaces que je croyais lavés de ces velléités. On a beau être de « grand(e)s intellectuel(le)s », sans déconstruction, nous sommes le prolongement ou le microcosme de la société. Des personnes construites sur des bases larvées reproduisent (in)consciemment les mêmes biais.
Un exemple vraiment banal c’est lorsque l’institution nous adresse des courriers administratifs par mailing groupé ou lorsque l’on remplit des formulaires officiels pour candidater ou pour des formalités, le masculin s’impose systématiquement comme le référentiel universel de la neutralité (administrative et/ou scientifique) avec une récurrence exaspérante qui s’est installée, au fil du temps, en « norme » (biaisée évidemment). Nous (catégorie des corps « autres ») ne sommes donc pas pensées comme élément de la norme en vigueur au nom d’une règle sexiste polémique obsolète de la langue française (cf : la formule « le masculin l’emporte sur le féminin »). Alors ce qui se passe à l’Université s’étend dans les assemblées nationales où l’on doit revoir des lois iniques et d’un archaïsme ahurissant. Au Gabon par exemple, un vieux projet de loi visant la reconnaissance juridique de la dot est bloqué depuis des lustres parce que le privé est politique. Les parlementaires, en écrasante majorité des hommes, sont « les mêmes hommes » qui gèrent une parentèle de maitresses, vivent avec, sous des formats multiples dans des harems interminables. Voter cette loi c’est voter « contre » leurs propres turpitudes. Ils négocient des ponctuations et des néologismes tautologiques pour s’assurer qu’une fois votée, cette loi sera en réalité, nulle et non avenue. Alors qu’arrive-t-il lorsqu’on entretient des subterfuges de ce genre, c’est qu’au moment du décès du conjoint, la spoliation de la veuve et des orphelin(e)s devient un véritable casse-tête entre les différents régimes matrimoniaux (non) reconnus et toute la marmaille (non) reconnue. C’est vous dire qu’aussi longtemps que l’on considèrera les questions féministes comme des problèmes de femmes pour les évincer des enjeux collectifs politiques, le pic des inégalités sociales ira crescendo. Or les institutions sont tenues de protéger tout le monde. En tant que femme, ne pas avoir accès à des espaces de pouvoir, ne pas porter nos voix, nos requêtes restera lettre morte. Le législateur et l’exécutif ne souscriront alors qu’à la politique de l’autruche.

Le livre met aussi en exergue l’utilité de la littérature dans les luttes pour l’émancipation des femmes en Afrique…
Odome Angone : Je crois qu’à travers la lecture, ce que le roman veut nous enseigner se résume au triptyque « formation, information et transformation ». À travers la lecture qui est un métadiscours de la nécessité de se former, de s’ouvrir, d’aller au-delà de nos espaces, elle insiste sur l’utilité d’acquérir une formation qui donnera aux femmes, la possibilité d’être intellectuellement émancipées, libres, averties, avisées. Je tiens à nuancer les termes. Par expérience, le terme « intellectuel(le) » (faux complexe de supériorité négociable largement galvaudée) n’est pour moi qu’une vue de l’esprit contre un tour de prestidigitation. Un(e) grand(e) diplômé(e) sorti(e) d’une école (dit-on pompeusement) prestigieuse peut être allégrement un(e) parfait(e) cancre, une autre endossé(e) malgré soi l’étiquette clivante de l’illettrisme alors qu’elle thésaurise acquiescement une culture de haut vol sans sophistication. Sur le tarmac de l’arrogance, j’ai maintes fois rencontré de parfait(e)s anonymes bardé(e)s de savoirs ahurissants appris avec rigueur sur le tas, contrairement à la forfaiture confortable de voix autorisées aux effets néfastes travestis, expert(e)s de la question adoubé(e)s par une présomption de connaissance, très discutable, affligeante. Je parle donc de la nécessité d’apprendre sans cesse et sans classisme de part et d’autre. Dans mon cas, toute parole est crédible tant que l’interlocutrice a de la suite dans les idées, aussi bien des références musicales inspirantes qu’une chaine YouTube convaincante ; aussi bien un message reçu via WhatsApp sous anonymat qu’une prise de parole spontanée sur Facebook, aussi bien un hashtag viral sur Twitter qu’une remarque banale jugée pertinente qui fait sens/système, aussi bien un enseignement magistral puisé dans le patrimoine africain qu’une conversation enrichissante tenue en haleine par surprise avec une vendeuse ambulante au coin d’une rue, et j’en passe. Je crois que les espaces de légitimation gagneraient à redistribuer la parole, la démocratiser à outrance pour faire émerger de nouveaux récits.
Lorsqu’on est traversé par une binarité établie depuis l’enfance, être femme, épouse, mère, hétérosexuelle (etc.) s’entend comme une série de cases à cocher pour être considérée normale.
Odome Angone
Il m’arrive de converser avec des femmes considérées intellectuelles car diplômées qui vous disent clairement qu’elles ne sont pas féministes, et sont en faveur de la polygamie. Elles argumentent que la polygamie évite de s’occuper d’un homme à temps plein pour mieux se consacrer à leurs carrières. On peut s’interroger sur la nécessité d’avoir un mari coûte que coûte si l’on peut s’en passer afin de se consacrer pleinement à sa carrière. Elles ne l’évoquent pas clairement, mais en sourdine, le point de chute demeure presque le même. Lorsqu’on est traversé par une binarité établie depuis l’enfance, être femme, épouse, mère, hétérosexuelle (etc.) s’entend comme une série de cases à cocher pour être considérée normale. C’est pourquoi j’aime souligner que les questions que nous abordons dans le féminisme subsaharien obéissent à des réalités spécifiques. Cela permet aussi de comprendre que les réflexions nourries par les femmes n’ont pas de réponses unanimes ni monolithiques.
Pour aller plus loin, je connais des collègues qui vivent maritalement en situation de polygamie avec conviction. Je me dois de respecter cette décision parce qu’être femme ce n’est pas être automatiquement féministe et je peux aussi dire qu’on peut être féministe tout en souscrivant à la polygamie. Je ne les défends pas, je respecte leur décision. L’agentivité est cette capacité d’agir sur d’autres pour changer le monde, alors si les idées de ces femmes peuvent changer positivement leur entourage, tant mieux.
Après cette longue digression, pour revenir sur la question, la littérature comme outil d’expression est chez Mariama Ba une métaphore pédagogique efficace de transformation durable, la preuve plus de quarante ans plus tard, nous parlons encore de ce texte.
Quel est l’héritage de Mariama Bâ ?
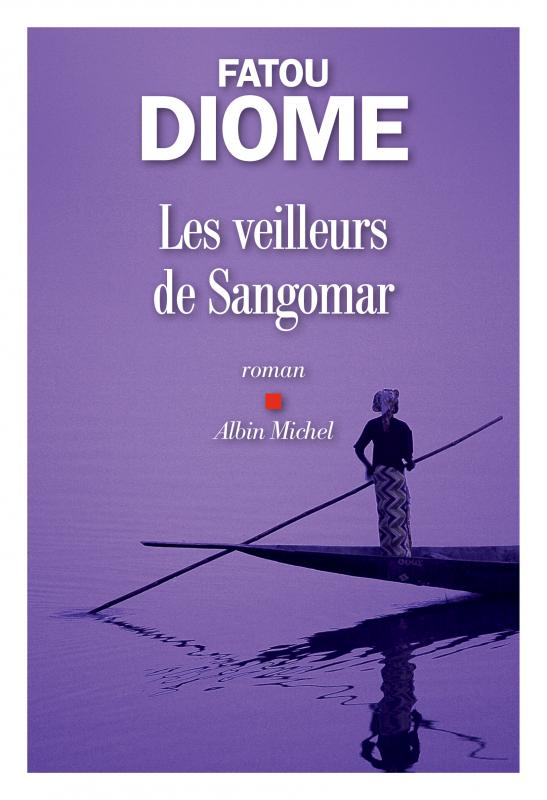
Odome Angone : En tant que chercheuse, l’héritage de Mariama Ba est d’ordre théorique. Le texte a ouvert des brèches, permis des écoles de pensées, nourri des espaces intellectuels. C’est en cela qu’il est urgent de laisser des traces « écrites ». Sans Une si longue lettre en héritage, nous auriez été orphelines d’une époque qui nous concerne. L’héritage intellectuel de Mariama Bâ est de ce fait palpable, concret ; une trace écrite qui nourrit les travaux universitaires, revendiquée aussi par les mouvements militants. C’est grand parce que l’on sait sur quoi nous appuyer pour pouvoir avancer. Et pour savoir sur quoi nous appuyer, nous allons justement vers le passé chercher ce que d’autres femmes africaines en l’occurrence ont écrit. À juste titre, Aminata Dramane Traoré dans La Gloire des Imposteurs (essai épistolaire co-écrit avec Boubacar Boris Diop en 2014) souligne que « L’extrême vulnérabilité du continent, on ne le dira jamais assez, tient en grande partie à l’abyssal vide théorique qui fait de nous les consommateurs béats des idées des autres ». Et d’ailleurs, si vous lisez Les Veilleurs de Sangomar de Fatou Diome, vous verrez des échos contemporains du roman de Mariama Bâ. Fatou Diome parle de questions analogues dans une démarche introspective. Son livre raconte la vie d’une jeune veuve qui recourt aussi à une sorte de cahiers intimes qu’elle dresse tous les jours comme thérapie et héritage futur pour son enfant orpheline d’un papa qu’elle ne connaitra plus qu’à travers les souvenirs de tiers. Ces parallélismes intertextuels font que l’héritage de Mariama Bâ nourrira pendant très longtemps encore les réflexions féministes. Cela confirme l’actualité et le caractère classique des questions qu’elle pose.
Le roman de Mariama Bâ va continuer de nourrir la réflexion, et d’inspirer une série de personnes. Beaucoup de femmes qui rentrent dans les luttes féministes africaines se servent du livre de Mariama Bâ systématiquement parce que c’est le plus bel héritage qui soit, c’est la plus belle trace qui permette de faire l’état de la question pour savoir vers où l’on va et qu’est-ce ce qui a été fait pour continuer justement. C’est pourquoi j’insiste sur l’urgence d’écrire parce que le livre est le seul héritage qui permet de faire justice aux propos d’une autrice à des époques anachroniques. Ce n’est pas une parole rapportée. En cela, le livre de Mariama Bâ est le témoignage fidèle de sa pensée. Mais bon, n’oublions pas qu’il s’agit tout de même d’un roman. Ce n’est pas une autobiographie comme dans le cas d’Aoua Kéita, sage-femme, ayant écrit depuis le Mali sous forme autobiographique sur des réalités qui concernaient les femmes en Afrique. Tout texte permet de situer les débats d’une époque en écho retentissant.
Un dernier mot sur son travail littéraire ?
Odome Angone : La grandeur d’une écrivaine comme Mariama Bâ se perçoit à la capacité d’écrire sur des thématiques cruciales avec une actualité sans échéance. J’en veux pour preuve la production de Maria-Nsue Angue, première romancière de Guinée Équatoriale avec son roman Ekomo (1985) dans lequel elle analyse déjà aussi à cette époque la stigmatisation faite sur des femmes nullipares à la mort du mari. Cheikh Hamidou Kane, par exemple, n’a pas eu besoin d’écrire des dizaines d’ouvrages pour faire de L’aventure ambiguë (1961) un classique indétrônable. Cela permet de constater que le caractère classique et l’intérêt même d’une œuvre n’est pas mesurée au nombre de livres de l’auteur(e).
Pour revenir à Une si longue lettre, le livre de Mariama Bâ fait moins de 150 pages du moins dans l’édition à ma disponibilité, mais elle dit des choses essentielles.
Mariama Bâ aborde des questions profondes, violentes avec une élégance narrative lumineuse.
Odome Angone
C’est une écriture belle, limpide, juste. Je n’ai pas senti dans le style de Mariama Bâ, une démarche victimaire encore moins un besoin misérabiliste de se faire entendre. J’ai vu un récit transgénérationnel sans rides qui restitue fidèlement des réalités dures, cruelles, crues avec des propos justes. C’est en cela que j’aime son style. J’aime surtout sur le plan stylistique l’esthétisation d’un français diachronique traversée par les langues de l’imaginaire sénégalais comme le wolof. Lorsqu’on lit Mariama Bâ et qu’on connait un peu la dynamique rythmique de certaines langues africaines, on voit dans les structures internes un style qui rappelle les métissages du français avec les langues du Sénégal. La pluralité des langues est une diversité à ne pas perdre. Au-delà d’une langue se lisent une civilisation et des pratiques culturelles indispensables à la survie d’une communauté.
Lorsque l’on lit des ouvrages publiés par des écrivaines et écrivains africains, on se rend compte que de la survie des langues africaines dépend la richesse de la langue française. Nous sommes lié(e)s. Si la langue française veut survivre, se renouveler elle a tout intérêt à ce que ne meurt aucune langue africaine. Nous jouons avec les mots, avec l’imaginaire des langues, nous copulons avec le français à travers nos réalités plurilingues. C’est pourquoi, au détour du renouvellement de la langue française de Mariama Ba s’observe une récréation des imaginaires d’où les notes en bas de pages, consciente qu’un culturème « africain » ne sera jamais intégralement restitué dans un texte « écrit ». Il y a de façon implicite des références qui échappent au lectorat monolingue ne parlant que le français. Elle recourt donc à la note de bas de page, une façon de rappeler le métissage sous-jacent. Mariama Ba aborde des questions profondes, violentes avec une élégance narrative lumineuse.
Et sur son engagement politique ?
Odome Angone : Je ne suis pas un témoin oculaire de son époque, mais des informations lues par ci par là témoignent d’un militantisme dont Une si longue lettre serait une illustration démonstrative. Mariama Bâ a grandi dans un cadre que je considère quelque peu « privilégié » tout à son avantage et c’est tant mieux. Donc très tôt, elle s’est posée des questions que certaines femmes de son époque n’ont peut-être pas eu le privilège de coucher dans un texte pour la postérité. Elle a par exemple eu « le luxe » de divorcer et de se (re)marier trois fois. (Je parle de luxe eu égard au Code Civil sexiste en vigueur qui donne les pleins pouvoirs aux époux.) Cela veut dire, autant de fois qu’elle n’a pas été comprise ou respectée. Elle naît dans un espace où la culture, l’autonomie intellectuelle et la défense des droits semblent s’aligner à son environnement immédiat. Son éveil des consciences trouve des échos dans la pluralité des points de vue qu’elle pose en miroir dans Une si longue lettre, si bien que le roman se confond en essai autobiographique par effet de vraisemblance tellement ce qu’elle dit, décrit, transcrit, prédit, redéfinit, parle à tout le monde.

Mariama Bâ aura fait germer des potentialités dans une temporalité non figée. De nos jours, il revient aux générations actuelles et à venir d’aller au-delà. Les podcasts créés par des collectifs minorisés en prennent d’assaut comme caisse de résonance, relisant très souvent des pionnières. L’engagement politique de Mariama Bâ nous rappelle qu’il faut non seulement être constitutive de la société civile de façon active, collaborer avec des associations, mettre en place des espaces de réflexion (non) mixte, savoir imposer aussi des agendas politiques par rapport à nos réalités/nos besoins au risque de dépendre des agendas cachés.
