Est-ce la morosité liée à une sexualité homosexuelle invécue en raison de la trentaine, ou la routine solitaire dans laquelle il s’est tristement confiné au travail qui pousse Robin à la contemplation de Sven, le jeune homme insaisissable avec lequel il nouera une relation ambiguë ? Difficile d’y répondre. C’est ce qui fait notamment la richesse du livre de Robin Josserand, qui parvient brillamment à se déprendre des codes narratifs de l’autofiction au profit d’un récit polysémique sur la solitude, l’indésir, la désidentification et la monotonie du travail dans nos sociétés contemporaines.
Entretien avec un primo-romancier à révérer à la fois pour son talent et son acuité.
Pour débuter, je vous demande une biographie. Quel est votre parcours ?
Robin Josserand : Je suis né au début des années 1990, j’ai grandi dans une petite ville assez triste qui s’appelle Le Creusot en Bourgogne – Christian Bobin l’avait d’ailleurs surnommée « la plus belle ville du monde », et je dois confesser que cette plaisanterie ne m’a jamais fait rire -, puis je suis parti vivre à Lyon. Là, j’ai fait des études de Littérature et d’Histoire, ce qui m’a permis de publier un premier essai en 2018 sur la Beat Generation – je n’étais, à l’époque, pas complètement sorti de mon adolescence et j’étais encore très marqué par Burroughs, et aussi par Mala Noche, le livre de Walt Curtis qui a inspiré le film de Gus van Sant. J’étais également musicien. Je suis ensuite devenu bibliothécaire.
Pourquoi écrivez-vous ?
Robin Josserand : C’est cet essai qui a été déterminant. Un jour, un éditeur m’appelle parce qu’il avait lu un article que j’avais publié dans un magazine, à propos de mon travail universitaire. Six mois après, le livre était disponible. J’écrivais de la mauvaise poésie depuis l’adolescence et j’avais toujours eu, comment dire, une « intuition de littérature ». Je pensais qu’il y avait quelque chose pour moi de côté-là. J’ai pris cet appel pour un signe. J’ai envoyé valser tout le reste et je me suis mis sérieusement à écrire. Depuis, c’est là, comme une présence, c’est de surcroît, et c’est essentiel. Il n’y a pas plus juste que cette phrase d’Ernaux, tel un credo : « Si je ne les écris pas, les choses ne sont pas allées jusqu’à leur terme, elles ont été seulement vécues. »
L’inspiration n’existe pas – ou plutôt l’inspiration est pénible et il ne faut pas y compter parce qu’elle arrive toujours au moment où vous ne pouvez pas prendre de notes…
Robin Josserand
Comment écrivez-vous ?
Robin Josserand : Le processus d’écriture, passé l’euphorie des premiers mois, n’a rien d’un travail romantique. C’est un labeur. Lorsque j’étais encore employé à la bibliothèque, je me réveillais à six heures, travaillais deux heures le matin puis poursuivais encore deux à trois heures le soir. L’inspiration n’existe pas – ou plutôt l’inspiration est pénible et il ne faut pas y compter parce qu’elle arrive toujours au moment où vous ne pouvez pas prendre de notes et où vous ne pouvez pas écrire : au cinéma ou lorsque vous êtes en train de nager par exemple -, alors il faut travailler comme un acharné. Je ne sais plus qui a dit que l’écrivant peut commencer à se prendre au sérieux lorsqu’il à ne répond plus à ses amis qui le sollicitent pour aller boire un café. Je crois que c’est un peu vrai. J’écris sinon sur mon bureau, entouré de mes images, il y a par exemple Kafka qui me regarde et j’ai l’impression qu’il rit de me voir ainsi me dépêtrer, comme si je nageais dans la boue.
Sur quel support écrivez-vous ?
Robin Josserand : Lorsque vous commencez à écrire, vous écrivez à la plume parce que vous pensez que ça vous rend plus sérieux. Et puis vous comprenez rapidement que l’écriture, c’est avant tout quatre-vingts pour cent de relecture et de réécriture, alors vous passez rapidement à l’ordinateur. Mais la vérité est que je suis incapable d’écrire correctement à la main et que le temps est trop précieux pour jouer à l’écrivain.
Avez-vous un rituel ?
Robin Josserand : Boire la tasse de café de trop, parvenir à cet état d’extrême tension, cette sensation de tanguer sur un fil. Pour écrire, je crois qu’il faut trembler un peu.
Je n’ai d’ailleurs pas de plan lorsque je commence un texte, je n’ai absolument aucune idée de la direction à prendre…
Robin Josserand
Procédez-vous à de la documentation avant d’entamer l’écriture d’un texte ?
Robin Josserand : Cela dépend du texte mais assez peu jusque-là. Je me suis simplement replongé dans les écrits de Glenn Gould rassemblés par Bruno Monsaingeon. J’ai également relu Nocturnes pour le roi de Naples d’Edmund White qui a donné le « ton » du livre. J’ai mené quelques recherches sur Groix mais dont je n’ai pas fait grand chose. J’ai revu le film de Brisseau. J’ai enfin fait quelques recherches sur les autopsies, ce fut à la fois amusant, dégoûtant et laborieux. Je n’ai d’ailleurs pas de plan lorsque je commence un texte, je n’ai absolument aucune idée de la direction à prendre. Je suis toujours cet enfant qui fonçait tête baissée dans son jeu et à qui les adultes disaient de se calmer et de prendre son temps. En ce moment, c’est un peu différent parce que j’écris un livre sur Mireille Mallet, mon arrière-grand-mère qui a été déportée à Ravensbrück, alors là bien sûr, j’ai beaucoup de documentation. Mon arrière-grand-mère a écrit deux livres – un témoignage sur son expérience de déportée et un roman sur la vie de son fils. Je mène en parallèle des entretiens avec mon grand-père. C’est un travail particulièrement émouvant. Mais ce qui est sûr, c’est que j’ai toujours besoin d’un livre à mes côtés pour m’accompagner, un ton aimé, une voix familière.
Cette documentation est donc aussi artistique ?
Robin Josserand : Je suis quelqu’un qui vit entouré d’images dont j’ai besoin pour écrire. Mais il s’agit moins d’une documentation que d’œuvres qui suscitent mon désir. Il y a par exemple ce tableau qui m’a accompagné pendant l’écriture, La résurrection de Lazare du Caravage, une œuvre qui m’émeut particulièrement parce qu’on dirait un jeune homme qui se réveille après une nuit de sommeil. Il y a également les fleurs de Twombly car je n’ai jamais rien trouvé de plus beau pour exprimer la violence du désir – et ce roman ne dit rien d’autre que la violence du désir. Les portraits d’Eugène Leroy et de Stéphane Mandelbaum, enfin. Alors j’installe ces images sur mon bureau et je peux commencer à écrire.
Vous avez récemment publié aux Éditions Mercure de France, un roman qui retrace la rencontre et la relation ambiguë entre deux hommes dont l’un est ouvertement homosexuel. Quelle est la genèse de ce texte ?
Robin Josserand : J’avais envoyé deux précédents manuscrits à des maisons et j’avais reçu des encouragements. Alors je savais que ça serait celui-là – ou plutôt je me suis mis à écrire en me disant : « Ça sera celui-là. » En parallèle, ma vie commençait à voler en éclats et je débutais une analyse. Il y a eu deux images à l’origine du livre – encore une fois, ce sont ces images qui me poussent à écrire. Un jeune homme croisé dans la rue – une beauté, donc, comme genèse – puis un garçon qui est venu m’aborder alors que je sortais de la première séance avec mon analyste, j’étais sonné, alors je m’étais allongé dans un parc et là, un garçon s’est avancé, il était étudiant en école d’arts et m’a demandé s’il pouvait me dessiner. Ça a duré un long moment, il a fait un croquis qu’il m’a montré, mais c’était assez raté, donc je ne lui ai même pas demandé si je pouvais garder le dessin. En revanche, je lui ai demandé son prénom, et il s’appelait Sven, mon personnage. Et puis, bien sûr, il y a eu cette île, un séjour sur cette île… L’île noire. J’ai récemment offert le livre à un jeune homme en lui disant : « Il est pour toi, mais aussi et surtout pour tous les autres. »
Je voulais écrire un roman sur deux hommes qui ne peuvent pas s’aimer et qui s’ennuient. Mais ce sont des marginaux un peu pathétiques, pas dans le sens lumineux, flamboyant du terme…
Robin Josserand
Du fait d’une sexualité invécue en raison de l’âge (Robin) et d’une précarité le contraignant à la rue (Sven), vos deux personnages ont en commun une certaine marginalité… Comment l’expliquez-vous ?
Robin Josserand : C’est extrêmement troublant… Mon premier manuscrit s’appelait L’Invécu. Quant à cette marginalité… Je voulais écrire un roman sur deux hommes qui ne peuvent pas s’aimer et qui s’ennuient. Mais ce sont des marginaux un peu pathétiques, pas dans le sens lumineux, flamboyant du terme – je pense par exemple à ce très beau titre de Giorno : Il faut brûler pour briller. Ce sont deux personnages en marge d’eux-mêmes.
L’homosexuel est-il nécessairement marginal ?
Robin Josserand : Oui, je le crois. Mais cette marginalité n’est pas – n’est plus – un problème.
Votre roman esquisse également une réflexion sur la perte de l’identité, qu’elle soit juvénile chez Robin ou bourgeoise chez Sven. Quelle en est la raison ?
Robin Josserand : Pour la perte d’une identité juvénile, c’est lié à l’expérience de la trentaine. Je viens de lire cette très belle phrase de Francis Bacon chez Gilles Sebhan (Bacon, juillet 1964) : « Comme je suis homosexuel, c’est beaucoup plus difficile pour un homosexuel d’être vieux, parce que l’homosexualité ça flotte sur la beauté. » C’est sublime. Là, Bacon est écrivain. Alors, bien sûr, je n’ai pas l’âge de Bacon mais tout est là… C’est à la fois équivoque et très clair. Et encore une fois ça n’est pas si grave, il faut juste s’y faire. Pour ce qui est de la perte d’identité bourgeoise de Sven, l’idée était plutôt de jouer avec l’héritage de cette littérature-là, je voulais la tordre – je parle de la littérature homosexuelle, avec ce personnage récurrent du giton. Ce sont deux êtres « déformés »… Tiens, revoilà Bacon.
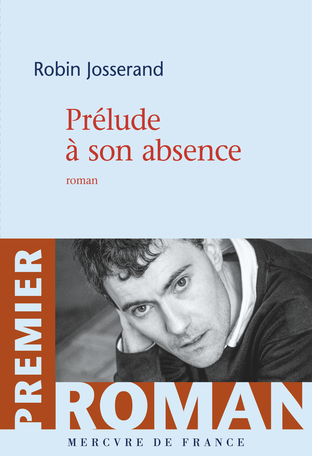
Comment avez-vous construit les personnages du roman ?
Robin Josserand : Grâce à ces deux « rencontres ». Puis, dans Sven, il y a beaucoup de garçons que j’ai connus. Ce jeune homme qui ne répond pas, qui fait la gueule… Celui-là, il existe beaucoup. Concernant le narrateur… Vous savez, pour moi, écrire consiste à « pousser le curseur du réel », aller légèrement trop loin, à l’extrême limite (comme le personnage lorsqu’il va nager dans la mer). Alors j’ai poussé mon propre curseur. Et puis, vous savez, ça je l’ai compris avec l’analyse, mais on écrit avant tout avec son inconscient. C’est un peu comme les rêves, alors on se laisse faire et on relit plus tard en se disant : « Ah oui, tout est là. »
Outre le fait d’avoir un prénom analogue au vôtre, le protagoniste du livre exerce également la même fonction que vous. Quelle en est la raison ? Ces similitudes ne risquent-elles pas de créer de la confusion chez le lecteur ?
Robin Josserand : Bien sûr. Je crois beaucoup à l’adage de Leiris : « Mettre à nu certaines obsessions d’ordre sentimental ou sexuel, confesser publiquement certaines des déficiences ou des lâchetés qui lui font le plus honte, tel fut pour l’auteur le moyen — grossier sans doute, mais qu’il livre à d’autres en espérant le voir amender — d’introduire ne fut-ce que l’ombre d’une corne de taureau dans une œuvre littéraire. » Je voulais jouer avec cette corne-là. Cette confusion était essentielle parce qu’elle est à la base d’un certain « pacte de réalité » avec le lecteur qui est, pour moi, à l’origine de toute littérature. Je fais encore partie de ceux qui pensent, à tort, peut-être, que le romanesque a tous les droits. Et puis la littérature ne vaut rien si elle ne met pas quelque chose en danger.
Tout roman est de l’autofiction, lorsque Flaubert s’exclame : « Madame Bovary, c’est moi », c’est déjà de l’autofiction.
Robin Josserand
Dans quel genre se situe le livre ?
Robin Josserand : Le roman poisseux ? Non, l’autofiction, bien sûr. C’est un genre littéraire formidable. Et puis, tout roman est de l’autofiction, lorsque Flaubert s’exclame : « Madame Bovary, c’est moi », c’est déjà de l’autofiction.
Pourquoi avez-vous choisi de retracer ces morceaux de vie sous forme romanesque ?
Robin Josserand : Sans doute pour me défaire de quelque chose. Mais encore une fois, c’est l’inconscient qui était à l’œuvre. Je serais véritablement incapable de répondre à cette question, sinon en disant que l’écriture répond toujours à un besoin, un désir. Je tendais vers cette histoire-là. Et puis peut-être imaginais-je que c’était une possibilité, le pire que je puisse vivre un jour…
Quelle est la spécificité du roman par rapport aux autres genres littéraires ?
Robin Josserand : Le romanesque est une forme qui peut tout se permettre. Tant pis pour les conséquences. Et puis le roman est tout de même le lieu du fantasme, le plus beau, le plus libre, le plus… « Débarrassé ».
La fin de votre ouvrage semble quelque peu ambiguë sur le devenir de Sven… Comment l’expliquez-vous ?
Robin Josserand : Je voulais jouer avec les poncifs de cette littérature-là, avec ces procédés déjà usés. Au fond, c’est un livre que l’on a peut-être déjà lu et ça n’est pas très grave. Mais derrière la tragédie, il y a une plaisanterie de mauvais goût. Une farce horrible et amère. Je ne pouvais pas terminer le roman autrement, Sven devenait trop encombrant.
J’aurais plutôt tendance à croire que l’écrivain doit surtout et avant tout se coltiner le réel.
Robin Josserand
Comment analysez-vous cette citation du regretté Milan Kundera : « Le roman n’examine pas la réalité, mais l’existence. Et l’existence n’est pas ce qui s’est passé, l’existence est le champ des possibilités humaines, tout ce que l’homme peut devenir, tout ce dont il est capable. Les romanciers dessinent la carte de l’existence en découvrant telle ou telle possibilité humaine » ?
Robin Josserand : Je dois confesser que Kundera m’est souvent tombé des mains… J’aurais plutôt tendance à vouloir à regarder en arrière. C’est une phrase éminemment optimisme – dans le sens où la littérature servirait véritablement à quelque chose, qu’elle irait de l’avant… La littérature comme un élan ? J’aime assez cette idée d’une cartographie des existences, mais malheureusement je n’y crois pas. J’aurais plutôt tendance à croire que l’écrivain doit surtout et avant tout se coltiner le réel.
Comment qualifierez-vous votre travail littéraire ?
Robin Josserand : Un travail qui fixerait le taureau. Et puis se prendre la corne, pour voir.
Et votre style ?
Robin Josserand : J’aime les formes courtes, d’ailleurs je passe le plus clair de mon temps à enlever, à sculpter, pour ne garder que le strict nécessaire. Kafka a écrit « qu’un bout de ficelle et une lame de rasoir – dans certaines conditions – projettent la même ombre. » Peut-être quelque chose comme ça…
Un conseil à celles et ceux qui ont envie de se lancer en littératures ?
Robin Josserand : C’est un travail difficile et décourageant. Mais il n’y pas d’autre solution que de se mettre à son bureau et écrire. C’est le seul conseil que je pourrais donner : se pencher au-dessus de son bureau et écrire. Faire ses gammes, l’envisager comme un travail manuel. Et puis cultiver son désir. J’ai récemment réalisé que, lorsque j’ai commencé à écrire, j’avais un tel désir de livres – non un désir d’écrivain ni un désir de collectionneur – mais un désir de livres que je ne pourrais pas expliquer. Entretenir son désir et travailler beaucoup.
