La parution en août 2024 du roman Les Présences Imparfaites de Youness Bousenna avait suscité un engouement auprès des lettrés et férus de littérature, qui avaient décelé dans ce texte un grand moment littéraire, un renouveau où le style, longtemps mis de côté au profit d’une écriture inodore, faisait magnifiquement son retour.
Historienne et professeure de littérature française et francophone à l’Université d’État de New York, Sylvie Kandé a lu avec contentement et minutie Les Présences Imparfaites, qu’elle qualifie de « Bildungsroman sans arc de progrès ». Dans cet épisode inaugural d’une série consacrée à l’œuvre de Youness Bousenna, elle analyse ce roman, « qui, dans sa singularité, doit effectivement faire partie du canon, pour sa richesse thématique et formelle ». Entretien avec Sylvie Kandé.
Vous avez récemment lu avec contentement Les présences imparfaites, premier roman publié par le journaliste français Youness Bousenna Quel bilan tirez-vous de cette lecture ?
Sylvie Kandé : En renfermant Les présences imparfaites, trois réflexions m’ont traversée :
Le bildungsroman (roman de formation en allemand) a encore de beaux jours, me suis-je dit, si ce critique de la modernité qu’est Youness Bousenna parvient à travailler dans le cadre de ce genre tout en révélant la faille d’un de ses principes fondamentaux — celui d’arc de progrès. En effet, dans Les Présences Imparfaites, on suit le protagoniste-narrateur, Marc Pépin, sur la longue durée. Son enfance, son adolescence, « normales » c’est-à-dire pleines d’ennui, sont représentées comme causes directes de sa vie d’adulte ; celle-ci, dédiée à rattraper le temps qu’il a gaspillé dans sa jeunesse, à l’éloigner des banlieues de l’imagination, est une accumulation de succès apparents qui masquent peu l’échec d’un individu en mal d’amour, dépourvu de boussole existentielle.
Par ailleurs, le roman rappelle l’intérêt qu’il y a à dire notre époque dans une langue classique ou néo-classique. Ce classicisme contribue à donner cohérence, dans un texte dépourvu de dialogues, à un narrateur homodiégétique dont l’univers est celui de l’écrit, journalistique et littéraire. La belle langue de Youness Bousenna met en relief la finesse d’un personnage qui s’exprime souvent par axiomes : on devine que la découverte chez un bouquiniste d’un texte de Pascal sur la vanité humaine satisfaite de l’estime de quelques partisans seulement est une sorte de catalyseur du récit. Moraliste sans éthique déclarée, Marc Pépin glose sur sa vie, de même qu’il glose sur la pensée pascalienne, introduisant une sorte de memento mori : « La vérité est que la fortune est douce parce qu’elle est mensongère, qu’on le sait et qu’on aimerait qu’elle dure éternellement… »
Enfin, ce roman participe à ce qu’on pourrait appeler un nouveau moment grammatical en littérature. Celui-ci se manifeste dans Les Présences Imparfaites sous la forme d’un réexamen de la concordance des temps, comme le titre d’emblée l’indique. On se souvient du débat qui a opposé Albert Thibaudet à Proust, Barthes à Sartre autour de Flaubert — l’enjeu étant la place tenue par la grammaire dans la définition de la littérature. Récemment, la littérature à succès a obtenu le droit de « balancer sa grammaire ». Parallèlement, on assiste au retour de l’“écrire classique”, que ce soit dans l’œuvre de Marie NDiaye, ou encore dans les Vies minuscules de Pierre Michon ; et, justement, dans Les Présences Imparfaites où le talent de l’auteur se manifeste notamment par sa manipulation de la concordance des temps :
« Après mon départ, Le Figaro avait dépêché un pigiste pour maintenir la couverture de la guerre. Elle durerait encore trois ans. C’était une sale guerre, comme on dit finalement de toutes les guerres, peut-être pour insister sur le fait que le mot guerre ne suffit plus. Ou que la guerre était intolérable depuis qu’elle avait été mondiale : la guerre d’Algérie était une sale guerre, autant que celle du Vietnam, du Golfe, de Syrie. Que des sales guerres, qui sont d’abord les guerres propres d’un sale monde. Ces précautions énoncées, je qualifie quand même de sale cette guerre Iran-Irak. Elle se terminerait en août 1988 par un cessez-le-feu sous le patronage de l’ONU… Mais j’en étais déjà loin. »
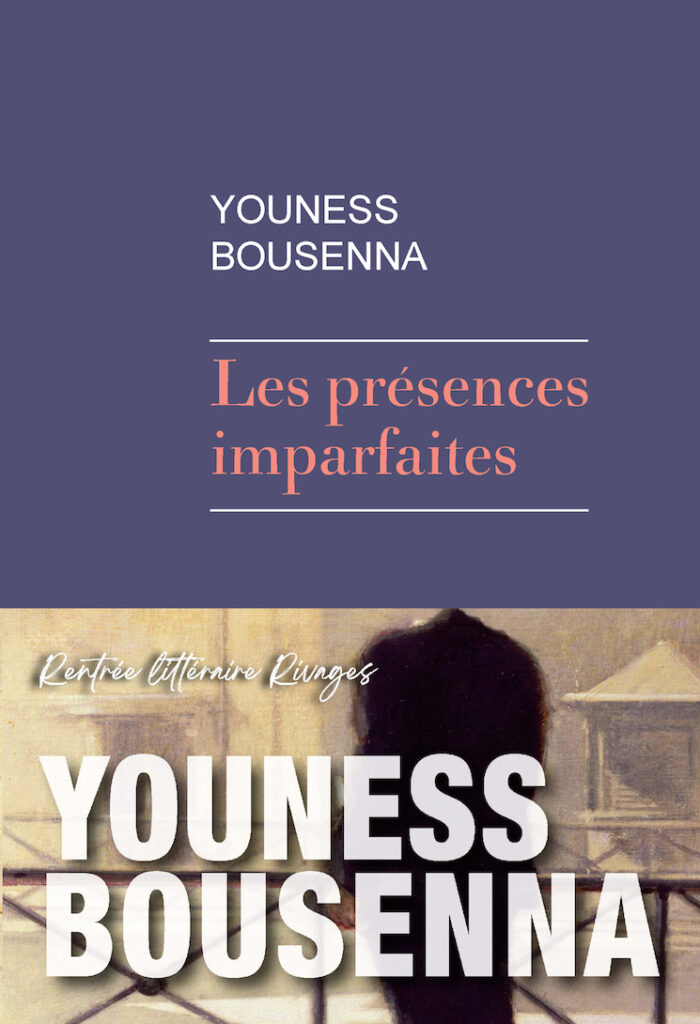
Qu’avez-vous pensé du projet de Marc Pépin, le narrateur, qui décide à âge avancé, d’écrire sa vie ?
Sylvie Kandé : Il faut avoir vécu pour trouver non la matière de son autobiographie, mais le concept qui lui donnera forme. Rousseau a écrit ses Confessions à cinquante ans passés ; Gorky sa trilogie entre quarante-cinq et cinquante-cinq ans ; Annie Ernaux continue de puiser dans sa vie et celle de ses proches pour écrire : en témoigne son Jeune homme, publié en 2022.
Évidemment, dans Les Présences Imparfaites, ce n’est pas l’auteur qui se raconte ou prétend le faire, mais le protagoniste qui parle à la première personne, usant de l’auteur à ses propres fins, pour ainsi dire. Il y a pourtant au moins une homologie entre eux : leur maîtrise de deux registres d’écriture, journalistique et littéraire, ce qui donne parfois l’impression que leurs voix s’enchevêtrent. Lorsqu’à la fin du premier chapitre, Marc Pépin déploie son art poétique, si ténébreux, si romantique — ne veut-il pas écrire un livre « inutil[e], coinc[é] entre le temps et le néant », « jamais vendu », qu’on trouvera peut-être par hasard un jour dans ses affaires — l’auteur est obligé de préciser les termes du contrat de lecture par la bouche de son personnage dont il met le projet au défi : « S’il m’arrive de dire vous, c’est pour tromper la solitude parce qu’on n’écrit pas pour soi ». C’est pourtant Marc Pépin qui reprend la main, affirmant que ces autres pour lesquels on écrit sont vides de toute substance ou fonctionnent comme simples intermédiaires vers une réussite toujours élusive. En une allusion possible à L’Étranger, Marc Pépin annonce que son récit ne donnera lieu ni à un procès, ni à des confessions : « Je n’attends d’ailleurs aucun jugement », précise-t-il. Aucun pardon non plus, ce qui rend dérisoire celui qui lui offre en fin de compte Claire, son ex-compagne. L’amour vainc tout, comme elle l’affirme, sauf la conscience qu’a ce protagoniste de la médiocrité de son zénith, de l’irrémédiable stérilité d’une existence pourtant examinée…
De par sa volonté d’écrire sa vie sans entretenir quelque projet de publication ou de lecture de son œuvre par un tiers, si ce n’est par accident, Marc Pépin entreprend un projet qui soulève de nombreuses interrogations sur ce qu’est la littérature : un texte a-t-il nécessairement besoin d’être publié ou lu pour être considéré comme de la littérature ? Un écrivain est-il uniquement celui qui publie ?
Sylvie Kandé : Avec le topos du journal intime, celui de Marc Pépin que l’auteur dévoilerait au public, on rejoint celui du manuscrit trouvé, exploité avec brio par Cervantes, Sartre et tant d’autres : ce stratagème littéraire permet au narrateur de se livrer sans fard, puisqu’il ne sera pas lu. Marc Pépin commence la rédaction de son manuscrit par devoir de « faire le point », ayant constaté en juillet 2019 que la boucle était bouclée avec son retour au Thiais de son enfance. Il décrit cette analyse de soi qu’il a entreprise comme un livre (en puissance, on le comprend) « qui n’aura aucun prix ni dépôt légal ». Auteur de quatre livres précédents, dont le dernier n’a remporté aucun succès, le narrateur des Présences imparfaites feint ici de mépriser le destinataire de ce nouvel ouvrage en cours, la reconnaissance qui vient avec la publication et la valeur marchande attribuée au livre-produit : de fait, il désavoue son autorité d’auteur qui consiste, comme on le sait, en une responsabilité morale et juridique autant que littéraire. Ce penchant pour la fuite est une constante dans le peu de vie qu’il a en dehors de sa carrière de “grand reporter” : il élude ses responsabilités dans le déchaînement de violence qui a brisé son couple, esquive l’idée d’accueillir chez lui sa mère sénile. Tiède en amitié, il ne se soucie guère du sort de ses informants et alliés d’hier. C’est par un documentaire qu’il apprendra la fin tragique de son ami, le colonel Hassan Al Hamdani à qui il doit la vie et dont il avait tiré inspiration pour son second roman, Un destin irakien. Il comprend qu’Hassan, devenu cadre dans le mouvement islamique à l’issue de sa détention à Abou Ghraib, était un homme à abattre.
Un livre est un projet qui comprend de nombreuses phases, depuis l’intuition, l’image qui le catalyse, en passant par les doutes qui ralentissent son écriture, le désespoir de ne jamais finir, l’influence de nouvelles lectures ou de l’actualité qui poussent le manuscrit dans une direction imprévue, les cris des personnages qui demandent à être entendus, jusqu’à la recherche d’un éditeur enthousiaste. La publication n’est que la dernière étape de ce processus, mais elle a un caractère définitif et social. Voilà pourquoi l’échec de la rencontre à la librairie des Volcans à Clermont-Ferrand autour des Mains pleines, le quatrième ouvrage de Marc Pépin, sonna le glas de ses ambitions littéraires : « l’humiliation entérina mon choix d’arrêter d’écrire » reconnaît-il. Ou plutôt il entérina son souhait de ne plus être publié, comme en témoigne cet ultime « manuscrit trouvé » fictif qui deviendra censément Les Présences Imparfaites.
Le temps de latence entre deux efforts de rédaction prolongés participe au travail d’écriture : il permet à l’imagination de s’alimenter, au désir d’écrire de s’affirmer, à la posture d’auteur de se transformer. Même une œuvre inachevée ne remet pas nécessairement en cause le statut de l’artiste : songeons à De Vinci ou Orson Welles. Marc Pépin est écrivain non parce qu’il analyse sa vie en flash-back successifs et complémentaires, mais parce qu’il ressent la nécessité de se comprendre dans et par la langue. À cet égard, des cartes de tarot, consultées par simple désœuvrement, lui offrent à l’improviste une splendide métaphore, celle du chariot qui maintient sous le même joug deux chevaux récalcitrants. Clé qui ouvre sur son intériorité troublée, cette métaphore en vient à donner sens à son récit autobiographique tout entier : « Les deux bêtes, harnachées ensemble mais aux courses divergentes, résument l’énergie noire et l’énergie blanche qui m’écartèlent : tantôt rage, furie, hargne, violence ; tantôt compassion, bonté ».
Le roman de Youness Bousenna tient évidemment aussi de la chronique. L’auteur brosse une fresque qui va du conflit Iran-Irak des années 1980 jusqu’en 2019, en passant par ledit “printemps arabe”. Chemin faisant, quelques aspects des coulisses du métier de journaliste nous sont révélés…
Sylvie Kandé
À travers les réflexions qu’il déploie sur son métier, son époque et les changements introduits dans la société au cours des dernières décennies, ce personnage semble par moments se proche des mémorialistes…
Sylvie Kandé : J’ai proposé de voir Les Présences Imparfaites comme un bildungsroman puisque nous suivons l’évolution personnelle et professionnelle de Marc Pépin depuis l’adolescence jusqu’à la phase ultime de sa carrière au Figaro. L’ascension de ce narcissiste, due à son aisance à l’écrit et à la bienveillance putative de ses collègues, est fulgurante. De correcteur, il devient en effet reporter de guerre, sous-chef puis chef de la rubrique Maghreb-Moyen-Orient, et enfin rédacteur au service voyages, une confortable pré-retraite. Il confie cependant que « [l]’ascension [lui] donna une sorte de mollesse, un relâchement » ; elle ne parvint pas non plus à guérir son âme.
Le roman de Youness Bousenna tient évidemment aussi de la chronique. L’auteur brosse une fresque qui va du conflit Iran-Irak des années 1980 jusqu’en 2019, en passant par le dit “printemps arabe”. Chemin faisant, quelques aspects des coulisses du métier de journaliste nous sont révélés : la culture du secret qui entoure la recherche d’informants dits fixeurs pour les reporters, le traitement privilégié des journalistes par les ambassades, leurs voyages diplomatiques. Défilent plusieurs gouvernements, incarnés par Chirac et Juppé, Sarkozy, que Le Figaro doit ménager ; on voit Dassault racheter l’empire de Hersant, ainsi que les déménagements, compressions de personnel et grèves s’ensuivre au journal. La société métropolitaine se transforme radicalement : téléphones portables et ordinateurs apparaissent ; les télécommandes autorisent des usages interactifs de la télévision, tandis que Internet et les EHPAD se généralisent.
Si le narrateur a choisi le temps long pour son récit, c’est qu’il lui paraît plus propre à saisir ces changements socio-culturels mais aussi la vérité de son corps qui enlaidit, les conséquences à long terme de la faute qu’il a commise contre son bonheur : « On aime lire les vies courtes. Elles mentent », tranche-t-il. En lisant Les Présences Imparfaites, je ne pouvais que penser aux Mémoires d’Hadrien, fiction historique longue dans laquelle Yourcenar reconstitue la voix d’un homme vieillissant, malade, rongé par un amour perdu, et qui fait un bilan, parfois sévère, toujours lucide, de son œuvre impériale sur terre.
Youness Bousenna a assigné au narrateur des Présences Imparfaites ce sentiment de distanciation glacée qui caractérise Meursault vis-à-vis d’un monde toujours pareil où tout se répète ad nauseam et dont il ne faut attendre nulle rédemption.
Sylvie Kandé
Comme Hadrien, la figure historique du roman de Marguerite Yourcenar, Marc Pépin est un pessimiste dont nous entrevoyons les contradictions et le changement au fur et à mesure qu’il écrit sa vie. Qu’en avez-vous pensé ?
Sylvie Kandé : Les dés sont pipés puisque le personnage, en nous présentant la version de lui-même qu’il veut imposer, sélectionne, efface, force le trait. Parce qu’il cherche encore à se comprendre et peut-être à se justifier en dépit de ses dénégations, Marc Pépin va mettre en avant des lignes de force, des cohérences dans son existence, de possibles circonstances atténuantes pour ses méfaits. La contradiction la plus évidente chez lui, c’est que, ce faisant, il continue de s’observer avec une lucidité quasi-insoutenable. La grande réussite du roman de Youness Bousenna est de montrer, derrière la belle carrière du journaliste et écrivain qu’est Marc Pépin, le champ de ruines d’une vie dominée par la détestation de soi, la violence et le mépris des autres (y compris de sa propre mère) ainsi que par la recherche effrénée et sournoise de la reconnaissance sociale. Ne reprend-il pas d’ailleurs un mot célèbre de La Rochefoucauld, « le refus des louanges est un désir d’être loué deux fois » ? N’avoue-t-il pas l’influence sur son propre travail du Cantique de la Racaille de Vincent Ravalec dont le protagoniste est, lui aussi, en quête de respectabilité, quoiqu’il en coûte.
Dans Les présences imparfaites, il y a des pages terribles sur la laideur du protagoniste, décrite avec minutie, par lui-même : « … je n’ai jamais trouvé nécessaire », fait-il observer, « de compenser ma laideur par le luxe… ». Ce complexe le pousse néanmoins à s’afficher avec une femme intelligente, belle et aimante, Claire, qu’il gaslighte, torture sciemment par d’odieux propos et finit par rouer de coups. Cette violence que Marc Pépin porte en lui, il ne la met pas au compte de la peur éprouvée au cours des combats dont il a été témoin en tant que reporter de guerre — aux lecteurs et lectrices de le comprendre — il croit plutôt éprouver « la saveur de frapper ». Il faut ici saluer le courage de Youness Bousenna qui, prenant à bras le corps le thème des violences conjugales, parvient à montrer, en un passage saisissant, l’intériorité d’un personnage trop lâche pour admettre, sinon après-coup, son dégoût d’un bonheur tranquille qu’il ne croit pas mériter et sa responsabilité complète dans la catastrophe : « La nuit de Montpellier interrompit ce tsunami d’habitudes et de fuites », se remémore-t-il. « À partir de là, tout m’insupporta définitivement : le clapotis de sa peau quand elle l’enduisait de crèmes, celui de sa bouche en mangeant… ». Le projet de Neige Sinno, dans Triste Tigre, n’est pas foncièrement dissemblable, puisqu’il s’agit là aussi, de tenter de saisir la logique pervertie du monstrueux. Lentement, sa prise de conscience de l’énormité d’un forfait qui mit fin aux seules années de bonheur qu’il admet avoir connues plongera Marc Pépin dans la névrose, l’isolement, la folie : sale et débraillé, il n’ose retourner à l’appartement qu’il a détruit de ses propres mains, somatise son mal-être, se joue en boucle le film de son hypothétique emprisonnement et de sa mort à venir. La fin du roman n’apporte pas de solution à ce qu’il appelle ses crises, le condamnant à une quasi-éternité d’autodestruction.
Youness Bousenna a assigné au narrateur des Présences Imparfaites ce sentiment de distanciation glacée qui caractérise Meursault vis-à-vis d’un monde toujours pareil où tout se répète ad nauseam et dont il ne faut attendre nulle rédemption. Lorsqu’il est maintenu en Irak par sa hiérarchie, Marc Pépin note : « … tout m’était devenu étranger, absurde, l’existence des autres lointaine », analysant avec une brutale clairvoyance le sens de sa mission : « Être journaliste, c’est prétendre que tous les problèmes de l’univers vous concernent… C’est faux, j’étais là pour moi ». L’absence de principe constitutif, de « grande chose ineffable, [d’] espèce de bâton » au centre de son existence fait que tout s’y juxtapose de manière indifférenciée : Les Présences Imparfaites est un bildungsroman sans arc de progrès.
Youness Bousenna est un grand styliste et son engagement esthétique crève la page. Voyez comme il décrit l’approche du millénaire et les célébrations qui, indûment, le précèdent…
Youness Bousenna
Outre ce narrateur construit avec adresse, la présence de personnages réels et fictionnels, Les Présences Imparfaites se distingue magnifiquement de nombreux romans contemporains en raison de certains choix esthétiques de Youness Boussena : utilisation d’une langue classique à des fins de narration d’un récit contemporain, mélange d’ironie et de poésie, présence de mots arabes et anglais intraduits. Ces choix esthétiques vous ont-ils séduite ?
Sylvie Kandé : Absolument. Je crois d’ailleurs qu’il est temps de revaloriser la notion de style qui a disparu au profit de celle, utile certes mais pas équivalente, d’écriture. Youness Bousenna est un grand styliste et son engagement esthétique crève la page. Voyez comme il décrit l’approche du millénaire et les célébrations qui, indûment, le précèdent : « Ces moments imprègnent ma mémoire des nineties, années curieusement ascensionnelles que la fiction des chiffres me faisait assimiler à une montée vers le zéro : 2000. Les alpinistes appellent ‘mal des cimes’ la torpeur à l’approche d’un sommet convoité. Le pic précède le gouffre, comme le sentier de notre décennie débouchait sur une immensité — un millénaire ». Ce passage est caractéristique des gloses en deux ou trois phrases qui jonchent le récit : chacune d’elles surenchérit de profondeur ou d’ironie sur la précédente. Du jeu poétique sur le système décimal proposé par le narrateur surgit l’image du vallonnement des siècles, d’un gouffre ouvert entre millénaires qui devrait paraître redoutable à qui est à l’affût du sens des choses : hélas, la torpeur règne. Seul le narrateur voit l’ironie derrière les chiffres, 2000 comme montée vers le zéro, et le danger au tournant, cette effroyable immensité de l’inconnu. Il préfère une expression en anglais (the nineties) à sa traduction française parce qu’elle fait référence non pas uniquement au temps écoulé mais à la culture qui s’est développée dans la décennie. De la même façon, il conserve dans son texte la formule « Dieu est grand » en arabe pour ne pas attenter à sa majesté par des transpositions plus ou moins erronées, ou encore parce qu’elle est ainsi figée dans ses souvenirs de guerre.

Dans Les Présences Imparfaites, on constate aussi que malgré l’emploi du pronom personnel « je », Marc Pepin traduit régulièrement le ressenti et le récit de celles et ceux qu’il côtoie. Diriez-vous qu’il s’agit d’un personnage qui porte en lui une multitude de voix et donc d’histoires ?
Sylvie Kandé : « Nous sommes notre centre du monde », lance Marc Pépin qui dénonce la thèse de la proximité téléologique à-la-Candide pour l’appliquer tout de même à sa condition : au regard de tous les malheurs qui auraient pu le frapper, il s’estime rescapé de la vie, même s’il lui faudra tôt ou tard repayer cette dette. La formule qui ouvre le septième chapitre suggère que, pour le protagoniste, l’individualisme est l’une des choses du monde les mieux partagées. Témoin privilégié de son temps de par sa profession, il n’est pas indifférent aux histoires des autres. De fait, le récit contient une série de jolies vignettes : ce sont des visages familiers, ceux de collègues de bureau comme Mireille et Diego, de membres de la famille (ses parents, sa sœur Anne), d’anciens informants (Ahmad au Kurdistan, Tchinguiz au Kirghizstan) et même la silhouette du chien-mascotte du journal, Frisbee. Marc Pépin est cependant bien incapable d’aimer les gens qui l’entourent, ou tout au moins de s’avouer qu’il les aime, par peur probable de parodier les conventions du discours amoureux — car il y a du Julien Sorel chez lui. Par conséquent, il ne sait pas porter leurs histoires qui ne filtrent que difficilement au travers des interprétations qu’il leur fait subir. De ce point de vue, le passage suivant est des plus révélateurs : « Un texto d’Anne prévenait : ‘J’ai eu Maman, tout va bien.’ Je l’appelai tout de même… l’infirmière venait de la visiter. Gentille comme tout, m’avait-elle dit. Comme tout, c’était joli. Comme si tout était postulé gentil : le grand tout qui nous entoure serait bien intentionné ».
Dépourvu d’empathie, ce misanthrope au fond se déteste : « Pour aimer sa vie », déclare-t-il, « il faut aimer autre chose. Des idées, les autres ». Peut-être faut-il voir là une critique d’un certain journalisme carriériste, exercé sans passion ni cause embrassée.
Les Présences Imparfaites est l’un de ces textes majeurs auxquels il faut régulièrement revenir car une seule lecture ne saurait en épuiser la richesse et la beauté.
Youness Bousenna
Un dernier mot sur Les Présences Imparfaites et Youness Bousenna ? À quels mouvements et figures littéraires l’associerez-vous ?
Sylvie Kandé : C’est un roman qui, dans sa singularité, doit effectivement faire partie du canon, pour sa richesse thématique et formelle. Il ne serait évidemment pas malvenu d’ajouter Les Présences Imparfaites à la bibliothèque de l’absurde ou à celle de l’existentialisme. Excellent exemple de la manière dont la fiction traite l’événement ou bien se trouve retravaillée par son intention de mettre l’Histoire en scène, le roman de Youness Bousenna — où sont évoqués l’essor et le déclin de Daesh, l’ombre grandissante de Poutine, les derniers jours de règne de Mubarak —pourrait faire partie d’un corpus de fictions écrites par des journalistes, celles de Sorj Chalandon, d’Albert Camus, d’Albert Londres, entre autres.
Pour les besoins de la classification, Les Présences Imparfaites se définit comme récit fictif à la première personne, quoique l’auteur ait réussi à brouiller subtilement la frontière entre ce genre et celui de l’autobiographie. Non linéaire, la narration ne présente donc pas les événements dans l’ordre que le protagoniste a connu et les signes de fictionnalité, citations directes ou dialogues, sont rares voire inexistants, contrairement aux conventions du récit fictif. Le voisinage, au sein du texte, de personnages ayant existé et de personnages fictifs compte parmi les autres effets de réel déployés par le roman. Plus généralement, je dirais que Les Présences Imparfaites est l’un de ces textes majeurs auxquels il faut régulièrement revenir car une seule lecture ne saurait en épuiser la richesse et la beauté.
