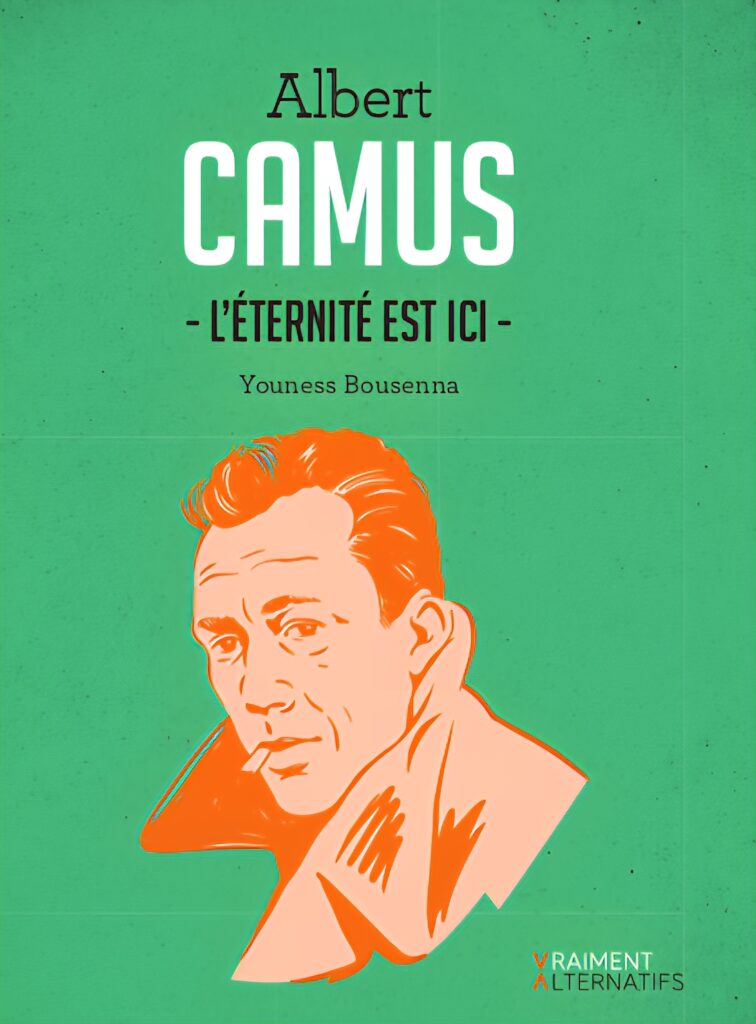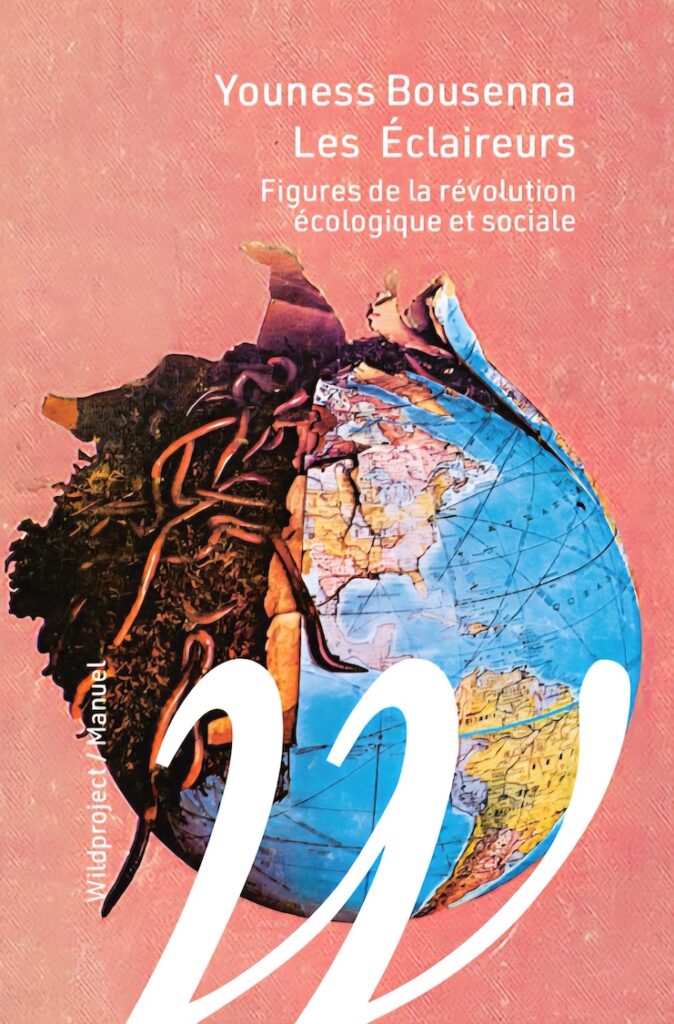Directrice pédagogique à la Washington International School, la romancière Carole Geneix figure parmi les férus de littératures qui ont lu avec émerveillement Les Présences Imparfaites de Youness Bousenna. Dans ce deuxième volet d’une série consacrée à l’œuvre du jeune romancier français, elle analyse avec dextérité son grand texte existentialiste.
Vous avez dernièrement lu avec minutie Les Présences imparfaites, le premier roman publié par le journaliste et essayiste français Youness Boussena. Qu’avez-vous pensé de ce livre ?
Carole Geneix : Les Présences Imparfaites de Youness Bousenna est une œuvre inclassable faisant écho à ce que j’appellerais « mes classiques » de l’autobiographie. En vrac : Jean-Jacques Rousseau, Marcel Proust, Albert Camus, Amélie Nothomb et Annie Ernaux. Cela tient peut-être au fait que l’auteur, Youness Boussena, journaliste de formation, semble « baigner » dans les mots : il travaille dans l’univers des médias, écrit pour diverses publications, et a publié un essai intitulé Albert Camus : l’éternité est ici. Rien d’étonnant, donc, à ce qu’il aborde dans son premier roman le destin de Marc Pépin, un grand reporter qui va d’abord vivre les conflits au Moyen-Orient, le changement de millénaire, l’avènement de la technologie pour finir par « se ranger » dans une existence plus banale d’écrivain de modeste envergure, au regard désabusé tant sur le monde que sur sa vie.
Justement, Les Présences imparfaites est un livre de confessions né sous la plume de Marc Pépin, un journaliste du Figaro, qui décide à cinquante-huit ans d’écrire sa vie pour l’étudier, sans ambages. Que pensez-vous de ce projet d’étude de soi à travers la littérature ?
Carole Geneix : C’est un projet étonnant, car même s’il touche au genre de l’autobiographie ou plus précisément de ce que l’on appelle l’autofiction, si prisée en France, ce projet est totalement fictif : l’œuvre est romanesque et non autobiographique. Ce narrateur n’est pas une représentation déguisée de Youness Bousenna. Certes, celui-ci est aussi journaliste, mais il a vingt ans de moins que son narrateur qui, lui, approche de la soixantaine : le livre est une fausse autobiographie. Qu’est-ce à dire ? L’enjeu est complexe : au-delà de l’enchaînement des événements, souvent liés à la géopolitique et au destin des proches du narrateur (les collègues Hassan et Diego, la mère, son ex compagne Claire qu’il ne parvient pas à oublier), le texte est une réflexion sur le processus autobiographique lui-même en littérature : la sélection des souvenirs, les relations du passé et du présent, la quête de la vérité intérieure, les influences sociales et politiques sur la construction du Moi.
Dans Les Présences Imparfaites, les rôles de la littérature sont savamment mis en avant : si elle permet au protagoniste d’entreprendre une introspection, elle apparaît aussi comme un signe de distinction, pouvant conférer à celui ou à celle qui écrit un surcroît d’intérêt et d’importance dans la société. Quel avis portez-vous sur ces réflexions ?
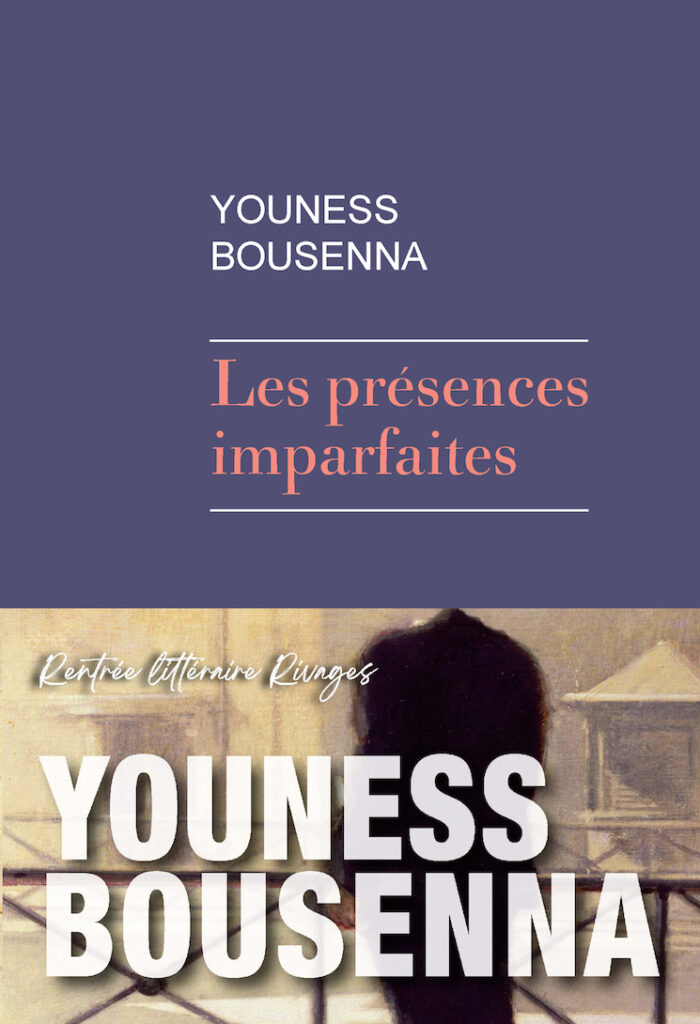
Carole Geneix : Je me pose beaucoup la question de ce que représente la littérature aujourd’hui, à l’ère des réseaux sociaux, des formes courtes, de l’autoédition, de la saturation du marché du livre, et maintenant de l’intelligence artificielle qui, qu’on le veuille ou non, bouleverse nos façons d’écrire. Habitant aux États-Unis, la distance physique que j’ai avec la langue française et la France me permet aussi de prendre une distance intérieure avec la notion de littérature telle qu’on la pense et la pratique en France, notamment dans sa dimension institutionnelle. Dans Les présences Imparfaites, Youness Bousenna semble déconstruire la notion de littérature plutôt que l’explorer. Ce n’est pas un hasard si Marc Pépin revendique son droit à « faire de la littérature » à sa façon, sans aucun lecteur : « L’étude d’une vie sans filtre, je la ferai donc ici. Je veux dire pour personne, aucun lecteur, pas même moi. Ce sera le livre ultime. ».
Parmi les nombreuses réflexions mises en avant au sujet de la littérature dans Les Présences imparfaites, il y a pourtant l’impossibilité d’écrire uniquement pour soi, et le rôle du lecteur dans l’existence d’une œuvre littéraire...
Carole Geneix : L’impossibilité d’écrire uniquement pour soi (contredisant d’ailleurs la citation ci-dessus), c’est le propre de la littérature. L’écrivain trouve forcément son public, quel qu’il soit – restreint ou pas. À mon sens, Les Présences Imparfaites parle plus d’écriture que de littérature. Le fait que le protagoniste soit journaliste est important, car il illumine les liens forts entre journalisme et littérature, dont on parle assez peu : « le journalisme, c’est avoir l’accès aux grands et l’empathie pour les opprimés. L’écriture, c’est l’orgueil de s’offrir à la lecture du monde entier emballé dans l’humilité d’en douter. ». Les Présences Imparfaites est donc un roman qui gravite autour des mots. Il se termine d’ailleurs sur un « mot » – en l’occurrence ici, un message – donné au narrateur dans une salle de cinéma par un inconnu de la part de Claire (qui fut sa compagne) à la fin de la projection. Marc Pépin, en s’apercevant que Claire est dans la salle, s’est réfugié aux toilettes pour tenter de lui écrire quelque chose, mais il échoue. C’est elle qui a le dernier mot : « L’amour vainc ». Le roman se termine donc sur les mots de quelqu’un d’autre, un comble pour Marc Pépin, journaliste devenu écrivain, devenu autobiographe, et qui n’a pas trouvé le mot de la fin.
Toujours au niveau de l’écriture, l’une des forces de ce livre se situe dans le fait que le protagoniste-auteur et narrateur attire dès le premier tableau l’attention du lecteur sur la genèse d’une œuvre littéraire autobiographique en construction, que ce dernier lit. Comment avez-vous perçu cette mise en abyme de l’écriture, qui par ailleurs crée quelque filiation entre Marc Pépin et le narrateur de La Recherche ?
Carole Geneix : J’ai moins « entendu », dès les premières pages, le narrateur de La Recherche que celui de L’Étranger de Camus ou d’autres narrateurs de textes existentialistes tel que celui de La nausée de Sartre, et n’ai pas tant vécu la mise en abyme de l’écriture qu’une « présence » puissante du narrateur, même si celle-ci se fait au passé. Ce concept de présence apparaît d’ailleurs dès le titre (Présences imparfaites). On « entend » très nettement la « voix » du narrateur, portée par un style puissant.
Youness Bousenna montre avec justesse les bouleversements géopolitiques de toute une époque tout en s’attachant au détail de la vie quotidienne des gens. La description du travail de grand reporter de Marc Pépin, notamment lors de la guerre en Irak, est très intéressante.
Carole Geneix
Qu’avez-vous pensé de Marc Pépin, le protagoniste-auteur et narrateur de ce roman ?
Carole Geneix : Certains lecteurs le trouveront certainement antipathique : cynique, d’une violence aveugle avec Claire, sans attaches véritables. Bizarrement, j’ai tout de suite eu de la sympathie pour lui, me retrouvant dans sa vision de l’enfance : « Nous sommes notre centre du monde. Enfant, je conçus l’idée que tout avait été inventé pour moi. » Au-delà de son ancrage dans le temps, cet être étranger à ses propres émotions me rappelle Meursault, le narrateur inoubliable de L’Étranger. Sauf que dans son cas, le basculement dans la violence aveugle et irraisonnée envers sa compagne Claire n’aboutit pas comme dans L’Étranger au meurtre ni à une transformation intérieure quelconque. Tandis que Meursault trouve une sorte de grâce à l’approche de la mort, Marc Pépin reste un personnage en demi-teinte, qui n’évolue pas vraiment au cours du roman. Il en revient au point de départ à la fin, et c’est un constant désolant qui conclut le livre et qui fait de lui un être blessé, comme le montrent ses mots : « En commençant par le début, Thiais. Jusqu’à cette fin, Thiais. Qu’au fond je n’ai jamais quitté. ».
Lequel des différents passages du livre vous a le plus séduit ?
Carole Geneix : La première partie du livre – celle qui retrace la carrière de grand reporter de Marc Pépin dans le monde entier et notamment au Moyen-Orient – est la plus originale. Certes Youness Boussena est journaliste lui aussi, et connaît bien ce milieu, mais il a su retracer parfaitement les grandes lignes de toute une époque, qui est plus ou moins la mienne puisque le narrateur est à peine plus âgé que moi ! Au travers du destin de Marc Pépin, Youness Bousenna a également retracé certains aspects de la vie de ces personnes issues de cette « génération X », dont je fais partie, qu’il campe avec un certain humour : « Vue d’aujourd’hui, notre adolescence ressemble à l’âge de pierre. » Ou encore, cette citation qui m’a fait sourire : « Naître sans télévision, mourir avec Instagram. ». Je suis admirative du travail de recherche qui a nourri cette première partie. Youness Bousenna montre avec justesse les bouleversements géopolitiques de toute une époque tout en s’attachant au détail de la vie quotidienne des gens. La description du travail de grand reporter de Marc Pépin, notamment lors de la guerre en Irak, est très intéressante. La volonté de s’arrêter en 2019 n’est sans doute pas un hasard (bien que je ne connaisse pas la date réelle de l’écriture de ce livre) : c’est « avant ». Tout comme l’attaque du 11 septembre 2001 a marqué le début d’une nouvelle ère, la pandémie de 2020 a été une rupture profonde dans la société. Il était logique de s’arrêter juste avant.
Les Présences Imparfaites est un premier roman prometteur et déroutant, qui porte extraordinairement bien son nom. Le pluriel renvoie à la pluralité des expériences qui y sont contées : guerre, vie à l’étranger, rapports conjugaux, violence physique, célébrité, monde du journalisme puis de la littérature, reconnaissance sociale, solitude…
Carole Geneix
Qu’avez-vous pensé des passages durant lesquels le narrateur montre les effets du temps sur les corps, notamment âgés ?
Carole Geneix : Ce rapport à la vieillesse du corps et de l’esprit est l’un des aspects les plus fascinants de ce texte, écrit du point de vue d’un homme qui se considère comme « fini », approchant la soixantaine, par un trentenaire qui a gagné en 2024 le prix Fénéon récompensant un « jeune auteur » ! Le réalisme du livre est particulièrement réussi, fruit sans doute de recherches poussées sur l’histoire de France récente ainsi que d’une grande maturité d’esprit de l’auteur, et qui ne fait qu’accroître notre envie de lire d’autres œuvres de sa plume.
Quels termes emploierez-vous pour qualifier Les Présences Imparfaites et le style de Youness Bousenna ?
Carole Geneix : Les Présences Imparfaites de Youness Bousenna est un premier roman prometteur et déroutant, qui porte extraordinairement bien son nom. Le pluriel renvoie à la pluralité des expériences qui y sont contées : guerre, vie à l’étranger, rapports conjugaux, violence physique, célébrité, monde du journalisme puis de la littérature, reconnaissance sociale, solitude, et j’en passe ! Le concept de présence porte le livre : une présence dénote l’existence d’un être humain, au présent comme au passé, et exemplifie ce va-et-vient constant, dans l’autobiographie, même fictive, entre le passé et le présent. Enfin, le thème de l’imperfection, de l’échec aussi, parcourt le livre. Il y a une grande sincérité du narrateur face aux déboires de sa vie et au « gâchis » que la sienne représente à ses yeux. Le côté inachevé du livre, avec une dernière phrase qui ne lui appartient pas et reste sibylline, en est l’exemple ultime : « L’amour vainc. ».

Pour ce qui est du style de Youness Bousenna, je l’ai trouvé à la fois dépouillé et poétique, m’évoquant Camus. Au-delà du personnage principal et de la peinture sociale d’une fin de siècle, le style est une des grandes forces de ce livre. Cela permet au lecteur de ne pas voir ce « anti-héros » d’une façon simpliste mais nuancée, à l’instar de Meursault, le narrateur de L’Étranger. Comme Meursault, il est plus ou moins détaché de sa vie, étranger à ses propres émotions, à ses proches aussi. Parfois manipulateur, en particulier avec Claire, ou bien indifférent, comme lorsqu’il parle de sa mère en fin de vie dans un EHPAD. Dans un monde polarisé où le discours politique est souvent réducteur, un peu de nuance fait du bien ! L’ancienne prof de lettres qui sommeille en moi a repéré des aspects stylistiques intéressants, comme l’utilisation de métaphores filées telles que celle de la vitre : « J’ai découvert tant de mondes nouveaux, mais toujours à travers la même vitre. » La vitre, c’est ce qui sépare, c’est la distance, la vitrine des magasins du centre commercial de Belle Épine, la surface du miroir… À la fin du livre, c’est aussi cette prise de conscience d’avoir tout vécu sans s’être vraiment impliqué.
Outre Albert Camus, à quelles autres figures littéraires associerez-vous Youness Bousenna ?
Carole Geneix : Je vois des échos dans deux mouvements : l’existentialisme et l’autobiographie « sociologique » dans la veine d’Annie Ernaux, tout au moins dans la première partie, comme le montre cet extrait : « Être de Thiais, c’était faire partie de cette gigantesque ceinture de laideur et de pollution cernant Paris, remplie par ces bataillons de subalternes (personnel de ménage, hôte d’accueil, secrétaires, petits chefs) ayant le droit d’y accéder quelques heures, pour travailler ». Le roman commence d’emblée par une analyse sociologique, continue par une fresque historique et politique pour se terminer par des accents existentialistes : « J’ai commencé peu après à écrire ces lignes, dans ce mois de juillet où la canicule m’oblige à passer la journée les volets fermés. Je devais faire le point. En commençant par le début, Thiais. Jusqu’à cette fin, Thiais. Qu’au fond, je n’ai jamais quitté. Tel un satellite, j’ai tracé une grande révolution, en orbite autour de cette étoile dont l’éloignement ne m’a pas dépaysé. J’ai découvert tant de mondes nouveaux, mais toujours à travers la même vitre. Ils m’ont tout au plus permis de divertir la réclusion perpétuelle en moi, dans mon corps et ce passé où reste tapi Belle Épine, ses désirs, les immeubles tristes, ma jeunesse d’ennui et ses quelques joies minuscules mais finalement belles, parce qu’elles étaient nouvelles et que le temps n’avait rien émoussé. ».
Un dernier mot sur ce que ce roman montre de la littérature ?
Carole Geneix : Ce roman est d’abord une belle réflexion sur l’écriture. Il met brillamment en scène la trajectoire (pourtant réussie) d’un écrivain qui se considère globalement comme un écrivain raté (une dialectique intéressante venant d’un primo-romancier). C’est aussi une œuvre littéraire qui fait la part belle à une analyse sociologique de la société française dans la veine d’Annie Ernaux. Une jeune plume qui reprend les codes de la « grande » littérature française dans le sillage d’Albert Camus et d’Annie Ernaux pour nous inviter à quelque chose d’autre… Nous attendons le prochain roman ou essai avec impatience !