Livre phare de la rentrée littéraire 2024, Les Présences Imparfaites de Youness Bousenna a fortement séduit le scénariste Arnaud Lathière-Lavergne, qui nous livre ses impressions de fin lecteur dans ce troisième volet de la série consacrée à l’œuvre du jeune romancier français. Entretien.
Parmi vos derniers plaisirs lectoriels figure Les Présences imparfaites de Youness Boussena. Qu’avez-vous apprécié dans cet ouvrage ?
Arnaud Lathière-Lavergne : Il y a bien des aspects que j’ai aimés dans cet ouvrage, mais je m’en tiendrai à un seul : son niveau de réalisme, auquel j’ai été particulièrement sensible. Un réalisme d’abord matériel : Youness Bousenna parvient à embrasser une époque à travers une multitude de détails – des noms, des lieux, des objets, des descriptions du centre commercial Belle Épine à celles du bazar d’Och, de la Peugeot 504 à l’arrivée du CD-ROM, de l’avènement de l’Union européenne à la crise des subprimes. Le temps s’incarne dans les noms. Il est dans les choses, il est dans les mots. Cet aspect matériel se double d’un réalisme psychologique tout aussi remarquable. L’auteur pousse loin la complexité de son protagoniste, Marc Pépin. Il explore avec une acuité rare la conscience de cet homme, nous livre sans jugement toute l’étendue de son intimité psychique (ses désirs, ses manies, ses hontes, ses contradictions). Le texte possède ainsi une épaisseur humaine assez prodigieuse.
Les Présences Imparfaites est effectivement un roman qui permet d’accéder aux confessions écrites de Marc Pepin, un journaliste du Figaro, qui décide à 58 ans d’écrire sa vie pour mieux la comprendre, l’étudier. Quel regard portez-vous sur ce projet introspectif à travers la littérature ?
Arnaud Lathière-Lavergne : L’introspection de Marc Pépin a effectivement valeur d’étude. Personnage érudit, il s’exprime dans une langue volontiers analytique, où affleurent parfois des accents quasi-universitaires. Il multiplie les guillemets et les parenthèses, opère de petites digressions d’une grande finesse intellectuelle. De même, Pépin pense sa propre parole : il écrit dans une langue consciente de son appareil, voire méta-discursive. Tout concourt à faire de cette parole un instrument de pensée. En annonçant dès l’ouverture ce projet autobiographique, le roman exhibe d’emblée son dispositif critique, où le je s’éprouve comme objet de discours plutôt que comme source d’évidence. En nous indiquant également sa spécificité (la fabrique d’un texte en train de se faire), Youness Bousenna empêche son lectorat de croire à une transparence du récit. Il substitue à la clarté d’une vie racontée, l’opacité d’une vie qui se pense.
La conséquence du dispositif est que ce roman, pourtant bien fictionnel, m’a par moments fait l’effet de quelque chose proche de l’autofiction. Il s’y joue une sorte de fusion trouble entre l’auteur et son personnage-narrateur, qui bien sûr ne tient pas aux biographies respectives de Youness Bousenna et de son personnage, mais à leur rigueur intellectuelle et stylistique. Ayant lui-même pratiqué le journalisme et l’essai, je trouve cela intéressant que Youness Bousenna dote son personnage d’une compétence d’auteur « à sa mesure », au sens où il ne cherche pas à simplifier la conscience que Marc Pépin a de lui-même. Cela témoigne d’un positionnement par rapport à son personnage qui n’est absolument pas de surplomb, ce qui ajoute un surplus d’authenticité, de vérité à sa vie intérieure.
Ce projet introspectif s’accompagne entre autres d’une réflexion savante sur le milieu du journalisme et les accointances qu’entretient celui-ci avec le pouvoir politique en France et à l’international. Quel avis portez-vous sur ce choix narratif ?
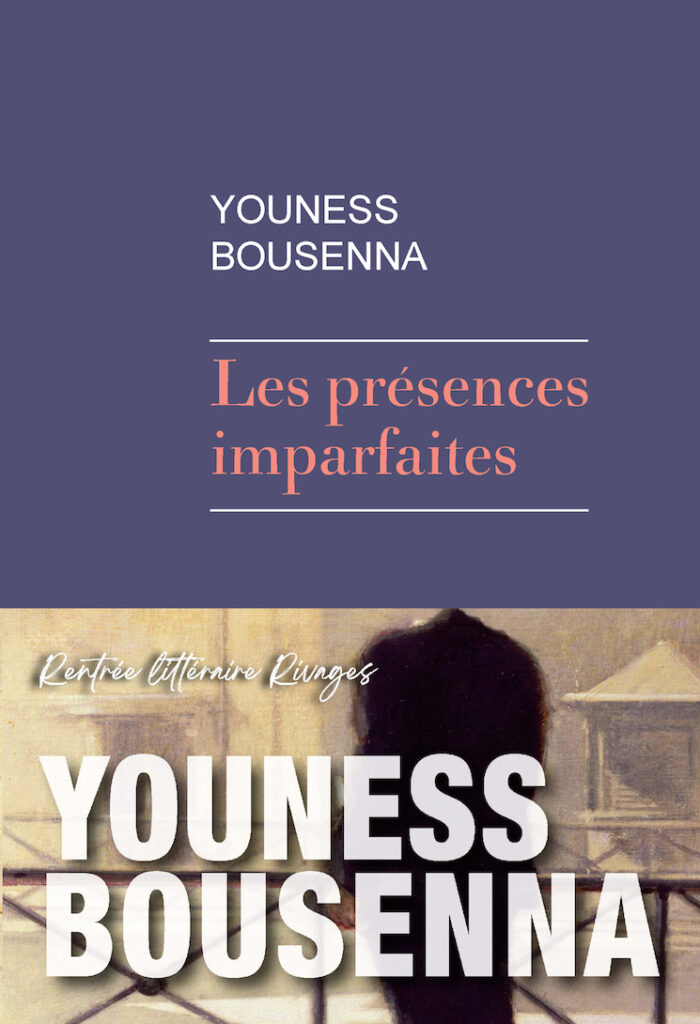
Arnaud Lathière-Lavergne : Le livre expose en effet la servilité de certains médias à l’égard du pouvoir et, plus profondément, la manière dont le métier de journaliste peut, à titre individuel, vous faire assimiler des paradigmes politiques tout à fait ambigus. Ainsi, Marc Pépin, en tissant des liens étroits avec des diplomates proches du président Moubarak, s’assure un accès privilégié à l’information pour ses articles. Plus tard dans le roman, il en vient même à déplorer, avec un certain cynisme, la fin d’une dictature qui lui était somme toute profitable : « La chute de ce président signifiait celle de mes habitudes : la démocratie compliquait mon boulot. » Mais le détour par le journalisme sert avant tout à dessiner un contexte géopolitique qui ne véhicule pas tant un message qu’un portrait d’« époque ». Il s’agit d’ancrer le personnage dans une réalité familière, de situer ses pérégrinations intellectuelles, de leur donner de la matière. L’usage que fait Marc Pépin des événements internationaux (guerres au Moyen-Orient, printemps arabes) comme matériau pour penser sa vie culmine dans cet extrait : « Ne rien faire plutôt que faire. L’abstention devenait mon sort comme celui de la démocratie. » Une léthargie individuelle qu’il faut rapporter à une léthargie politique : la paix sociale, offerte par les démocraties occidentales — auxquelles Pépin oppose « ces parties du globe où il se passe quelque chose, où l’histoire ne s’était pas achevée avec l’accession de tous à la propriété » — nous pacifie. La paix sociale signifie une forme de passivité vitale, à laquelle se cognent les désirs d’intensité du personnage.
Du reste, le choix de faire de Marc Pépin un journaliste me paraît très juste dans la mesure où Youness Bousenna l’est lui-même. En plus de dépeindre un milieu qu’il connaît, avec ses défauts et ses charmes (on sent une réelle tendresse pour cette profession, notamment pour les petits bonheurs de bureau), ce choix permet de donner au personnage un statut précis : celui du lettré. Et d’interroger du même coup le rapport à la langue. Exemple : en convalescence après avoir été blessé par des tirs de mortier en Irak, Marc Pépin relit ses reportages parus dans Le Figaro. N’y voyant qu’« éloquences sur des réalités tragiques », il imagine alors un journal de vérité qui s’adresserait ainsi au lecteur : « Lecteur, c’est le premier massacre auquel j’ai assisté dans ma vie. Moi aussi, j’ai grandi dans un endroit sans guerre, sans famine, sans épidémie, alors ne crois pas à mes phrases froides et bien tournées : j’étais terrifié par cette scène, je n’en ai pas dormi, des nuits je me réveille avec des images de visages énuclées, de viscères au sol, et je voulais hurler plutôt qu’écrire. » Hurler plutôt qu’écrire. La chair plutôt que le verbe. Les mots ne sauraient donc tout à fait restituer la densité sensorielle du monde et de nos corps traversés par lui. La phrase n’est jamais à la mesure de l’histoire. Elle ne saurait ramasser l’inhumanité du monde – sa vérité. Bousenna/Pépin formulent cette idée dans une énumération délicieuse, lorsque le personnage, en mission sous les feux de la guerre Iran-Irak, profite d’une pause pour rédiger son article : « Ce bref répit, durant lequel nous avalâmes un reste de mouton, me laissa le temps d’écrire un reportage à toute allure – percée des Iraniens, armée irakienne en déroute, crimes de guerre, scènes de désolation. » Que vaut cette chaîne de mots face à l’horreur ? Il faudrait la vivre, l’éprouver, la sentir passer pour comprendre la violence du monde.
Par ses aspirations ascensionnelles, nourries des frustrations d’une adolescence ennuyée, Pépin incarne peut-être l’avènement de l’individu et, avec lui, l’injonction libérale à l’accomplissement de soi : réussir sa vie, devenir son propre dieu.
Arnaud Lathière-Lavergne
En tant que scénariste, qu’avez-vous pensé de Marc Pépin, le protagoniste du livre ?
Arnaud Lathière-Lavergne : Du fait de son égoïsme, son cynisme, sa violence, rangeons Marc Pépin dans la famille des antihéros. Du fait de sa grande lucidité aussi quant au mal qui le ronge. Le plaisir narcissique de l’assumer. De déplaire. L’antihéros est celui qui appelle une empathie au moins partielle là où ses pensées et gestes nous sont moralement contraires. Ce n’est pas le cas de Marc Pépin. Pépin/Bousenna ne semble pas vouloir la sympathie de son lectorat, fût-elle contrariée. C’est d’ailleurs intéressant de noter que de tous les personnages du livre, Marc Pépin est celui qui m’inspire le moins d’empathie. Je me suis davantage attendrie pour les personnages secondaires : sa mère, sa sœur Anna, sa compagne Claire, ses collègues Diego et Mireille. Plus encore, ce n’est pas tant le récit même de son existence qui m’a tenu sur deux cents pages, mais l’analyse qu’en fait le personnage. Là encore, cet ouvrage me fait parfois l’effet de quelque chose proche de l’essai. Un essai incarné, taillé dans le récit d’une vie. Pas juste un roman. Pépin est un antihéros au carré : pas d’empathie, pas de romanesque. Ce refus de l’empathie romanesque doit être rapporté à la forme analytique du roman, et à la nature même de Marc Pépin, journaliste, romancier, créature intensément verbale. « Mieux vaut en rester aux faits » dit-il ! Malgré les promesses de grandeur que lui offrait sa carrière de reporter de guerre, Marc Pépin n’est ni une aventure ni un destin. Marc Pépin est un fait. Un phénomène humain. On peut noter l’audace d’un tel choix. Rien de moins simple que d’emporter l’adhésion de son lectorat en privant son protagoniste de quelques sympathies (anti)héroïques.
Quel phénomène humain Marc Pépin incarne-t-il ?
Arnaud Lathière-Lavergne : Par ses aspirations ascensionnelles, nourries des frustrations d’une adolescence ennuyée, Pépin incarne peut-être l’avènement de l’individu et, avec lui, l’injonction libérale à l’accomplissement de soi : réussir sa vie, devenir son propre dieu. Les conséquences, il les constate lui-même : « Admettez que je tire de ma colère l’idée qu’au sein du périmètre bien délimité de ma vie, Dieu, c’était moi. J’ai longtemps ignoré que cette alchimie bizarre produit son propre poison. Être Dieu, c’est être seul. L’impôt qui fait le prix d’une telle vie s’appelle : égoïsme. » Marc Pépin est l’homme qui perdit sa vie à vouloir la réussir. C’est sa formule. Elle est géniale ! Je l’adosse à une autre formule, d’une subtilité percutante (le livre regorge de ces formules subtiles et percutantes), que Pépin utilise pour qualifier sa sœur : « Anne, elle, a fait sa vie. Fait plutôt que réussi ». Le roman démontre ainsi l’impasse humaniste : la vie ne se réussit pas, elle se fait. On ne réussit pas l’amour, on le fait. On ne réussit pas ses enfants, on en fait. On ne réussit pas un livre, on en fait un. Un livre, ça n’est jamais vraiment achevé, c’est toujours un peu raté. Comme nos enfants. Comme l’amour. Comme la vie… Marc Pépin pourrait être l’archétype de ce drame humain : la réussite est un jeu perdu d’avance, c’est une idée. Une vie qui veut réussir tend vers un idéal, s’arrache aux faits. Une vie réussie est une vie défaite. Mieux vaut en rester aux faits.
J’aime assez que le roman s’applique à constater que l’époque puisse compromettre notre capacité même à aimer, pour finalement poser l’idée que l’amour en est le salut. Il y a ces deux aspects dans le livre : notre infirmité sentimentale face au désenchantement du monde, et l’amour comme puissance de subversion…
Arnaud Lathière-Lavergne
Les Présences Imparfaites est effectivement traversé par l’impossibilité de Marc Pepin à réussir socialement et amoureusement sa vie. Cet échec n’est-il pas surprenant compte tenu de sa lucidité au sujet des conventions sociétales, et de son affliction par rapport aux expériences dont il rêvait adolescent, mais invécues en raison notamment des restrictions parentales et du manque d’opportunités ?
Arnaud Lathière-Lavergne : Dans sa grande lucidité, Marc Pépin connaît les raisons de ses échecs sentimentaux. Sa relation de quinze ans avec Claire, prof de lettres, s’achève violemment lorsque celle-ci lui reproche, à juste titre, de ne « penser qu’à sa gueule ». Le lien avec sa mère vieillissante se délite à mesure que celle-ci sombre dans la démence, et lui-même souffre de devoir la placer en EPHAD. Pourtant, Marc Pépin pourrait s’en occuper. Il n’a pas la contrainte d’une famille à soi contrairement à sa sœur, et son travail ne l’en empêche pas tout à fait. « Je pourrais trouver une aide pour la journée, venir après » concède-t-il, avant de reconnaître : « Mais quelque chose me retenait, un je-ne-sais-quoi de liberté, ou de fuite devant la contrainte. »
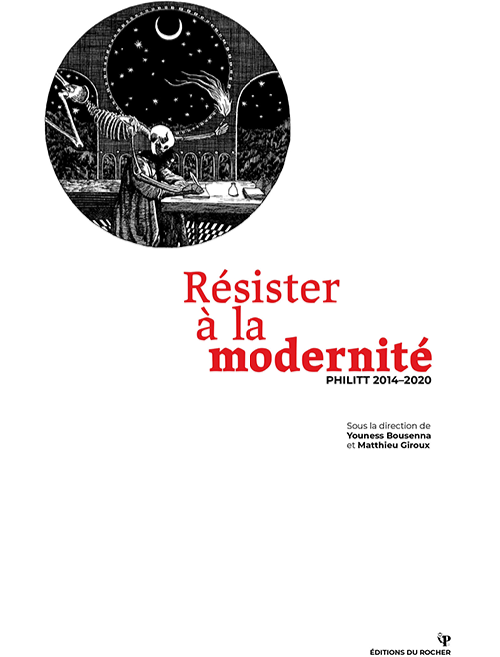
Telle est, sans doute, la clé du naufrage sentimental de Marc Pépin. N’existant que pour lui-même, l’individu moderne est une créature libre, libérée de ses attaches, de sa famille, de sa communauté, de son histoire. Déliée de tout, obligée de rien. Il le concède lui-même : « Pour aimer sa vie, il faut aimer autre chose. Des idées, les autres. Moi, je laisse Maman finir ses jours seule devant la télé. Qu’est-ce qui m’empêche de m’en occuper, si ce n’est une liberté sans objet ? » Une liberté sans objet : liquéfié par les impératifs de l’« accomplissement de soi », inférés par un monde qui contrarie la durabilité des liens sociaux, Marc Pépin se trouve incapable d’amour puisque l’amour exige précisément une certaine dépossession de soi, une errance – la mort symbolique du moi (autant de choses qui, par ailleurs, requièrent une immense confiance en soi, donc beaucoup d’amour-propre). Au fond, le roman va loin. Il nous dit que le monde que nous nous sommes faits nous rend peut-être incapables d’aimer…
Les Présences Imparfaites se clôt pourtant avec une phrase qui met en avant la puissance de l’amour. L’amour peut-il réellement apporter quelque chose à un individu dans nos sociétés contemporaines ? Qu’aurait-il pu changer à la trajectoire de Marc Pepin ?
Arnaud Lathière-Lavergne : Cette dernière phrase est plutôt surprenante, et m’a presque fait l’effet d’un gag. « L’amour vainc » est une formule qui fait écho à des siècles de récits, et qui pourrait paraître tout à fait naïve dans le cadre d’un roman contemporain. Toutefois, je ne peux pas me résoudre à y lire de l’ironie. D’abord, parce qu’elle n’est pas délivrée par Marc Pépin lui-même, si peu romantique, mais par son ex-compagne Claire, qui, par l’entremise d’un inconnu, lui offre ces deux mots sur un bout de papier à la fin d’une séance de cinéma (idée intéressante parce que le cinéma est le lieu du possible). Venant d’une femme dont la bonté de cœur fait tant miroir à la méchanceté du protagoniste, on ne peut recevoir cette affirmation que de manière sérieuse, comme un appel à la rédemption.
L’amour aurait-il pu changer la vie de Marc Pépin ? Peut-il encore quelque chose pour nous autres ? Bonne question ! Ce que j’aime dans cette phrase, c’est cette ambivalence. L’amour vainc, mais quoi au juste ? Cette colère maladive qui replie le protagoniste dans la solitude de son égoïsme ? On ne sait pas trop, et j’aime qu’on ne sache pas trop. J’aime aussi le fait que vainc puisse s’entendre vain, même si j’ignore s’il s’agit là d’une intention de l’auteur mais qu’importe, le mot le permet. Enfin, j’aime assez que le roman s’applique à constater que l’époque puisse compromettre notre capacité même à aimer, pour finalement poser l’idée que l’amour en est le salut. Il y a ces deux aspects dans le livre : notre infirmité sentimentale face au désenchantement du monde, et l’amour comme puissance de subversion – une humeur saine, une joie pleine, une force venue d’ailleurs. Pour sauver Marc Pépin de lui-même, il faudrait au moins cela : un miracle nommé amour.
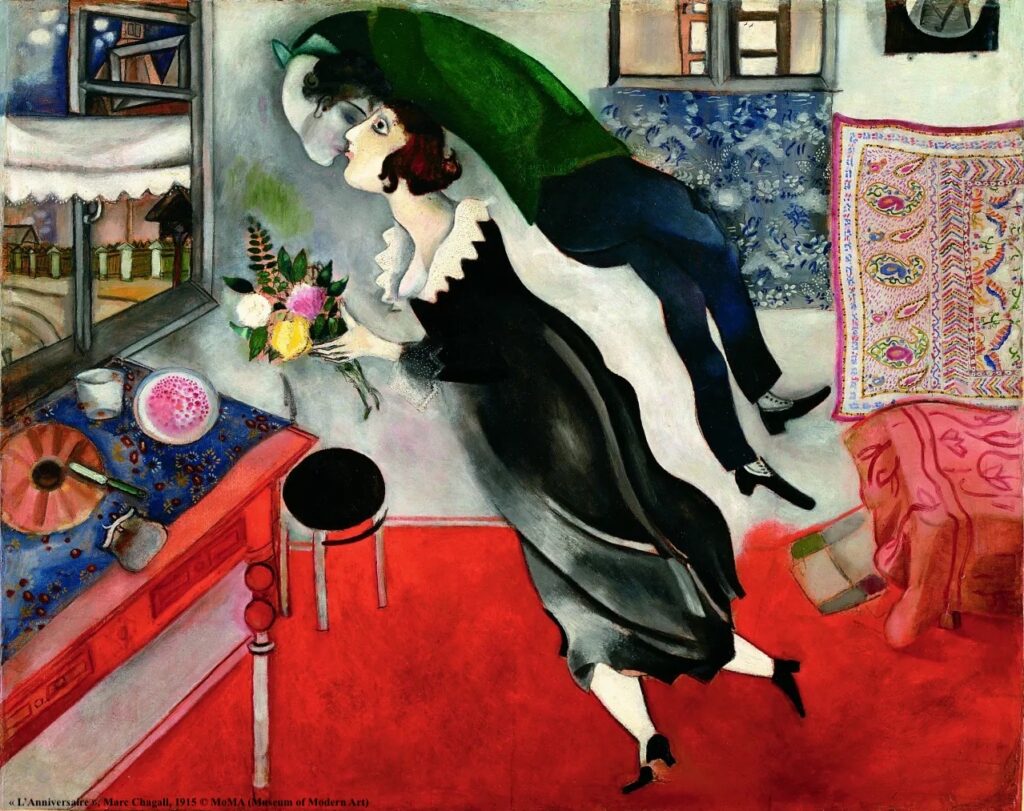
Comment qualifierez-vous Les Présences imparfaites ?
Arnaud Lathière-Lavergne : Maîtrisé ! Je trouve qu’il y a un très bon dosage entre l’élaboration philosophique du texte et sa teneur narrative. Youness Bousenna parvient à romancer des concepts d’une grande complexité, dans une langue qui n’est absolument pas jargonnante, et sans jamais perdre son lectorat. Pour preuve, je sais que je n’ai pas compris toute la profondeur du livre, et pourtant, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde en le lisant.
Et le style de Youness Boussena, qui conjugue entre autres colère et sarcasme dans ce premier roman ?
Arnaud Lathière-Lavergne : Le récit gravite effectivement autour d’un affect originel, la colère, qui pour autant ne se ressent pas dans la langue (comme quoi la forme ne doit pas toujours épouser le fond). Quel serait un style littéraire procédant de la colère ? La colère est un sentiment chaud, impulsif. En des termes littéraires, il pourrait se traduire par des emportements de langue, des punchlines, des scansions coup de poing, faisant claquer le libellé des mots au mépris du sens. La frappe plutôt que la justesse. Le choc plutôt que la mesure. Or, le style que développe Youness Bousenna à travers son personnage tend plutôt vers le froid : le cynisme en serait un mot-clé.
Le cynisme (entendu au sens moderne), c’est d’abord le constat lucide de la marche du monde, par-delà bien et mal, puis le désir de prendre le contre-pied de ses artifices, de ses conventions, de sa bienséance, de sa morale. Un style littéraire dérivé du cynisme exigerait donc d’abord, je l’évoquais, un ton critique ou analytique qui parcourt Les Présences imparfaites, comme dans ce passage où le narrateur dresse une véritable typologie du célibat (les célibataires passagers, les jouisseurs, les désespérés et les « célibataires existentiels » auxquels Marc Pépin s’assimile – ceux ne croyant plus en l’amour, et faisant philosophie de leur solitude). Puis, il y a la précision lexicale, le souci du mot juste. À cet égard, le roman de Youness Bousenna offre nombre d’exemples savoureux. En bon égoïste, Marc Pépin se laisse facilement irriter : « Une sorte de haine sociale m’emporte devant les excès de politesse dans les commerces et les mièvreries des habitués de boulangerie, dont les amabilités creuses allongent l’attente. » Ce genre de phrase témoigne d’une finesse psychologique qu’il s’agit d’exemplifier en des termes simples et suffisamment imagés, sans lyrisme, sans fioritures. « Les mièvreries des habitués de boulangerie », c’est simple, trivial, exact. On se le figure parfaitement. On a affaire à une langue d’une précision nue, qui dit l’essentiel en évitement tout ornements.
Cette finesse psychologique suppose aussi une finesse d’observation, qui se traduit par une attention aiguë à la matérialité des choses, à commencer par celle des corps. Le roman ne tarit pas de ces détails anatomiques : ce sont les images ramenées des reportages de guerre, « la longue saucisse d’intestin grêle posée comme une gerbe sur le sein d’une jeune femme », « l’os frontal nu du professeur laissant apparaître des viscosités – un lobe ou le cervelet » ; mais c’est aussi, plus banalement, le corps du personnage qui se rappelle à lui dans ses moments d’angoisses : « pour chasser la sensation de réclusion dans mon corps, je touchais compulsivement des objets, des surfaces, le tissu râpeux du fauteuil de mon salon ».
C’est aussi la matérialité des objets du quotidien. Le roman abonde de ces détails ordinaires qui composent l’environnement matériel des personnages : c’est la collection des vignettes Panini, débutée avec la carte rouge du Mexique, au médaillon représentant l’aigle et le serpent et l’inscription MEXICO 70. C’est l’arrivée successive de MTV sur le câble, et de M6 Music, puis l’avènement de l’eurodance et ses compiles, du portable à clapet Samsung, ainsi que celle de la PlayStation 2, responsable de l’addiction du neveu Pépin à GTA Vice City. Ensuite, ce sont les boutiques des containers Tex et China Shipping « qui dégueulaient des baskets Nike plagiées, de soutien-gorge recyclés, de CD, de claquettes en shaï et de portable en toc. Polyester, caoutchouc, polystyrène : la matière de la Terre servait à ça, à cette contre-alchimie venue du même utérus que nos produits certifiés ISO. » Cette dernière phrase illustre à elle seule la centralité de la matière dans le texte. Au fond, tout est matière ; raison pour laquelle les objets et les corps passent sans arrêt sous la plume de Pépin/Bousenna. Quant à ce goût des noms propres, ça n’est pas par pur plaisir du détail. Ça s’inscrit avant tout dans une démarche profondément réaliste, où il s’agit à la fois de convoquer des marqueurs temporels qui nous font passer l’époque avec les personnages, mais aussi de signaler le fait que ces noms, ces titres, ces logos, ces enseignes du quotidien font partie de notre vie mentale.
Mais ce réalisme n’est pas seulement descriptif. Dans sa manière de dire le monde sans fard, avec cruauté parfois, j’entends chez Pépin une tendresse pour sa petitesse, sa vanité. Ainsi, lorsqu’il évoque sa relation avec son père, il écrit : « L’amour circulait à travers des objets, à l’image du maillot d’Irak que je lui avais apporté. » Tout est dit : l’affection s’échange à bas bruit, dans les médiations triviales du monde matériel. C’est là que le « cynisme » du style Bousenna/Pépin me touche le plus : dans cette tendresse à froid.
Un dernier mot sur ce que Les Présences Imparfaites montre du rôle et des pouvoirs de la littérature ?
Arnaud Lathière-Lavergne : Les Présences Imparfaites de Youness Bousenna illustre magnifiquement la capacité de la littérature à saisir un temps, à rendre compte d’une « époque », à nous plonger dans l’intériorité d’un être, à nous faire voir du commun à travers une intelligence qui n’est pas la nôtre. Il montre également le rôle avant tout ludique de la littérature : Youness Bousenna partage avec son personnage le plaisir de saisir (comme je l’ai déjà évoqué) une psyché, un temps, un monde, une vie. Écrire, c’est d’abord cette joie de s’emparer du réel, de le comprendre. Enfin, ce roman rappelle la faculté qu’a la littérature de changer la boue en or. Si elle ne sauve ni Marc Pépin ni personne, elle peut au moins en racheter la laideur. À l’issue de ma lecture, je ne crois pas que la littérature puisse changer la vie, mais elle nous y sensibilise. Et ça c’est grand, c’est beau.
